P 13 : Commentaires
Histoire de la XIIIe Provinciale
OC IV, p. 459. Selon le catalogue Fouillou, elle a été revue par Nicole chez M. Hamelin. Beaubrun confirme.
Sur le succès des Provinciales à cette époque, voir la lettre de Mme de Sévigné du 12 septembre 1656 à Ménage, Correspondance I, éd. Duchêne, Pléiade, p. 39-40.
Les réponses aux Provinciales
Septembre 1656. NOUËT, Réponse à la douzième lettre des jansénistes, 8 p. in 4° (Recueil PR 382).
NOUËT Jacques, Réponse à la douzième Lettre des jansénistes, (septembre) 1656, 8 p. in-4°. Voir le texte dans Réponses, éd. de 1658, p. 291 sq. Extrait du texte sur le je suis seul dans GEF VI, p. 4.
Voir WENDROCK, Provinciales tr. Joncoux, II, p. 213-230. Nicole répondit au P. Nouët par une Réfutation de la Réponse à la douzième lettre, 8 p. in 4°, qui parut peu après la XIIIe Provinciale, et fut ensuite insérée dans Wendrock sous la forme de la Note I à la XIIe Provinciale, comme texte d’un « auteur inconnu ». Voir aussi SAINT-GILLES, Journal, éd. Jovy, p. 187. Le P. Nouët attribue la Théologie morale, sinon à Pascal, du moins aux Jansénistes. Il attaque Pascal sur le je suis seul : en fait, il reste janséniste et il a tout le parti derrière lui ; ce n’est qu’une formule tactique. Analyse des faussetés particulières de la lettre : il cite Vasquez contre Pascal. Voir p. 4: "ce qui vous trompe, Monsieur, ou plutôt ce qui vous sert à tromper les autres, c’est la subtilité de cet auteur, qu distingue le nécessaire et le superflu en plusieurs manières, selon lesquelles il règle l’obligation des riches". Pascal ignore la théologie, et il la renverse. Voir dans GEF VI, p. 4, un extrait de ce texte, sur le je suis seul de la Provinciale XII. Voir aussi WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, II, p. 213-230.
Voir aussi WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, II, éd. de 1700, p. 213-230. Nicole répondit au P. Nouët par une Réfutation de la réponse à la douzième lettre, 8 p. in 4°, qui parut un peu après le XIIIe Provinciale. Elle fut insérée dans Wendrock sous la forme de la Note I à la XIIe lettre, comme texte d’un "auteur inconnu". Voir ci-dessous.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 424 sq. Parution probable dans le courant du mois de septembre. Tentative de répondre dans le même style que Pascal ; exemple de l’incipit, qui cherche à user du style coupé. Reprise des griefs des Impostures : le p. Nouët isole trois thèmes de réflexion sur l’aumône, la simonie et la banqueroute. Il insiste sur le grief de calomnie et de falsification. Recentrage de la polémique sur la question de fait en ouvrant une stratégie de comparaison scrupuleuse entre le texte cité issu de leurs rangs et celui qui est produit par les adversaires : p. 615. Retour malgré tout à un style de discussion érudite inauguré dans les Impostures, mais dont les Réponses ont tenté de sortir : p. 615.
Les réfutations de la Réponse à la douzième lettre des jansénistes. Voir l’édition des Provinciales, Didot, 1823, I, p. 295 sq.
NICOLE Pierre, Réfutation de la Réponse à la douzième Lettre
NICOLE Pierre, Réfutation de la Réponse à la douzième Lettre, 8 p. in-4°.
Voir WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, II, p. 213-230. Nicole répondit au P. Nouët par une réfutation de la réponse à la douzième lettre, 8 p. in 4°, qui parut un peu après la XIIIe Provinciale. Elle fut insérée dans Wendrock sous la forme de la Note I à la XIIe lettre, comme texte d’un "auteur inconnu".
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 432 sq. Œuvre collective dont le rédacteur principal est probablement Nicole. Il s’agit d’éviter à Pascal de s’enliser dans le marais de la chicanerie où les jésuites cherchent à l’attirer. L’écrit contient une réfutation point par point de la réponse du P. Nouët sur les questions de théologie morale, avec la position de Port-Royal : p. 617 sq.
FABRI Honoré, Notae in notas W. Wendrockii, J.Busdeum, Cologne, 1659, in-89° (BN: 12352 et D. 34676).
L’objet de la XIIIe Provinciale
Sommaire de Nicole-Wendrock : "que la doctrine de Lessius sur l’homicide est la même que celle de Victoria. Combien il est facile de passer de la spéculation à la pratique. Pourquoi les jésuites se sont servis de cette vaine distinction, et combien elle est inutile pour les justifier" (tr. Joncoux).
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 199 sq.
Comme la XIVe lettre, celle-ci traite de l’homicide.
Sources de la XIIIe Provinciale
GEF VI, p. 5. Pascal s’inspire, comme il l’a déjà fait, de la Réponse de l’université de Paris à l’Apologie pour les jésuites composée par Hermant en 1644, et de la Lettre d’un théologien à Polémarque d’Arnauld. Il a lu la Requête des curés de Rouen qui lui donne des indications sur la doctrine du P. Des Bois.
Frises de la Provinciale XIII
Frise du recueil R 1035 de Clermont
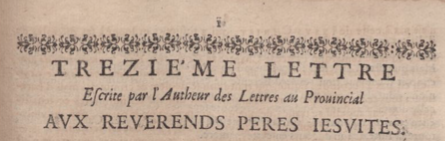
Frise du recueil R 5597 de Clermont

Frise du Recueil R 5452 de Clermont

XIII, 1. Je viens de voir votre dernier écrit, où vous continuez vos impostures jusqu’à la vingtième, en déclarant que vous finissez par là cette sorte d’accusation, qui faisait votre première partie, pour en venir à la seconde, où vous devez prendre une nouvelle manière de vous défendre, en montrant qu’il y a bien d’autres casuistes que les vôtres qui sont dans le relâchement aussi bien que vous. Je vois donc maintenant, mes pères, à combien d’impostures j’ai à répondre : et puisque la quatrième où nous en sommes demeurés est sur le sujet de l’homicide, il sera à propos, en y répondant, de satisfaire en même temps à la 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 qui sont sur le même sujet.
Pascal procède souvent par regroupement des points à établir et à démontrer dans ses écrits scientifiques. On pourra comparer avec le Traité des trilignes dans les Lettres de A. Dettonville, qui regroupe d’une part les données relatives aux ordonnées des onglets nécessaires pour trouver les mesures des solides de la roulette (OC IV, éd. J. Mesnard, p. 456 sq.), puis celles qui donnent les dimensions et les centres de gravité de leurs surfaces courbe (OC IV, éd. J. Mesnard, p. 463).
Les Impostures du P. Nouët
NOUËT, Jacques, Continuation des Impostures que les jansénistes publient contre les jésuites, (mi-septembre 1656), 36 p. in-4°. La Continuation des Impostures..., parue vers la mi-septembre sans doute, ne contient que 19 Impostures, mais la dernière porte par erreur d’impression le n° XX.
D’après le plan annoncé par le P. Nouët au début de sa Réponse, son ouvrage devait comprendre quatre parties, dont la seconde eût été de montrer que les Provinciales « condamnaient sans jugement des opinions probables, que les plus savants théologiens enseignent dedans l’École ».
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 439 sq. Choix stratégiques généraux : concentration des griefs sur les leit-motives de la raillerie et de la calomnie, et accusation d’hérésie double portée contre Pascal : par le refus des opinions tenues pour probables, et sur des opinions que la tradition tient pour indubitables. Il s’agit de verrouiller toute tentative d’affirmer l’orthodoxie de l’auteur des Provinciales.
XIII, 1. Vous devez prendre une nouvelle manière de vous défendre, en montrant qu’il y a bien d’autres casuistes que les vôtres qui sont dans le relâchement aussi bien que vous
D’après le plan annoncé par le P. Nouët au début de sa Réponse, son ouvrage devait comprendre quatre parties, dont la seconde eût été de montrer que les Provinciales « condamnaient sans jugement des opinions probables, que les plus savants théologiens enseignent dedans l’École ».
Pascal a brièvement invoqué ce point dans la Ve Provinciale, où il fait expliquer à son épisrtolier : « [Je] lui demandai seulement, si tous ces auteurs-là étaient jésuites. Non, me dit-il ; Mais il n’importe, ils n’ont pas laissé de dire de bonnes choses. Ce n’est pas que la plupart ne les aient prises ou imitées des nôtres ; mais nous ne nous piquons pas d’honneur, outre qu’ils citent nos pères à toute heure, et avec éloge. Voyez Diana qui n’est pas de notre société, quand il parle de Vasquez, il l’appelle le Phénix des esprits. Et quelquefois il dit que Vasquez seul lui est autant que tout le reste des hommes. Instar omnium. Aussi tous nos pères se servent fort souvent de ce bon Diana. Car si vous entendez bien notre doctrine de la probabilité, vous verrez bien que cela n’y fait rien ; Au contraire, nous avons bien voulu que d’autres que les jésuites puissent rendre leurs opinions probables, afin qu’on ne puisse pas nous les imputer toutes. Et ainsi quand quelque auteur que ce soit en a avancé une, nous avons droit de la prendre si nous le voulons par la doctrine des opinions probables, et nous n’en sommes pas les garants quand l’auteur n’est pas de notre corps. J’entends tout cela, lui dis-je. »
XIII, 2. Je justifierai donc, dans cette lettre, la vérité de mes citations contre les faussetés que vous m’imposez.
Imposer : charger, accuser. Cet homme s’est bien justifié des crimes qu’on lui avait imposés (Furetière). Imposer signifie encore faire accroire, tromper, dire une fausseté. Cet avocat impose souvent, et déguise la vérité (Furetière). Le sens est donc : les faussetés que vous m’imputez par calomnie (voir sur la calomnie la XVe Provinciale).
XIII, 2. Mais parce que vous avez osé avancer dans vos écrits, que les sentiments de vos auteurs sur le meurtre sont conformes aux décisions des papes et des lois ecclésiastiques, vous m’obligerez à détruire, dans ma lettre suivante, une proposition si téméraire et si injurieuse à l’Église. Il importe de faire voir qu’elle est exempte de vos corruptions
Téméraire : Voir la Provinciale I : téméraire se dit aussi dans les actions et disputes civiles ; on parle d’une demande téméraire, c’est-à-dire imprudente et insoutenable. On condamne les propositions hérétiques comme téméraires et scandaleuses. Furetière ajoute à juste titre que c’est un grand péché que le jugement téméraire, de mal juger d’autrui sans un fondement légitime. Comme l’indique le Dictionnaire de l’Académie (1787), en matière de doctrine, et principalement en matière de morale et de théologie, on appelle Proposition téméraire une proposition trop hardie, de laquelle on peut tirer des inductions contraires à la véritable doctrine. Voir Provinciales, éd. Le Guern, p. 324, la définition du Dictionnaire de Trévoux (1704).
Le P. Nouët avait annoncé son plan dans l’introduction de ses Impostures, Réponses, p. 91. « L’ordre que je garde en celle-ci, et la fin que je me propose, est de montrer que le casuiste du Port-Royal ayant emprunté ses reproches du ministre de Charenton, il est tombé honteusement dans ses défauts. I. Altérant le sens et les paroles des auteurs jésuites, qu’il cite, par de lâches impostures et des supercheries infâmes. II. Condamnant ses jugements des opinions probables, que les plus savants théologiens enseignent dedans l’École. III. Attaquant avec une insolente témérité les maximes de la foi que l’Église tient pour constantes et indubitables. IX. Et enfin se moquant avec impiété des pratiques familières de la dévotion, que l’on enseigne ordinairement au peuple, pour l’attirer peu à peu par la facilité de ces exercices spirituels à l’amour de la vertu et au soin de son salut: et inventant mille calomnies, et mille outrages contre l’honneur d’une compagnie religieuse, qui montrent clairement que la passion furieuse de médire qui le possède ne peut être qu’un effet violent de la haine que l’hérésie de Calvin lui a inspirée contre ces pères. » La XIIIe Provinciale répond donc sur les points I, II et III à la fois.
Sur la citation du P. Nouët, voir GEF VI, p. 12 ; Provinciales, éd. Cognet, p. 237, n. 2. Cette phrase ne se trouve pas textuellement dans l’ouvrage du P. Nouët : celui-ci écrit seulement que la doctrine en question, que les jésuites ont combattue « avec modestie », « n’a pas été condamnée par le pape, ni par l’Église ». Nouët oppose la prudence de ces jésuites à l’audace de l’auteur des Provinciales.
Une proposition si téméraire et si injurieuse à l’Église : Pascal se pose en défenseur de l’Église, contre un ordre religieux qui prétend aussi défendre l’Église contre l’hérésie larvée du jansénisme.
XIII, 2. Afin que les hérétiques ne puissent pas se prévaloir de vos égarements pour en tirer des conséquences qui la déshonorent
C’est l’idée directrice du Cinquième écrit des curés de Paris, sur l’avantage que les hérétiques prennent contre l’Église, de la morale des casuistes et des jésuites ; voir Les Provinciales, éd. Cognet, p. 430 sq. « § 1. C’est une entreprise bien ample et bien laborieuse, que celle où nous nous trouvons engagés de nous opposer à tous les maux qui naissent des livres des casuistes, et surtout de leur Apologie. Nous avons travaillé jusques ici à arrêter le plus considérable, en prévenant, par nos divers écrits, les mauvaises impressions que ces maximes relâchées auraient pu donner aux fidèles qui sont dans l’Église. Mais voici un nouveau mal, d’une conséquence aussi grande, qui s’élève du dehors de l’Église et du milieu des hérétiques.
§ 2. Ces ennemis de notre foi qui, ayant quitté l’Église Romaine, s’efforcent incessamment de justifier leur séparation, se prévalent extraordinairement de ce nouveau livre, comme ils ont fait de temps en temps des livres semblables. Voyez, disent-ils à leurs peuples, quelle est la croyance de ceux dont nous avons quitté la communion ! La licence y règne de toutes parts : on en a banni l’amour de Dieu et du prochain. On y croit, dit le ministre Drelincourt, que l’homme n’est point obligé d’aimer son Créateur ; qu’on ne laissera pas d’être sauvé sans avoir jamais exercé aucun acte intérieur d’amour de Dieu en cette vie; et que Jésus-Christ même aurait pu mériter la rédemption du monde par des actions que la charité n’aurait point produites en lui, comme dit le P. Sirmond. On y croit, dit un autre ministre, qu’il est permis de tuer plutôt que de recevoir une injure ; qu’on n’est point obligé de restituer, quand on ne le peut faire sans déshonneur ; et qu’on peut recevoir et demander de l’argent pour le prix de sa prostitution, et non solum femina quaeque, sed etiam mas, comme dit Emmanuel Sa, jésuite.
§ 3. Enfin ces hérétiques travaillent de toutes leurs forces, depuis plusieurs années, à imputer à l’Église ces abominations des casuistes corrompus. Ce fut ce que le ministre Du Moulin entreprit des premiers dans ce livre qu’il en fit, et qu’il osa appeler Traditions romaines. Cela fut continué ensuite dans cette dispute qui s’éleva, il y a dix ou douze ans, à La Rochelle, entre le p. d’Estrade, jésuite, et le ministre Vincent, sur le sujet du bal, que ce ministre condamnait comme dangereux et contraire à l’esprit de pénitence du christianisme, et pour lequel ce père fit des apologies publiques, qui furent imprimées alors. Mais le ministre Drelincourt renouvela ses efforts les années dernières, dans son livre intitulé : Licence que les casuistes de la communion de Rome donnent à leurs dévots. Et c’est enfin dans le même esprit, qu’ils produisent aujourd’hui par toute la France cette nouvelle Apologie des casuistes en témoignage contre l’Église, et qu’ils se servent plus avantageusement que jamais de ce livre, le plus méchant de tous, pour confirmer leurs peuples dans l’éloignement de notre communion, en leur mettant devant les yeux ces horribles maximes, comme ils l’ont fait encore depuis peu à Charenton.
§ 4. Voilà l’état où les Jésuites ont mis l’Église. Ils l’ont rendue le sujet du mépris et de l’horreur des hérétiques : elle, dont la sainteté devrait reluire avec tant d’éclat, qu’elle remplît tous les peuples de vénération et d’amour. De sorte qu’elle peut dire à ces pères ce que Jacob disait à ses enfants cruels: Vous m’avez rendu odieux aux peuples qui nous environnent; ou ce que Dieu dit dans ses prophètes à la Synagogue rebelle : Vous avez rempli la terre de vos abominations, et vous êtes cause que mon saint nom est blasphémé parmi les gentils, lorsqu’en voyant vos profanations ils disent de vous: C’est là le peuple du Seigneur, c’est celui qui est sorti de la terre d’Israël qu’il leur avait donnée en héritage. C’est ainsi que les hérétiques parlent de nous, et qu’en voyant cette horrible morale, qui afflige le cœur de l’Église, ils comblent sa douleur, en disant, comme ils font tous les jours : C’est là la doctrine de l’Église romaine, et que tous les catholiques tiennent ; ce qui est la proposition du monde la plus injurieuse à l’Église. »
C’est une idée que l’on retrouve souvent dans la polémique contre les jésuites, que leur morale corrompue discrédite l’Église auprès des incroyants et des hérétiques, et fait ainsi obstacle à leur conversion.
La même idée est présente aussi dans les Pensées, Laf. 966, Sel. 799 : « Pour la foule des casuistes, tant s’en faut que ce soit un sujet d’accusation contre l’Église, que c’est au contraire un sujet de gémissement de l’Église. »
Provinciales, éd. Cognet, p. 237, n. 3. Allusion à un ouvrage du ministre Du Moulin.
XIII, 2. Et ainsi, en voyant d’une part vos pernicieuses maximes, et de l’autre les canons de l’Église qui les ont toujours condamnées, on trouvera tout ensemble, et ce qu’on doit éviter, et ce qu’on doit suivre.
Canon : mot grec désignant une règle employée pour les mesures ; il a pris par dérivation un sens moral ; dans l’Église, désigne une décision solennelle de l’autorité ecclésiastique (notamment un concile), qui s’opposait dans les premiers conciles aux nomoi, les lois des empereurs. Le droit canonique est l’ensemble des lois ecclésiastiques. Cependant, dans certains conciles, notamment celui de Trente, certains canons contiennent des règles qui ne relèvent pas de la discipline, mais de la foi, autrement dit des définitions dogmatiques. Voir
JOMBART Emile, Manuel de droit canon, p.15.
LALANDE André, Vocabulaire..., p. 118-119. Dans les sciences normatives, canon est synonyme de norme, mais avec l’idée d’une règle pratique. Leibniz appelle « canons des formules générales qui donnent d’abord ce que l’on demande », par exemple unee formule générale qui donne deux nombres connaissant leur somme et leur différence.
BOUYER L., Dictionnaire théologique, p. 115 sq. Mot venu du grec désignant une règle utilisée pour les mesures ; il s’applique à dans l’Église en général à toute décision solennelle de l’autorité ecclésiastique, spécialement dans un concile. Le canon des Écritures est la liste des livres reconnus par l’Église comme inspirés de Dieu. La canonicité ne rend pas le livre inspiré, mais fait connaître cette inspiration. La reconnaissance de l’ensemble des livres inspirés que l’Église, depuis le concile de Trente, propose formellement et exclusivement comme canoniques aux fidèles s’est faite progressivement. Pour l’ancien testament, c’est la liste des livres qui se trouvent dans la version des Septante, plus large que celle donnée par les Bibles hébraïques. A cause de cette différence, les livres qui ne sont que dans la Bible grecque ont reçu le nom de deutéro-canoniques ; les réformateurs protestants ne les admettent pas en général. Pour le nouveau testament, ce sont les quatre évangiles, les Actes des apôtres et l’ensemble des épîtres.
BARTMANN Bernard, Précis de théologie dogmatique, I, p. 31 sq. Au sens étymologique, le canon désigne une barre de bois, une mesure, une règle, puis une liste, un catalogue. Le mot est appliqué en 350 aux livres de l’Écriture, d’abord au sens passif, parce que sont canoniques les livres accueillis par l’Église dans la collection officielle ; puis au sens actif, dans la mesure où, une fois entrés dans le canon, ces livres deviennent eux-mêmes règle pour la foi. On entend par canon la collection des livres que l’Église a admis officiellement dans la liste des Écritures inspirées et qui ensuite ont servi de règle de vérité et de foi dans l’instruction des fidèles. On distingue dans la canonicité de l’Écriture un double élément, un élément divin et un élément ecclésiastique : les livres sont canoniques parce qu’ils sont inspirés, ils le sont aussi parce qu’ils ont été reconnus.
Les décisions relatives au canon se trouvent dans la session IV du concile de Trente ; voir Conciliorum œcumenicorum decreta, Edizioni Dehoniane, Bologne1991, p. 663-666. La liste est donnée p. 663-665, Decretum primum : recipiuntur libri sacri et traditiones apostolorum. Le décret déclare anathème toute personne qui refuse cette liste. Voir BARTMANN, Précis de théologie dogmatique, I, p. 32.
XIII, 3. Votre quatrième imposture est sur une maxime touchant le meurtre, que vous prétendez que j’ai faussement attribuée à Lessius. C’est celle-ci : Celui qui a reçu un soufflet peut poursuivre à l’heure même son ennemi, et même à coups d’épée, non pas pour se venger, mais pour réparer son honneur.
Référence à Provinciale XII, 20, éd. Cognet, p. 233-234.
Cette maxime du De justitia et jure de Lessius, II, ch. IX, dub. 12, n°79, est donnée dans GEF V, p. 64. Pascal en parle dans la Provinciale VII, 6.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 232, sur l’homicide. Voir surtout p. 456 sq., sur l’homicide et le duel.
XIII, 3. Sur quoi vous dites que cette opinion-là est du casuiste Victoria.
François de Victoria, dominicain. Voir sa biographie dans DE VITORIA Francisco, Leçon sur le pouvoir politique, éd. Maurice Barbier, Paris, Vrin, 1980, p. 7-13. Voir VII, 6.
HURTUBISE Pierre, La casuistique dans tous ses états. De Martin Azpilcueta à Alphonse de Liguori, Ottawa, Novalis, 2005.
NOUËT Jacques, Impostures IV, in Réponses, éd. de 1658, p. 104 sq., reproduit dans GEF VI, p. 6. Nouët a raison : Pascal ne mentionne pas le fait que Lessius emprunte ce passage au dominicain F. de Victoria, alors que Lessius y renvoie explicitement. Remarque sur l’origine du texte chez Victoria, qui n’est pas jésuite : p. 105. Nouët remarque aussi que Pascal omet de dire que Lessius en condamne la pratique. Il renvoie à Du Moulin comme source de Pascal : « tous deux usent de supercherie » : p. 104.
Voir NOUËT Jacques, Réponse à l’onzième lettre, Réponses, éd. de 1658, p. 284-285: « ... vous attribuez à Lessius ce qu’il ne fait que rapporter de Victoria célèbre théologien, que celui qui a reçu un soufflet peut repousser à l’instant cette injure et même à coups d’épée, etiam cum gladio. Proposition dont il désavoue la pratique au nombre suivant en ces termes que je vous donne ici, parce qu’ils n’ont pas été cités dans la Réponse, afin que vous ne croyiez pas qu’on les ait dissimulés par dessein pour substituer en leur place les paroles du nombre 82. qui ne sont rapportés que pour en montrer la conformité avec celles-ci. Pour les raisons que je viens de dire, cette opinion est probable dans la spéculation : mais néanmoins on ne la doit pas facilement permettre dans la pratique. Premièrement à raison du danger qu’il y a de donner lieu à la haine, à la vengeance et à l’excès. Car si saint Augustin fait difficulté de dire qu’on puisse pour défendre sa vie tuer un homme, beaucoup moins accorderait-il en ce cas qu’on le puisse tuer pour défendre son honneur. Voyez, Monsieur, si vous êtes fondé sur la vérité » : p. 284-285.
XIII, 3. Et ce n’est pas encore là le sujet de la dispute, car il n’y a point de répugnance à dire qu’elle soit tout ensemble de Victoria et de Lessius, puisque Lessius dit lui-même qu’elle est aussi de Navarre
Martin Azpilcueta, dit Navarre : voir Provinciale V, 14.
XIII, 3. Et de votre père Henriquez, qui enseignent Que celui qui a reçu un soufflet peut à l’heure même poursuivre son homme, et lui donner autant de coups qu’il jugera nécessaire pour réparer son honneur.
Son homme : homme est pris quelquefois pour ennemi, adversaire. Ils ont fait un combat d’homme à homme. Celui-là a tué son homme. Il a joué au piquet, il a plumé son homme (Furetière).
Henri Henriquez (1536-1608). Jésuite espagnol qui fut un temps dominicain, auteur d’une Summa theologiae moralis, Salamanque, 1591.
Provinciales, éd. Cognet, p. 123.
XIII, 3 Il est donc seulement question de savoir si Lessius est du sentiment de ces auteurs, aussi bien que son confrère. Et c’est pourquoi vous ajoutez : Que Lessius ne rapporte cette opinion que pour la réfuter ; et qu’ainsi je lui attribue un sentiment qu’il n’allègue que pour le combattre, qui est l’action du monde la plus lâche et la plus honteuse à un écrivain. Or je soutiens, mes pères, qu’il ne la rapporte que pour la suivre. C’est une question de fait qu’il sera bien facile de décider. Voyons donc comment vous prouvez ce que vous dites, et vous verrez ensuite comment je prouve ce que je dis.
Sentiment : avis, opinion, sans aucune nuance de sensibilité.
NOUËT Jacques, Impostures IV, in Réponses, éd. de 1658, p. 105. « (...) il fait dire à Lessius comme de lui-même ce que cet auteur ne fait que rapporter de Victoria, célèbre casuiste, qui n’est pas de cette Société, non pour l’approuver, mais pour le réfuter, et ainsi il lui impute une doctrine qu’il n’allègue que pour la combattre ; qui est l’action du monde la plus lâche et la plus honteuse à un écrivain qui fait le censeur et le réformateur des opinions d’autrui. »
Voir NOUËT Jacques, Réponse à l’onzième lettre, Réponses, éd. de 1658, p. 284-285: « ...vous attribuez à Lessius ce qu’il ne fait que rapporter de Victoria célèbre théologien, que celui qui a reçu un soufflet peut repousser à l’instant cette injure et même à coups d’épée, etiam cum gladio. Proposition dont il désavoue la pratique au nombre suivant en ces termes que je vous donne ici, parce qu’ils n’ont pas été cités dans la Réponse, afin que vous ne croyiez pas qu’on les ait dissimulés par dessein pour substituer en leur place les paroles du nombre 82. qui ne sont rapportés que pour en montrer la conformité avec celles-ci. Pour les raisons que je viens de dire, cette opinion est probable dans la spéculation : mais néanmoins on ne la doit pas facilement permettre dans la pratique. Premièrement à raison du danger qu’il y a de donner lieu à la haine, à la vengeance et à l’excès. Car si saint Augustin fait difficulté de dire qu’on puisse pour défendre sa vie tuer un homme, beaucoup moins accorderait-il en ce cas qu’on le puisse tuer pour défendre son honneur. Voyez, Monsieur, si vous êtes fondé sur la vérité » : p. 284-285.
Voir NOUËT Jacques, Réponse à la treizième lettre, in Réponses, p. 325. En fait, Lessius écrit qu’il n’approuve pas la décision spéculative in praxi. « S’il est vrai, dites-vous, que Lessius ne fait que rapporter les paroles du casuiste Victoria, il est vrai aussi qu’il ne les rapporte que pour les suivre. C’est ici une nouvelle imposture qui en traîne plusieurs autres en suite, mais qui ne justifie pas celle qui la précède. Ce n’est pas le moyen de guérir vos plaies que d’en faire de nouvelles.
Si vous vous fussiez contenté de falsifier les paroles de ce jésuite, on eût pris cette chute pour un effet de votre trouble qui nous eût donné de la pitié : mais d’altérer les pensées et de corrompre la pureté de sa doctrine, c’est l’effet d’une malice affectée, pour laquelle on ne peut avoir que de l’indignation et du dédain.
Est-ce suivre l’opinion de Victoria que de dire qu’il ne le faut pas facilement permettre, parce qu’il est à craindre qu’elle ne donne lieu à la haine, à la vengeance, et à l’excès ? Pouvait-il se déclarer contre cet auteur célèbre par une expression plus forte, sans sortir des bornes de la civilité, et du respect qu’on doit garder dans cette sorte de dispute contre des docteurs catholiques ?
Est-ce la suivre que de la combattre par l’autorité de saint Augustin (que vous n’aviez garde de montrer à tout le monde, parce que vous eussiez découvert à même temps votre mauvaise foi) et de conclure par le sentiment de ce grand saint, que s’il fait difficulté de dire qu’on puisse pour défendre sa vie, tuer un homme, beaucoup moins accorderait-il qu’on le puisse tuer pour défendre son honneur ?
Est-ce la suivre que de dire immédiatement après sur le sujet de cette autre maxime, qui permet de tuer pour repousser la calomnie dont on ne se peut autrement défendre, qu’il la condamne aussi dans la pratique? haec quoque sententia (ces mots sont remarquables pour montrer la liaison de cette décision avec la précédente) haec quoque (souffrez Monsieur, que je le répète encore une fois pour vous faire voir la raison que j’ai eue de la rapporter, non pour les confondre toutes deux, comme vous m’imposez, nonobstant que je vous en eusse déjà averti dans ma réponse à votre onzième Lettre; mais pour vous en montrer la conformité) Haec quoque senteintia mihi in praxi non probatur: quia multis caibus cum magna reip. perturbatione praeberet occasionem. Je n’approuve point non plus cette opinion dans la pratique, d’autant qu’elle donnerait ouverture à beaucoup de meurtres secrets, qui causeraient de grands désordres dans les royaumes, parce que quand il s’agit du droit que chacun a de se défendre, il faut toujours prendre garde que l’usage n’en soit préjudiciable au public.
Après des preuves si évidentes, comment avez-vous osé dire que Lessius ne rapporte l’opinion de Victoria que pour la suivre ? comment avez-vous eu la hardiesse de prendre à témoin toutes les personnes d’honneur qui l’ont vue dans sa source devant même que j’eusse pris le dessein de vous répondre ? »
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol. Réponse au grief de falsification.
Voyons donc comment vous prouvez ce que vous dites, et vous verrez ensuite comment je prouve ce que je dis : la phrase imite la rhétorique du défi en duel, ironiquement adaptée au sujet du passage.
XIII, 4. Pour montrer que Lessius n’est pas de ce sentiment, vous dites qu’il en condamne la pratique ; et pour prouver cela, vous rapportez un de ses passages, liv. 2, c. 9, n. 82, où il dit ces mots : J’en condamne la pratique. Je demeure d’accord que, si on cherche ces paroles dans Lessius, au nombre 82, où vous les citez, on les y trouvera.
Je demeure d’accord : En effet, on lit au n°82 : « Verum haec quoque sententiam mihi in praxi non probatur ; quia multis occultis caedibus cum magna Reipub. perturbatione praeberet occasionem ». Mais la concession est purement formelle, puisque Pascal veut montrer que cette clause ne se trouve que dans le passage n°82, et ne touche nullement les n°79-80. Elle ne concerne donc que la résistance à l’infamie (n°81-82) et non le cas du soufflet (alapa, n°79-80).

LESSIUS, De justitia et jure, Livre II, ch. IX , dub. 12, Utrum pro defensione pudicitiae et honoris, liceat occidere eum, qui tentat violare, n°79. On y trouve en effet la référence à Victoria, en ces termes : « Victoria, relect. de Jure belli num. 5. Ubi dicit eum qui colaphum accepit, posse statim repercutere, etiam gladio ; non ad sumendam vindictam, sed ad vitandam infamiam, etiamsi invasor non esset ulterius progressurus. Unde sequitur, si ille fugiat, posse laesum statim insequi et percutere. Si enim potest repercutere manentem, cur non fugientem ? » Pascal dit que la proposition est aussi de Navarre et Henriquez. Mais Lessius allègue aussi Jeanson, Corduba, Mantius, Penna, Clarus, Cajetan et Antoninus. Mais la condamnation dans la pratique se trouve dans le n°82 : « Verum haec quoque sententiam mihi in praxi non probatur ; quia multis occultis caedibus cum magna Reipub. perturbatione praeberet occasionem » : p. 99.
XIII, 4. Mais que dira-t-on, mes pères, quand on verra en même temps qu’il traite en cet endroit d’une question toute différente de celle dont nous parlons, et que l’opinion, dont il dit en ce lieu-là qu’il en condamne la pratique, n’est en aucune sorte celle dont il s’agit ici, mais une autre toute séparée ? Cependant il ne faut, pour en être éclairci, qu’ouvrir le livre même où vous renvoyez ; car on y trouvera toute la suite de son discours en cette manière.
LESSIUS, De justitia et jure, Livre II, ch. IX , dub. 12, Utrum pro defensione pudicitiae et honoris, liceat occidere eum, qui tentat violare, n°79. On y trouve en effet la référence à Victoria, en ces termes : « Victoria, relect. de Jure belli num. 5. Ubi dicit eum qui colaphum accepit, posse statim repercutere, etiam gladio ; non ad sumendam vindictam, sed ad vitandam infamiam, etiamsi invasor non esset ulterius progressurus. Unde sequitur, si ille fugiat, posse laesum statim insequi et percutere. Si enim potest repercutere manentem, cur non fugientem ? »
La condamnation dans la pratique se trouve dans le n°82 : « Verum haec quoque sententiam mihi in praxi non probatur ; quia multis occultis caedibus cum magna Reipub. perturbatione praeberet occasionem » : p. 99 ; elle comporte un mot qui a donné lieu à discussion. Voir l’éd. Cognet, p. 238, n. 5, sur le quoque qui se trouve dans le texte de Lessius, et qui est censé étendre la réprobation exprimée dans le n. 82 aux précédents, où se trouve l’opinion que discute Pascal. L’argument a été pris dans le commentaire de l’abbé Maynard, Les Provinciales et leur réfutation, t. 2, Paris, F. Didot, 1851, p. 135, n. 1, qui écrit que « traitant du meurtre pour calomnie », [Lessius] « en condamne absolument la pratique, n’étant gêné là par aucune autorité : Haec quoque sententia non est sequenda. Remarquez la liaison haec quoque, qui montre bien que Lessius rejette également le droit de défense meurtrière en ces deux circonstances. Le P. Nouët n’avait donc fait rien de honteux en accusant Pascal de défense meurtrière en ces deux circonstances ».
L’abbé Maynard n’a sans doute pas pris la peine de vérifier les textes, car dans le n. 82, on trouve bien le haec quoque, mais dans la formule « verum haec quoque sententia mihi in praxi non probatur », et non pas Haec quoque sententia non est sequenda, qui semble bien être une invention ad hoc.
Le P. Nouët n’a pas eu le nez creux en citant ce passage, car c’est celui où Pascal trouve l’idée que le meurtre est condamné parce que cela engendrerait trop de morts au détriment de l’État. Il va sans dire que Pascal ne peut approuver cette raison, qui est purement politique et relève de l’ordre social, pour justifier une décision négative purement pragmatique.
On rencontre ici un cas où une référence est littéralement exacte, en ce sens qu’on y trouve les mots expressis verbis, mais fausse dans la mesure où il n’est pas question du sujet considéré. La discussion peut alors porter non pas sur le fond, mais sur les références elles-mêmes : peut-on alléguer un passage dont la référence n’est pas donnée, pour soutenir un passage dont la référence est donnée ?
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol. Réponse au grief de falsification.
Il s’agit du texte de LESSIUS, De justitia et jure, Livre II, ch. IX, dub. 12, Utrum pro defensione pudicitiae et honoris, liceat occidere eum, qui tentat violare, n°79 à 81. Les n. 79-80 y traitent la question de savoir si on peut se venger d’avoir reçu une gifle (alapa) en tuant le coupable qui s’enfuit. Comme l’écrit Pascal, Lessius « traite la question, savoir si on peut tuer pour un soufflet au n. 79 et il la finit au nombre 80, sans qu’il y ait en tout cela un seul mot de condamnation ». Dans le n. 81-82, il est question de savoir s’il est permis de tuer pour éviter l’infamie, ad vitandam infamiam ; Pascal note donc que, la précédente question conclue, « il en commence une nouvelle en l’article 81, savoir si on peut tuer pour des médisances », et c’est sur elle qu’il conclut par une condamnation.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol. Réponse au grief de falsification.
REGUIG-NAYA Delphine, « Pratiques herméneutiques dans les Provinciales », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 211-224. Voir p. 220 sur ce passage sur le sens de Lessius.
XIII, 5. Il traite la question, savoir si on peut tuer pour un soufflet, au n. 79, et il la finit au nombre 80, sans qu’il y ait en tout cela un seul mot de condamnation.
Voir GEF V, p. 62 sq., le passage en question du De justitia et jure de Lessius. Il correspond au Dubium XII, Utrum pro defensione pudicitiae et honoris liceat occidere eum qui tentat violare ? Le n. 79, GEF V, p. 63, examine le cas Ad alapam vitandam, dans les termes qui suivent : « Tertio, si illata alicui alapa, cesses, vel etiam fugias ; multi DD. censent in hoc casu, si vir nobilis vel honoratus hujusmodi injuria sit affectus, posse statim repercutere, vel fugientem insequi, et tantum infligere verberum vel vulnerum, quantum putatur necessarium ad honorem recuperandum. Ita tenet Navarr. C. 15 num. 4. Henriquez de Irregularitate cap. 10. ubi citat multos pro hac sententia. (...) Idem tenet Victoria, relect. De Jure belli num. 5 ; ubi dicit, eum, qui colaphum accepti, posse statim repercutere, etiam gladio ; non ad sumendum vindictam, sed ad vitandam infamiam et ignominiam, etiamsi invasor non esset ulterius progressurus. Unde sequitur, si ille fugiat, posse laesum statim insequi, et percutere : si enim potest repercutere manentem, cur non fugientem ? »
Le n. 80, cité in GEF V, p. 64, donne : « Ob has rationes haec sententia est speculative probabilis ; tamen in praxi non videtur facile permittenda. Primo, ob periculum odii, vindictae et excessus… » Le P. Nouët pourrait objecter que c’est bien là « un… mot de condamnation ». Mais Pascal répondrait que la clause non videtur facile permittenda ne constitue pas une défense réelle.
Sur le mot quoque allégué par le P. Nouët, qui selon Cognet, p. 238, montre que la réprobation exprimée dans le n. 82 s’étend aux précédents numéros, voir plus bas. En fait, il n’est pas évident que cette réprobation remonte plus haut que le n. 81. L’expression aux précédents numéros est discutable.
XIII, 5. Cette question étant terminée, il en commence une nouvelle en l’article 81, savoir si on peut tuer pour des médisances. Et c’est sur celle-là qu’il dit, au n. 82, ces paroles que vous avez citées : J’en condamne la pratique.
Le texte donne Ad vitandam infamiam. En fait, il est question de falsis criminationibus, ce qui suppose que l’on veut se venger de calomnies plutôt que de médisances.
C’est dans le n°82 que l’on trouve l’expression de la réprobation : « n. 82. Verum haec quoque sententia mihi in praxi non probatur ; quia multis occultis caedibus cum magna Reip. perturbatione praeberet occasionem ». Il est cité dans GEF V, p. 65. Il y a une différence entre le « in praxi non videtur facile permittenda » du n. 80, et le « verum haec quoque sententia mihi in praxi non probatur » du n. 82 sur le n. 81, c’est-à-dire entre on ne peut pas permettre facilement et je désapprouve cette proposition.
L’opinion rapportée par Lessius aux n. 81 et 82 sur le meurtre des calomniateurs a été condamnée par Rome. Voir Denzinger, Heinrich, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, éd. P. Hünemann, Bologne, Edizioni Dehoniane, 2003, p. 814, n°2130, « Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter haec ignomina vitari nequit : idem quoque dicendum, si quis impingat alapam vel fuste percutiat et post impactam ictum fustis fugiat ».
La condamnation dans la pratique se trouve dans le n°82 : « Verum haec quoque sententiam mihi in praxi non probatur ; quia multis occultis caedibus cum magna Reipub. perturbatione praeberet occasionem » : p. 99 ; le mot quoque a donné lieu à discussion. Voir l’éd. Cognet, p. 238, n. 5, sur le quoque qui se trouve dans le texte de Lessius, et qui est censé étendre la réprobation exprimée dans le n. 82 aux précédents, où se trouve l’opinion que discute Pascal. L’argument a été pris dans le commentaire de l’abbé Maynard, Les Provinciales et leur réfutation, t. 2, Paris, F. Didot, 1851, p. 135, n. 1, qui écrit que « traitant du meurtre pour calomnie », [Lessius] « en condamne absolument la pratique, n’étant gêné là par aucune autorité : Haec quoque sententia non est sequenda. Remarquez la liaison haec quoque, qui montre bien que Lessius rejette également le droit de défense meurtrière en ces deux circonstances. Le P. Nouët n’avait donc fait rien de honteux en accusant Pascal de défense meurtrière en ces deux circonstances ».
L’abbé Maynard n’a sans doute pas pris la peine de vérifier les textes, car dans le n. 82, on trouve bien le haec quoque, mais dans la formule « verum haec quoque sententia mihi in praxi non probatur », et non pas Haec quoque sententia non est sequenda, qui semble bien être une invention ad hoc.
Comme on sait, dans une énumération, le démonstratif hic, haec, hoc, renvoie à ce qui précède (GAFFIOT, Dictionnaire latin-français, et ERNOUT Alfred et THOMAS François, Syntaxe latine, p. 187 sq.). Dans le cas présent, comme Pascal l’indique, verum haec quoque ne signifie pas une proposition qui suit, mais le n. 81, Ad vitandam infamiam. Il n’y a pas de raison de faire porter le mot quoque sur les n°79-80.
Voir plus bas, dans XIII, 8, un complément d’argumentation contre Lessius et le p. Nouët sur ce sujet.
Pascal revient sur la question dans la Provinciale XIII, 8, ci-dessous : « XIII, 8. Vous vouliez encore faire dire à Lessius qu’il en condamne la pratique. Et comme je l’ai déjà dit, il ne se trouve pas une seule parole de condamnation en ce lieu-là ; mais il parle ainsi : Il semble qu’on n’en doit pas FACILEMENT permettre la pratique : in praxi non videtur FACILE PERMITTENDA. Est-ce là, mes Pères, le langage d’un homme qui condamne une maxime ? Diriez-vous qu’il ne faut pas permettre facilement, dans la pratique, les adultères ou les incestes ? Ne doit-on pas conclure au contraire que, puisque Lessius ne dit autre chose, sinon que la pratique n’en doit pas être facilement permise, son sentiment est que cette pratique peut être quelquefois permise, quoique rarement ? Et comme s’il eût voulu apprendre à tout le monde quand on la doit permettre, et ôter aux personnes offensées les scrupules qui les pourraient troubler mal à propos, ne sachant en quelles occasions il leur est permis de tuer dans la pratique, il a eu soin de leur marquer ce qu’ils doivent éviter pour pratiquer cette doctrine en conscience. Ecoutez-le, mes Pères. Il semble, dit-il, qu’on ne doit pas le permettre facilement, A CAUSE du danger qu’il [y] a qu’on agisse en cela par haine, ou par vengeance, ou avec excès, ou que cela ne causât trop de meurtres. De sorte qu’il est clair que ce meurtre restera tout a fait permis dans la pratique, selon Lessius, si on évite ces inconvénients, c’est-à-dire si l’on peut agir sans haine, sans vengeance, et dans des circonstances qui [n’]attirent pas beaucoup de meurtres. » Suit l’anecdote du soufflet de Compiègne.
Un débat analogue a eu lieu lors de l’affaire du p. Héreau en 1644. Voir GEF V, p. 65, n. 1, le passage de la première Requête de l’Université, qui reproduit le passage de Lessius, n. 81-82, d’après les écrits du P. Héreau. GEF V reproduit et traduit les n. 81-82 jusqu’à non est permittendus, pour indiquer la source des opinions du P. Héreau. Voir Hermant, Réponse à l’Apologie, p. 176 sq. « Je commence par Lessius que vous avez fort judicieusement rangé au premier rang, puisque l’on peut dire que le P. Héreau s’est contenté d’être son copiste, et qu’il est très vraisemblable que n’ayant jamais lu Bannez, ni appris cette opinion dans son origine, il s’en est fié au rapport de ce casuiste de sa compagnie, de qui il a emprunté les propres termes dont il se sert pour établir son hypothèse ». Hermant conclut, p. 180 : « Nous avons cité tout au long les paroles de ce casuiste, pour montrer par sa lecture qu’il ne condamne pas cette doctrine en elle-même, et dans la substance, mais seulement dans son accessoire, et dans ses suites : qu’il donne à entendre qu’elle n’est pas absolument mauvaise, ou plutôt qu’elle est absolument soutenable, puisque la vérité étant une, ces distinctions modernes de spéculation et de pratique ne peuvent changer sa nature. Enfin il est aisé de reconnaître par les raisons qu’il apporte pour la condamner dans la pratique, que si l’on pouvait être assuré que le meurtre clandestin d’un accusateur fût l’unique moyen qui nous restât pour empêcher un affront lorsque nous ne l’avons pas encore reçu, il permettrait ce cruel usage ».
Le fond du problème est proposé dans un passage de Hermant :
GEF V, p. 65, reproduit et traduit les n. 81-82 jusqu’à non est permittendus, pour indiquer la source des opinions du P. Héreau. Voir Hermant, Réponse à l’Apologie, p. 176 sq. « Je commence par Lessius que vous avez fort judicieusement rangé au premier rang, puisque l’on peut dire que le P. Héreau s’est contenté d’être son copiste, et qu’il est très vraisemblable que n’ayant jamais lu Bannez, ni appris cette opinion dans son origine, il s’en est fié au rapport de ce casuiste de sa compagnie, de qui il a emprunté les propres termes dont il se sert pour établir son hypothèse ». Hermant conclut, p. 180 : « Nous avons cité tout au long les paroles de ce casuiste, pour montrer par sa lecture qu’il ne condamne pas cette doctrine en elle-même, et dans la substance, mais seulement dans son accessoire, et dans ses suites : qu’il donne à entendre qu’elle n’est pas absolument mauvaise, ou plutôt qu’elle est absolument soutenable, puisque la vérité étant une, ces distinctions modernes de spéculation et de pratique ne peuvent changer sa nature. Enfin il est aisé de reconnaître par les raisons qu’il apporte pour la condamner dans la pratique, que si l’on pouvait être assuré que le meurtre clandestin d’un accusateur fût l’unique moyen qui nous restât pour empêcher un affront lorsque nous ne l’avons pas encore reçu, il permettrait ce cruel usage ».
Voir sur cette affaire GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 149.
XIII, 6. N’est-ce donc pas une chose honteuse, mes pères, que vous osiez produire ces paroles, pour faire croire que Lessius condamne l’opinion qu’on peut tuer pour un soufflet ? Et que, n’en ayant rapporté en tout que cette seule preuve, vous triomphiez là-dessus, en disant, comme vous faites : Plusieurs personnes d’honneur dans Paris ont déjà reconnu cette insigne fausseté par la lecture de Lessius, et ont appris par là quelle créance on doit avoir à ce calomniateur ?
Au lieu de on doit avoir, Nouët écrit mérite. Voir NOUËT, Impostures IV, in Réponses, 1658, p. 105-106. « Il est si faux que Lessius suive l’opinion de Victoria, qu’au contraire après l’avoir rapportée au lieu que j’ai marqué l. 2, de Just., c. 9. Dub. 12. n. 79, il déclare ensuite n. 82, qu’il en condamne la pratique, parce qu’elle donne lieu à beaucoup de meurtres secrets, qui causeraient de grands désordres dans les royaumes, parce que quand il s’agit du droit que chacun a de se défendre, il faut toujours prendre garde que l’usage n’en soit préjudiciable au public. Car alors il ne le faut pas permettre. De plus quand même cette opinion serait vraie dans la spéculation (ce qu’il n’accorde pas) toutefois à peine pourrait-elle jamais avoir lieu dans la pratique.
Plusieurs personnes d’honneur dans Paris ont déjà reconnu cette insigne fausseté par la lecture de Lessius, et ont appris par là quelle créance mérite ce calomniateur, et de quelle sorte l’on se doit fier à ce qu’il écrit dans la cinquième lettre p. 1, qu’un janséniste ne ment jamais. »
XIII, 6. Quoi ! mes pères, est-ce ainsi que vous abusez de la créance que ces personnes d’honneur ont en vous ? Pour leur faire entendre que Lessius n’est pas d’un sentiment, vous leur ouvrez son livre en un endroit où il en condamne un autre ; et comme ces personnes n’entrent pas en défiance de votre bonne foi, et ne pensent pas à examiner s’il s’agit en ce lieu-là de la question contestée, vous trompez ainsi leur crédulité.
Voir l’ouverture de la Provinciale XV, où Pascal se pose en défenseur des personnes du monde, qui étant incompétentes en théologie, ne peut que tomber dans les pièges que leur tendent les jésuites lorsqu’ils mentent sur les personnes qu’ils haïssent.
XIII, 6. Je m’assure, mes pères, que, pour vous garantir d’un si honteux mensonge, vous avez eu recours à votre doctrine des équivoques, et que, lisant ce passage tout haut, vous disiez tout bas qu’il s’y agissait d’une autre matière. Mais je ne sais si cette raison, qui suffit bien pour satisfaire votre conscience, suffira pour satisfaire la juste plainte que vous feront ces gens d’honneur quand ils verront que vous les avez joués de cette sorte.
Le procédé qui consiste à supposer que les jésuites utilisent les maximes qu’enseignent les casuistes est utilisé à plus grande échelle dans la Provinciale XV.
Voir Provinciale IX, 13. « Cela suffit sur ce sujet, et je veux maintenant vous parler des facilités que nous avons apportées pour faire éviter le péché dans les conversations et dans les intrigues du monde. Une chose des plus embarrassantes qui s’y trouve est d’éviter le mensonge ; et surtout quand on voudrait bien faire accroire une chose fausse. C’est à quoi sert admirablement notre doctrine des équivoques, par laquelle il est permis d’user de termes ambigus, en les faisant entendre en un autre sens qu’on ne les entend soi-même, comme dit Sanchez Op. mor., p. 2. l. 3 ; ch. 6. n. 13. Je sais cela, mon Père, lui dis-je. Nous l’avons tant publié, continua-t-il, qu’à la fin tout le monde en est instruit. Mais savez-vous bien comment il faut faire quand on ne trouve point de mots équivoques ? Non, lui dis-je ; Je m’en doutais bien, dit-il ; cela est nouveau : c’est la doctrine des restrictions mentales. Sanchez la donne au même lieu. On peut jurer, dit-il, qu’on n’a pas fait une chose, quoiqu’on l’ait faite effectivement, en entendant en soi-même qu’on ne l’a pas faite un certain jour, ou avant qu’on fût né, ou en sous-entendant quelque autre circonstance pareille, sans que les paroles dont on se sert, aient aucun sens qui le puisse faire connaître. Et cela est fort commode en beaucoup de rencontres, et est toujours très juste quand cela est nécessaire ou utile pour la santé, l’honneur, ou le bien. »
Voir Provinciale IX, 15. « Et il y donne encore, n. 328, un autre moyen plus sûr d’éviter le mensonge : c’est qu’après avoir dit tout haut: Je jure que je n’ai point fait cela, on ajoute tout bas, aujourd’hui; ou qu’après avoir dit tout haut: Je jure, on dise tout bas, que je dis, et que l’on continue ensuite tout haut, que je n’ai point fait cela. Vous voyez bien que c’est dire la vérité. Je l’avoue, lui dis-je ; mais nous trouverions peut-être que c’est dire la vérité tout bas, et un mensonge tout haut : outre que je craindrais que bien des gens n’eussent pas assez de présence d’esprit pour se servir de ces méthodes. »
REGUIG-NAYA Delphine, « Pratiques herméneutiques dans les Provinciales », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 211-224.
XIII, 7. Empêchez-les donc bien, mes pères, de voir mes lettres, puisque c’est le seul moyen qui vous reste pour conserver encore quelque temps votre crédit. Je n’en use pas ainsi des vôtres ; j’en envoie à tous mes amis ; je souhaite que tout le monde les voie ; et je crois que nous avons tous raison. Car enfin, après avoir publié cette quatrième imposture avec tant d’éclat, vous voilà décriés, si on vient à savoir que vous y avez supposé un passage pour un autre. On jugera facilement que, si vous eussiez trouvé ce que vous demandiez au lieu même où Lessius traite cette matière, vous ne l’eussiez pas été chercher ailleurs ; et que vous n’y avez eu recours que parce que vous n’y voyiez rien qui fût favorable à votre dessein. Vous vouliez faire trouver dans Lessius ce que vous dites dans votre imposture, p. 10, ligne 12, qu’il n’accorde pas que cette opinion soit probable dans la spéculation ; et Lessius dit expressément en sa conclusion, n. 80 : Cette opinion, qu’on peut tuer pour un soufflet reçu, est probable dans la spéculation. N’est-ce pas là mot à mot le contraire de votre discours ? Et qui peut assez admirer avec quelle hardiesse vous produisez en propres termes, le contraire d’une vérité de fait ? de sorte qu’au lieu que vous concluiez, de votre passage supposé, que Lessius n’était pas de ce sentiment, il se conclut fort bien, de son véritable passage, qu’il est de ce même sentiment.
Crédit : Croyance, réputation, estime qu’on s’acquiert dans le public par sa vertu, sa probité, sa bonne foi et son mérite (Furetière). Mais on trouve aussi le sens moins élogieux suivant : Puissance, autorité, faveur qu’on s’acquiert par le moyen de cette réputation qu’on a acquise. Furetière ne pense pas à signaler que cette influence s’obtient aussi par la brigue et l’intrigue. Le crédit désigne en ce sens la puissance que l’on acquiert par le soutien des personnages haut placés, qui n’est pas nécessairement l’effet du mérite.
Supposer : tenir une chose pour vraie, la donner pour certaine. Le mot se prend parfois en mauvaise part, et alors il signifie faire une fausse allégation ou une fausse accusation.
Qu’il n’accorde pas que cette opinion soit probable dans la spéculation : référence et citation exactes. Texte de Lessius, n. 80. « Ob has rationes haec sententia est speculative probabilis ; tamen in praxi non videtur facile permittenda. Primo, ob periculum odii, vidictae et excessus : si enim D. Aug. ob has causas aegre admittit, ut quis pro vita tuenda alterum possit occidere ; quanti minus in tali casu, ob honorem tuendum concederet ? Secundo, ob periculum pugnarum et tædium. Unde qui tali casu occideret, puniretur in foro externo, ut docet Gomez supra n. 24. Etsi mitius ; tum quia alter dedit causam ; tum quia homo intenso dolore permotus, non est omnino sui compos ».
Cette opinion, qu’on peut tuer pour un soufflet reçu, est probable dans la spéculation : haec sententia est speculative probabilis. Cas où une référence permet un mensonge clair sur une question de fait.
XIII, 8. Vous vouliez encore faire dire à Lessius qu’il en condamne la pratique. Et comme je l’ai déjà dit, il ne se trouve pas une seule parole de condamnation en ce lieu-là ; mais il parle ainsi : Il semble qu’on n’en doit pas FACILEMENT permettre la pratique : in praxi non videtur FACILE PERMITTENDA. Est-ce là, mes Pères, le langage d’un homme qui condamne une maxime ? Diriez-vous qu’il ne faut pas permettre facilement, dans la pratique, les adultères ou les incestes ? Ne doit-on pas conclure au contraire que, puisque Lessius ne dit autre chose, sinon que la pratique n’en doit pas être facilement permise, son sentiment est que cette pratique peut être quelquefois permise, quoique rarement ? Et comme s’il eût voulu apprendre à tout le monde quand on la doit permettre, et ôter aux personnes offensées les scrupules qui les pourraient troubler mal à propos, ne sachant en quelles occasions il leur est permis de tuer dans la pratique, il a eu soin de leur marquer ce qu’ils doivent éviter pour pratiquer cette doctrine en conscience. Ecoutez-le, mes Pères. Il semble, dit-il, qu’on ne doit pas le permettre facilement, A CAUSE du danger qu’il [y] a qu’on agisse en cela par haine, ou par vengeance, ou avec excès, ou que cela ne causât trop de meurtres. De sorte qu’il est clair que ce meurtre restera tout a fait permis dans la pratique, selon Lessius, si on évite ces inconvénients, c’est-à-dire si l’on peut agir sans haine, sans vengeance, et dans des circonstances qui [n’]attirent pas beaucoup de meurtres.
Voir plus haut sur ce texte et cet argument. Pascal comble ici une lacune de sa précédente argumentation.
In praxi non videtur facile permittenda: citation exacte selon Cognet, Provinciales, p. 240. Texte de Lessius, n. 80. « Ob has rationes haec sententia est speculative probabilis ; tamen in praxi non videtur facile permittenda. Primo, ob periculum odii, vidictae et excessus : si enim D. Aug. ob has causas aegre admittit, ut quis pro vita tuenda alterum possit occidere ; quanti minus in tali casu, ob honorem tuendum concederet ? Secundo, ob periculum pugnarum et tædium. Unde qui tali casu occideret, puniretur in foro externo, ut docet Gomez supra n. 24. Etsi mitius ; tum quia alter dedit causam ; tum quia homo intenso dolore permotus, non est omnino sui compos ».
A CAUSE du danger qu’il [y] a qu’on agisse : le y manque dans l’édition de 1659, sans doute par faute d’impression.
Théorie et pratique
NOUËT, Réponse à la XIIIe lettre, in Réponses, éd. de 1658, p. 334 sq. La distinction entre spéculation et pratique est très ancienne ; voir saint Paul, I Cor. VIII. Elle serait de Cajetan : p. 335, et ce n’est nullement un secret des jésuites. Définition des opinions probables dans la théorie et dans la pratique : p. 343.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 319 sq. Sur la distinction entre le probable en pratique et le probable en spéculation. Présupposés de la doctrine : elle est sans préjudice du conseil évangélique ; on ne cherche pas ce qui est le plus parfait, ni les obligations étroites, mais ce qui est permis et non pas défendu. Pour l’explication du in praxi tamen non est sequenda, voir p. 325. La casuistique est une science de pratique ; toutes les conclusions qui ne sont que de pure spéculation ne sont pas proprement des conclusions morales, ce ne sont pas des décisions : « elles sont sans conséquence pour les mœurs, parce qu’elles n’en sont point la règle. »
WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, II, éd. de 1700, p. 278. En quel sens Montalte condamne la distinction entre la spéculation et la pratique : il se plaint non pas de la distinction en elle-même, mais de ce qu’elle serve à excuser des meurtres ; on détruit par là la loi de Dieu, et « ce principe supposé, les hommes ne s’abstiendront plus du meurtre qu’à cause de certaines circonstances, qu’il ne leur sera pas difficile de changer quand ils le voudront. »
PETITDIDIER Mathieu, Apologie des Lettres Provinciales, II, p. 193 sq. Discussion des principes du P. Daniel, que les propositions que les casuistes déclarent probables en spéculation le sont « par rapport aux principes généraux dont on les tire » : p. 194 sq. Il montre que dire qu’une proposition est probable en spéculation revient à dire qu’elle est « conforme à la loi de Dieu » : p. 195. Analyse de ce que donne la substitution de la définition au défini.
XIII, 8. En voulez-vous un exemple, mes pères ? En voici un assez nouveau ; c’est celui du soufflet de Compiègne. Car vous avouerez que celui qui l’a reçu a témoigné, par la manière dont il s’est conduit, qu’il était assez maître des mouvements de haine et de vengeance. Il ne lui restait donc qu’à éviter un trop grand nombre de meurtres ; et vous savez, mes pères, qu’il est si rare que des jésuites donnent des soufflets aux officiers de la maison du roi, qu’il n’y avait pas à craindre qu’un meurtre en cette occasion en eût tiré beaucoup d’autres en conséquence. Et ainsi vous ne sauriez nier que ce jésuite ne fût tuable en sûreté de conscience, et que l’offensé ne pût en cette rencontre pratiquer envers lui la doctrine de Lessius.
Le soufflet de Compiègne
10 septembre 1656. Date approximative du soufflet de Compiègne donné par le P. Borin à M. Guille.
Sur Guille, voir le Dictionnaire de Port-Royal, p. 495. Notice. "Le fameux traiteur" Guille, officier de cuisine du roi, qui "se piquait de dévotion", est mentionné dans FONTAINE, Mémoires, I, p. 9. Guille préparait par ordre royal à dîner pour la reine Christine de Suède, dans le collège des jésuites de Compiègne. La reine Christine séjourne à Compiègne du 10 au 12 septembre 1656. Sur le jugement très sévère que fait la reine Christine des jésuites, qu’elle dit au P. Annat, voir ARNAULD Antoine, Œuvres, I, p. 148. Lettre LXXI, p. 149.
Pascal revient sur le soufflet probable dans la Provinciale XIV, 27, éd. Cognet, p. 274.
Voir la Note unique sur la treizième lettre de WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, II, p. 260. WENDROCK, Litterae Provinciales, p. 339 donne l’explication suivante dans le texte même de la XIIIe Provinciale : "Nostis ut Compendii nuper coquorum regiorum praefecto nomine Guillio, Christinae Sueciae reginae in collegio vestro Regis jussu prandium paranti Pater Borinus violari aedes suas ratus gravem alapam infregerit".
« Le fameux traiteur » Guille, officier de cuisine du roi, qui « se piquait de dévotion », est mentionné dans FONTAINE, Mémoires, I, p. 9, et RAPIN René, Mémoires, I, éd. Aubineau, p. 404. Il préparait par ordre royal à dîner pour la reine Christine de Suède, dans le collège des jésuites de Compiègne. La reine Christine séjourne à Compiègne du 10 au 12 septembre 1656. Sur le jugement très sévère que fait la reine Christine des jésuites, qu’elle bonnit au p. Annat, voir ARNAULD, Œuvres, I, p. 148. Lettre LXXI, p. 149.
RAPIN René, Mémoires, I, p. 404. En note : discussion sur l’identité de Guille. Rapin dit que Guille sert des plats friands à ses mais jansénistes, mais c’est probablement une calomnie, car il veut montrer, dans ce passage, que la doctrine janséniste ôtant tout espoir de salut, elle pousse les fidèles à s’adonner aux plaisirs de la chair.
OC III, éd. J. Mesnard, p. 1053; GEF VI, p. 95. Lettre de Saint-Gilles pour Périer du 27 octobre 1656, sur la question de savoir si le soufflet a été donné du plat ou du dos de la main. Sur le soufflet de Compiègne, et sur la question de savoir si le soufflet a été donné du plat ou du dos de la main. « Les bons pères, par une Réponse à la treizième (que je diffère à vous envoyer pour vous en envoyer en même temps la réfutation) nient le soufflet de Guille, qui cependant est indubitable. La seule difficulté est de savoir si ça été d’avant ou derrière main » : p. 1053.
NOUËT Jacques, Réponse à la XIIIe lettre, slnd (octobre 1656), 8 p. in 4° ; texte in Réponses, p. 230 sq. ; voir GEF VI, p. 118.
GEF VI, p. 25, n. 6.
FONTAINE Nicolas, Mémoires, éd. Thouvenin, Champion, 2001, p. 240.
Lettre de Saint-Gilles à Florin Périer du 27 octobre 1656, in BAUDRY DE SAINT-GILLES D’ASSON Antoine, Journal d’un solitaire de Port-Royal, éd. Ernst et Lesaulnier, Paris, Nolin, 2008, p. 254 sq.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol.
Officiers : le mot n’a aucun sens militaire. Il désigne un domestique qui a soin de la table dans une maison particulière ; c’est un maître d’hôtel, qui s’occupe de l’office.
Voir la Note unique sur la treizième lettre de WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, II, p. 260. « L’Apologiste après avoir nié avec une hardiesse surprenante une chose connue de toute la France, c’est-à-dire le soufflet qu’un de ses confrères donna à Compiègne à un nommé M. Guille comme le rapporte Montalte, il continue dans le reste de sa lettre à excuser par de vaines subtilités les excès dont Montalte a convaincu leurs Auteurs. » Nicole ne s’intéresse guère à cet épisode, et se contente de le mentionner, en précisant
WENDROCK, Litterae Provinciales, p. 339 donne l’explication suivante dans le texte même de la XIIIe Provinciale: « Nostis ut Compendii nuper coquorum regiorum praefecto nomine Guillio, Christinae Sueciae reginae in collegio vestro Regis jussu prandium paranti Pater Borinus violari aedes suas ratus gravem alapam infererit ». Tr. : « Vous savez qu’à Compiègne récemment, le chef des cuisiniers du roi, nommé Guille, préparant dans votre collège, par ordre du roi, un repas pour la reine Christine de Suède, reçut un soufflet bien appliqué dy P. Borin, lequel se croyait victime d’une violation de domicile ». L’intérêt de ce passage est dans le fait que Nicole donne les noms de Guille, de Borin et de Christine de Suède, que Pascal ne donnait pas.
OC III, éd. J. Mesnard, p. 1053 ; GEF VI, p. 95. Lettre de Saint-Gilles pour Périer du 27 octobre 1656, sur la question de savoir si le soufflet a été donné du plat ou du dos de la main. « Les bons pères, par une Réponse à la treizième (que je diffère à vous envoyer pour vous en envoyer en même temps la réfutation) nient le soufflet de Guille, qui cependant est indubitable. La seule difficulté est de savoir si ça été d’avant ou derrière main. »
Provinciales, éd. Cognet, p. 241. Pascal revient sur le soufflet probable dans la Provinciale XIV, 27, éd. Cognet, p. 274.
XIII, 8. Et peut-être, mes pères, qu’il l’eût fait, s’il eût été instruit dans votre école, et s’il eût appris d’Escobar qu’un homme qui a reçu un soufflet est réputé sans honneur jusqu’à ce qu’il ait tué celui qui le lui a donné.
GEF VI, p. 26, remarque qu’on a objecté à Pascal que Guille n’étant pas noble, il ne pouvait se prévaloir de la doctrine de Lessius.
Texte déjà utilisé dans Provinciale VII, 12.
ESCOBAR, Theologia moralis, Tr. I, Ex. VII, n. 47, p. 120. “An liceat post impactam alapam percutientem insequi, et interimere? Aliqui negant; quia id esset injuriam vidicare, non defendere. At Lessius lib. 2. cap. 9. dub. 12. num. 80. licere existimat speculative, sed in praxi non consulendum ob periculum odii, vindictae, et excessum pugrnarum et caedium in Reipublicae pernitiem. Alii seclusis his periculis in praxi probabilem, et tutam judicarunt. Henriquez lib. 14. cap. 10. num. 3. Ratio est, quia quandiu damnum illatum manet insuspenso, semper est locus defensioni, ut patet in eo, qui furem insequitur fugientem, ad recuperandum ablatum. Nam quamvis honor non sit apud percussorem sicut ablata res apud furem, potest tamen non secus ac res furtiva recuperari, ostendendo signa excellentiae et aestimationem apud homines captando. At non alapa percussus censetur tamdiu honore privatus, quamdiu adversarium non interimit? »
Voir Provinciale VII, 6, Lessius d’après Victoria: « Celui qui a reçu un soufflet ne peut avoir l’intention de s’en venger... »
Ce passage rappelle l’histoire l’affaire de Jean d’Alba dans le VIe Provinciale : Pascal retourne contre les jésuites les opinions probables, en imaginant ce qui aurait pu se passer, ou ce qui s’est passé réellement, lorsque l’on tourne les probabilités contre leurs promoteurs.
XIII, 8. Mais vous avez sujet de croire que les instructions fort contraires qu’il a reçues d’un curé que vous n’aimez pas trop, n’ont pas peu contribué en cette occasion à sauver la vie à un Jésuite.
Henri Duhamel, un curé que vous n’aimez pas trop
Henri Duhamel, 1612-1682, curé de Saint-Merry depuis 1644 ; voir Provinciales, éd. Cognet, p. 242, n. 2. Voir LESAULNIER Jean, Port-Royal insolite. Édition critique du Recueil de choses diverses, Klincksieck, Paris, 1992, 932 p. Notice p. 586 et 772.
Dictionnaire de Port-Royal, p. 366. Notice biographique. Sur la manière dont il conduit la paroisse de Saint-Maurice-sur-Aveyron, et la manière dont il agit à Saint-Merri, voir p. 366. Il prêche et établit des cours d’instruction pour le clergé, auxquels participent des docteurs, des magistrats, des prêtres et parfois des évêques. Ses relations avec Port-Royal et leur évolution : p. 566-567. Difficultés dans les relations avec son collègue Edme Amyot : p. 567.
SAINT-GILLES Journal, in JOVY Ernest, Etudes pascaliennes, IX, Le Journal de M. de Saint-Gilles, Vrin, Paris, 1963, 208 p. Biographie en introduction. Sur sa place à Port-Royal, voir p. IX-X. Voir p. 50, sur son exil à Langres et à Quimper.
BAUDRY DE SAINT-GILLES D’ASSON Antoine, Journal d’un solitaire de Port-Royal, éd. Ernst et Lesaulnier, Paris, Nolin, 2008, p. 44 sq. Exil de Duhamel : p. 87 sq.
LANCELOT Claude, Mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran, éd. Donetzkof, Nolin, p. 379.
RAPIN René, Mémoires, éd. Aubineau, I, p. 61. Nommé curé de Saint-Merry, il organise la pénitence publique, selon la règle de Saint-Cyran.
XIII, 9. Ne nous parlez donc plus de ces inconvénients qu’on peut éviter en tant de rencontres, et hors lesquels le meurtre est permis, selon Lessius, dans la pratique même. C’est ce qu’ont bien reconnu vos auteurs, cités par Escobar dans la pratique de l’homicide selon votre Société : Est-il permis, dit-il, de tuer celui qui a donné un soufflet ? Lessius dit que cela est permis dans la spéculation, mais qu’on ne le doit pas conseiller dans la pratique, non consulendum in praxi, à cause du danger de la haine ou des meurtres nuisibles à l’Etat qui en pourraient arriver. MAIS LES AUTRES ONT JUGÉ QU’EN ÉVITANT CES INCONVÉNIENTS CELA EST PERMIS ET SÛR DANS LA PRATIQUE : in praxi probabilem et tutam judicarunt Henriquez, etc. Voilà comment les opinions s’élèvent peu à peu jusqu’au comble de la probabilité.
Texte déjà utilisé dans Provinciale VII, 12, éd. Cognet, p. 123.
Voir au paragraphe précédent.
ESCOBAR, Theologia moralis, Tr. I, Ex. VII, n. 47, p. 120. “An liceat post impactam alapam percutientem insequi, et interimere? Aliqui negant; quia id esset injuriam vidicare, non defendere. At Lessius lib. 2. cap. 9. dub. 12. num. 80. licere existimat speculative, sed in praxi non consulendum ob periculum odii, vindictae, et excessum pugrnarum et caedium in Reipublicae pernitiem. Alii seclusis his periculis in praxi probabilem, et tutam judicarunt. Henriquez lib. 14. cap. 10. num. 3. Ratio est, quia quandiu damnum illatum manet in suspenso, semper est locus defensioni, ut patet in eo, qui furem insequitur fugientem, ad recuperandum ablatum. Nam quamvis honor non sit apud percussorem sicut ablata res apud furem, potest tamen non secus ac res furtiva recuperari, ostendendo signa excellentiae et aestimationem apud homines captando. At non alapa percussus censetur tamdiu honore privatus, quamdiu adversarium non interimit? »
Noter qu’on peut demander à quelqu’un d’autre de tuer celui qui vous a donné un soufflet. Il y a des exemples célèbres, notamment dans Le Cid.
XIII, 9. Car vous y avez porté celle-ci, en la permettant enfin sans aucune distinction de spéculation ni de pratique, en ces termes : Il est permis, lorsqu’on a reçu un soufflet, de donner incontinent un coup d’épée, non pas pour se venger, mais pour conserver son honneur. C’est ce qu’ont enseigné vos pères à Caen, en 1644, dans leurs écrits publics, que l’Université produisit au Parlement lorsqu’elle y présenta sa troisième requête contre votre doctrine de l’homicide, comme il se voit en la p. 339 du livre qu’elle en fit alors imprimer.
Il est permis, lorsqu’on a reçu un soufflet, de donner incontinent un coup d’épée, non pas pour se venger, mais pour conserver son honneur... : Voir Provinciale VII, 12, éd. Cognet, p. 124, n. 4, sur les p. Flahaut et Lecourt, jésuites professeurs à Caen, auxquels on reprochait des thèses semblables à celles du p. Héreau. Il n’est pas question de ces pères dans le texte de la Troisième requête de l’Université, 7 décembre 1644, reproduite in Annales des soi-disant jésuites, III, p. 930 ; voir la Réponse de l’Université rédigée par Hermant et publiée en même temps. Sur cette Réponse de l’Université de Godefroy Hermant, voir GEF V, p. 59 sq., qui fournit des passages.
XIII, 10. Remarquez donc, mes pères, que vos propres auteurs ruinent d’eux-mêmes cette vaine distinction de spéculation et de pratique que l’Université avait traitée de ridicule, et dont l’invention est un secret de votre politique qu’il est bon de faire entendre. Car, outre que l’intelligence en est nécessaire pour les 15e, 16e, 17e et 18e impostures, il est toujours à propos de découvrir peu à peu les principes de cette politique mystérieuse.
Intelligence : compréhension.
Que faut-il entendre par politique des jésuites ?
Un politique est, selon Furetière, « celui qui sait l’art de gouverner, qui est habile dans les négociations, dans les intrigues d’État. La politique est l’art de gouverner l’État, et en un sens élargi, tout corps constitué plus ou moins officiel. Mais il faut y ajouter quel la politique est aussi le service de l’État, ou la partie de la morale qui met tout au service de l’État. Dans le cas des jésuites, la politique est l’ensemble des moyens comme la prédication, les confessions, les influences mondaines et les pratiques que Pascal dénonce dans les Provinciales, mis au service de la puissance de la Compagnie, et soi-disant de la puissance pontificale. Cela englobe aussi les moyens qui relèvent de la politique au sens ordinaire.
Voir la Provinciale XV, où Pascal montre que les jésuites détruisent eux-mêmes leurs propres calomnies.
XIII, 11. Quand vous avez entrepris de décider les cas de conscience d’une manière favorable et accommodante, vous en avez trouvé où la religion seule était intéressée, comme les questions de la contrition, de la pénitence, de l’amour de Dieu, et toutes celles qui ne touchent que l’intérieur des consciences. Mais vous en avez trouvé d’autres où l’État a intérêt aussi bien que la religion, comme sont celles de l’usure, des banqueroutes, de l’homicide, et autres semblables ; et c’est une chose bien sensible à ceux qui ont un véritable amour pour l’Église, de voir qu’en une infinité d’occasions où vous n’avez eu que la religion à combattre, vous en avez renversé les lois sans réserve, sans distinction et sans crainte, comme il se voit dans vos opinions si hardies contre la pénitence et l’amour de Dieu, parce que vous saviez que ce n’est pas ici le lieu où Dieu exerce visiblement sa justice. Mais dans celles ou l’État est intéressé aussi bien que la religion, l’appréhension que vous avez eue de la justice des hommes vous a fait partager vos décisions, et former deux questions sur ces matières : l’une que vous appelez de spéculation, dans laquelle, en considérant ces crimes en eux-mêmes, sans regarder à l’intérêt de l’État, mais seulement à la loi de Dieu qui les défend, vous les avez permis sans hésiter, en renversant ainsi la loi de Dieu qui les condamne ; l’autre, que vous appelez de pratique, dans laquelle, en considérant le dommage que l’État en recevrait, et la présence des magistrats qui maintiennent la sûreté publique, vous n’approuvez pas toujours dans la pratique ces meurtres et ces crimes que vous trouvez permis dans la spéculation, afin de vous mettre par là à couvert du côté des juges.
Le texte initial vous en avez renversé les lois sans aucune crainte, sans réserve, et sans distinction, comme il se voit dans vos opinions si hardies contre la pénitence et l’amour de Dieu... a été remplacé par la suite par : Vous en avez renversé les lois sans réserve, sans distinction et sans crainte, comme il se voit dans vos opinions si hardies contre la pénitence et l’amour de Dieu, parce que vous saviez que ce n’est pas ici le lieu où Dieu exerce visiblement sa justice.
Pensées, Laf. 969, Sel. 801. « Politique. Nous avons trouvé deux obstacles au dessein de soulager les hommes : l’un, des lois intérieures de l’Évangile, l’autre, des lois extérieures de l’Etat et de la Religion. Les unes, nous en sommes maîtres ; les autres, voici comment nous avons fait : amplianda, restringenda, a majori ad minus. »

FERREYROLLES Gérard, Pascal et la raison du politique, p. 54. En fait, dans l’esprit de Pascal, l’État n’est pas moins menacé par les pratiques des casuistes et des jésuites que l’Église : p. 55. L’État est considéré par la société de Jésus comme un obstacle à l’accomplissement de ses desseins : p. 56.
NOUËT Jacques, Réponse à la XIIIe lettre, in Réponses, p. 336 sq. Contre l’idée que les Jésuites croient que leur crédit dans l’Église empêchera qu’on ne punisse leurs attentats contre la vérité.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol. Contestation de la politique des jésuites.
XIII, 11. C’est ainsi, par exemple, que, sur cette question, s’il est permis de tuer pour des médisances, vos auteurs, Filiutius, tr. 29, cap. 3, num. 52 ; Reginaldus, l. 21, cap. 5, num. 63, et les autres répondent : Cela est permis dans la spéculation, ex probabili opinione licet ; mais je n’en approuve pas la pratique, à cause du grand nombre de meurtres qui en arriveraient et qui feraient tort à l’Etat, si on tuait tous les médisants ; et qu’aussi on serait puni en justice en tuant pour ce sujet. Voilà de quelle sorte vos opinions commencent à paraître sous cette distinction, par le moyen de laquelle vous ne ruinez que la religion, sans blesser encore sensiblement l’État.
Textes déjà utilisés dans la VIIe Provinciale, 15-16. Voir Filiutius, Moralium quaestionum de chrisitianis officiis et casibus conscientiae, tr. 29, cap. 3, num. 52, Lugduni, 1626, p. 360. Voir GEF V, p. 68 sq. et 101 sq. « 52. Neque si tantum detrahat. Dico quarto. Eodem modo si quis detrahat falsis criminationibus apus viros honoratos, licet ex probabili opinione Pot. Nau. & Bannes possit occidi, quando aliter famae damnum averti non potest : attamen practice contrarium est sequendum ; tum quia si fama sublata est, non recuperatur per mortem detractoris ; si non est sublata, fere semper aliis modis impediri potest ; tum quiia aperiretur via caedibus, et majora mala in Republica ea sequerentur, ut etiam fatetur Less. n. 82 »
Texte de Regnault, REGINALDUS, Praxis fori paenitentialis…, l. 21. n. 63, t. 2, Milan, 1619, p. 204. « Ac cum haec ita sint, patet illud rationem defensionis, non vindictae habere, quod homo militaris eum a quo vulneratus est insequatur, non quidem ut malum pro malo reddat, sed ut conservet honorem sibi ablatum, dummodo tamen id fiat incontinenti, cum res adhuc est in suspenso, non autem postquam is qui abstulit, domum se jam recepit, vel alia negotia gerit, juxta dicenda in explicatione sequentis difficultatis de latrone qui rem alienam, ablatam jam quiete domi habet : utriusque enim par est ratio, ut bene monet Petrus a Navarr. in eod. cap. 387. Addens consequenter, quod est observatione dignum, eum qui juste percutitur in talibus casibus, non habere jus resistendi : quia daretur alioqui bellum ex utraque parte justum seclusa ignorantia : non debere tamen sinere se occidi, sed petendo veniam, vel aliter satisfacere. Quod si faciat, nec alter cessare velit, injuste invadetur, et sic poterit invasorem offerendo, se defendere. Quod autem Sotus objicit non asportari honorem, sicut asportantur res quae in insecutione recuperantur, parvi momenti est. Nam etsi eae non adsportarentur a fure, qui illas abjecisset in flumen, posset tamen damnum passus, talem non minus, quam de facto asportantem insequi, ut tantumdem restituere cogat. De qua re idem Petrus a Navarr. in eod. cap. 3 num. 384 & quatuor sequentibus.
Caeterum quidquid sit in speculatione, non videtur in praxi permittenda facile ejusmodi insecutio ob periculum odii, vindictae, excessus pugnarum, et caedium in reip. perniciem : quam semper vitare oportet in usu defensionis : juxta illud quod recta ratio dictat, bonum commune esse privato anteferendum. Ex quo fundamento solvitur difficultas, quam idem a Navarr. movet in praeced. num. 375. Num si detractor meam honestam famam denigrare nitatur, nec possum illud notabile damnum famae alia ratione avertere, quam interficiendo ipsum occulte : idne licite possim. Nam quamvis in speculatione pars affirmans non careat omni probabilitate: in praxis tamen negans est sequenda: quia in jure defensionis, sempe considerandum est, ne usus illius vergat in reipu. perniciem, nec dubium est quin sequendo affirmantem, praebeatur occasio multis caedibus occultis, cum magna reipublicae perturbation. Accedit quod si illata, ea non extinguatur per mortem infamantis: sin inferenda sit, plerumque non satis constat, possitne alia ratione impediri, quam occisione infamaturi, sicque non sit liberum eo genere defensionis uti ».
Tr. de l. 21. n. 63. p. 204 : « Encore que cette opinion qu’on peut tuer pour une médisance, ne soit pas sans probabilité dans la théorie, il faut suivre le contraire dans la pratique. Car il faut toujours éviter le dommage de l’État dans la manière de se défendre. Or il est visible qu’en tuant le monde de cette sorte, il se ferait un trop grand nombre de meurtres. Lessius en parle de même au lieu déjà cité. Il faut prendre garde que l’usage de cette maxime ne soit nuisible à l’État, car alors il ne faut pas le permettre, tunc enim non est permittendus. »
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, éd. de 1697, Donato Donati, p. 325 sq. Pourquoi Reginaldus pense que sa décision ne doit pas être reçue en pratique. Elle susciterait selon lui à de grands excès dans la société.
La parenté des textes précédents est frappante avec LESSIUS Leonard, De justitia et jure, Lib. II, Dub. XII, n. 81, Ad vitandam infamiam, éd. de 1628, p. 99, et n. 82, p. 99, la réserve « verum haec quoque sententia mihi in praxi non probatur, quia multis occultis caedibus cum magna Reip. perturbatione praeberet occasionem. In Jure enim defensionis semper considerandum, ne ejus usus in perniciem Reipub. vergat : tunc enim non est permittendus. Accedit, quod etsi speculative vera esset, tamen vix in praxis posset habere locum ». Voir GEF V, p. 64 sq.
XIII, 11. Par là vous croyez être en assurance. Car vous vous imaginez que le crédit que vous avez dans l’Église empêchera qu’on ne punisse vos attentats contre la vérité ; et que les précautions que vous apportez pour ne mettre pas facilement ces permissions en pratique, vous mettront à couvert de la part des magistrats, qui, n’étant pas juges des cas de conscience, n’ont proprement intérêt qu’à la pratique extérieure. Ainsi une opinion qui serait condamnée sous le nom de pratique se produit en sûreté sous le nom de spéculation. Mais cette base étant affermie, il n’est pas difficile d’y élever le reste de vos maximes. Il y avait une distance infinie entre la défense que Dieu a faite de tuer, et la permission spéculative que vos auteurs en ont donnée. Mais la distance est bien petite de cette permission à la pratique. Il ne reste seulement qu’à montrer que ce qui est permis dans la spéculative l’est bien aussi dans la pratique. Or, on ne manquera pas de raisons pour cela. Vous en avez bien trouvé en des cas plus difficiles.
Contre cette idée, voir NOUËT, Réponse à la XIIIe lettre, in Réponses, p. 338 sq.
Vous vous imaginez que le crédit que vous avez dans l’Église empêchera qu’on ne punisse vos attentats contre la vérité... : NOUËT Jacques, Réponse à la XIIIe lettre, in Réponses, p. 336 sq. s’élève contre l’idée que les Jésuites croient que leur crédit dans l’Église empêchera qu’on ne punisse leurs attentats contre la vérité.
Les magistrats, qui, n’étant pas juges des cas de conscience, n’ont proprement intérêt qu’à la pratique extérieure : cette phrase précise une idée de la justice qui semble liée à la distinction des trois ordres, chair, esprit et charité. Les juges n’ont pas de compétence dans les choses de l’esprit : leur charge est entièrement bornée au for extérieur, c’est-à-dire aux actions effectives, en vue de maintenir l’ordre social et de châtier les crimes. Mais on ne connaît pas le cœur d’autrui, de sorte que les juges ne peuvent sonder les intentions des hommes. Il y a tyrannie, c’est-à-dire application dans un ordre de ce qui n’appartient qu’à un autre, à vouloir rendre les juges compétents sur les pensées et les consciences, qui sont de l’ordre de l’esprit. C’est précisément ce que font les dictatures totalitaires qui prétendent imposer une idéologie et juger les personnes en fonction de la manière dont ils acceptent cette idéologie, en les jugeant éventuellement sur des intentions qu’on leur prête, à juste titre ou non. Il est clair qu’en cela, l’actuelle conception de la justice tend à différer de celle du temps de Pascal : la recherche des intentions fait aujourd’hui partie de la pratique des procès, notamment au titre des circonstances atténuantes, à l’aide de psychologues qui ne sont pas sans ressemblances avec les casuistes. Cela ne signifie pas que cette recherche des intentions en soit devenue plus facile ni plus certaine.
XIII, 11. Voulez-vous voir, mes pères, par où l’on y arrive ? Suivez ce raisonnement d’Escobar, qui l’a décidé nettement dans le premier des six tomes de sa grande Théologie morale, dont je vous ai parlé, où il est tout autrement éclairé que dans ce recueil qu’il avait fait de vos 24 vieillards ; car, au lieu qu’il avait pensé en ce temps-là qu’il pouvait y avoir des opinions probables dans la spéculation qui ne fussent pas sûres dans la pratique, il a connu le contraire depuis, et l’a fort bien établi dans ce dernier ouvrage : tant la doctrine de la probabilité en général reçoit d’accroissement par le temps, aussi bien que chaque opinion probable en particulier. Écoutez-le donc In prœloq. n. 15. Je ne vois pas, dit-il, comment il se pourrait faire que ce qui paraît permis dans la spéculation ne le fût pas dans la pratique, puisque ce qu’on peut faire dans la pratique dépend de ce qu’on trouve permis dans la spéculation, et que ces choses ne diffèrent l’une de l’autre que comme l’effet de la cause. Car la spéculation est ce qui détermine à l’action. D’où IL S’ENSUIT QU’ON PEUT EN SÛRETÉ DE CONSCIENCE SUIVRE DANS LA PRATIQUE LES OPINIONS PROBABLES DANS LA SPÉCULATION, et même avec plus de sûreté que celles qu’on n’a pas si bien examinées spéculativement.
ESCOBAR, Universae theologiae moralis... disquisitiones, Praeloquium, cap. III, n. 15, t. I, 1652, p. 4-5 ; voir le passage dans GEF VI, p. 18. WENDROCK, Litterae Provinciales, p. 342-343, donne une citation plus complète : « Audiamus igitur illum in prologo c. 3. n. 15. ita loquentem. Plures jurisperitorum non audent in praxi opiniones Duareni, Cujacii, Donnelli, etc. et aliorum sectari ; easque theoreticas solum, non practicas vocant, tantumque ad scholarum ludum proficuas. Decipiuntur plane. Minime enim percipio aliquam opinionem esse speculative probabilem, et in praxi amplexari non posse; cum probabilitas practica ab speculativa oriatur probabilitate, ab eaque solum differat tanquam effectus à sua causa, id enim quod quis opere juste exequitur vel injuste, ab eo exoritur, quod speculative judicabit licite posse geri, cum cognitio speculativa ad opus dirigat voluntatem. Unde in praxi tuto haerescere poterit ejusmodi doctorum sententiae, imo forte securius quam aliorum, non tam theorice sapientum sensui. Nam qui theorice rem planius examinant, et fundamenta discutiunt, melius quoque regulam ad operadum demonstrabunt: alias nihil prodesset alicui, rem sanius percipere, nisi in ordine ad operandum certiorem regulam constitueret. Joan. Sanch. disput. 44 n. 63. Thom. Sanch. lib. 2 de matrim. Disput. 41 » Voir Provinciales, éd. Cognet, p. 245. C’est le seul usage que Pascal ait fait du grand ouvrage d’Escobar. Ce dernier semble d’ailleurs n’avoir guère été utilisé dans la controverse. Pascal traduit assez librement et abrège le passage. Nicole complète en ajoutant C. 3 et le donne très longuement.
Discussion dans NOUËT, Réponse à la XIIIe lettre, in Réponses, p. 344-345. D’après Escobar, dit Nouët, de ce qu’une proposition n’est pas probable dans la pratique, elle ne l’est pas dans la spéculation. Même argument dans DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, Donato Donati, éd. de 1699, p. 329 sq. On peut suivre en sûreté dans la pratique les opinions probables dans la spéculation, parce qu’avant de les appeler probables dans la spéculation, on s’assure qu’elles soient probables dans la pratique. On peut dire aussi qu’on ne peut pas suivre dans la pratique toutes les opinions qui sont probables en spéculation, parce que la qualité de probable en spéculation ne renferme pas tout ce qui est nécessaire pour être probable dans la pratique : p. 331.
XIII, 12. En vérité, mes pères, votre Escobar raisonne assez bien quelquefois. Et en effet, il y a tant de liaison entre la spéculation et la pratique, que, quand l’une a pris racine, vous ne faites plus difficulté de permettre [l’autre] sans déguisement. C’est ce qu’on a vu dans la permission de tuer pour un soufflet, qui de la simple spéculation, a été portée hardiment par Lessius à une pratique qu’on ne doit pas facilement accorder, et de là par Escobar à une pratique facile ; d’où vos pères de Caen l’ont conduite à une permission pleine, sans distinction de théorie et de pratique, comme vous l’avez déjà vu.
Effet de comique par lequel la certitude de la permission de tuer pour un soufflet, passant de casuiste en casuiste comme une balle se renforce par degrés, s’élevant de la permission qu’on ne doit pas facilement accorder à la permission pleine, sans distinction de théorie et de pratique.
XIII, 13. C’est ainsi que vous faites croître peu à peu vos opinions. Si elles paraissaient tout à coup dans leur dernier excès, elles causeraient de l’horreur ; mais ce progrès lent et insensible y accoutume doucement les hommes, et en ôte le scandale. Et par ce moyen la permission de tuer, si odieuse à l’État et à l’Église, s’introduit premièrement dans l’Église, et ensuite de l’Église dans l’État.
Provinciales, éd. Cognet, p. 246, renvoie à la Lettre d’Eusèbe à Polémarque d’Arnauld et à la 2e requête de l’Université de Paris, qui proposent des idées analogues.
Sur le progrès des maximes des casuistes, voir Premier écrit des curés de Paris, in Provinciales, éd. Cognet, p. 407 sq. « Ces opinions accommodantes ne commencèrent pas par cet excès, mais par des choses moins grossières, et qu’on proposait seulement comme des doutes. Elles se fortifièrent peu à peu par le nombre des sectateurs, dont les maximes relâchées ne manquent jamais: de sorte qu’ayant déjà formé un corps considérable de casuistes qui les soutenaient, les ministres de l’Église, craignant de choquer ce grand nombre, et espérant que la douceur et la raison seraient capables de ramener ces personnes égarées, supportèrent ces désordres avec une patience qui a paru par l’événement, non seulement inutile, mais dommageable : car, se voyant ainsi en liberté d’écrire, ils ont tant écrit en peu de temps, que l’Église gémit aujourd’hui sous cette monstrueuse charge de volumes. La licence de leurs opinions, qui s’est accrue avec le nombre de leurs livres, les a fait avancer à grands pas dans la corruption des sentiments et dans la hardiesse de les proposer. Ainsi les maximes qu’ils n’avaient jetées d’abord que comme de simples pensées furent bientôt données pour probables ; ils passèrent de là à les produire pour sûres en conscience, et enfin pour aussi sûres que les opinions contraires, par un progrès si hardi, qu’enfin les puissances de l’Église commençant à s’en émouvoir, on fit diverses censures de ces doctrines. L’Assemblée générale de France les censura en 1642, dans le livre du P. Bauny Jésuite, où elles sont presque toutes ramassées ; car ces livres ne font que se copier les uns les autres. La Sorbonne les condamna de même ; la faculté de Louvain ensuite, et feu M. l’archevêque de Paris aussi, par plusieurs censures. De sorte qu’il y avait sujet d’espérer que tant d’autorités jointes ensemble arrêteraient un mal qui croissait toujours. Mais on fut bien éloigné d’en demeurer à ce point : le P. Héreau fit, au Collège de Clermont, des leçons si étranges pour permettre l’homicide, et les PP. Flahaut et Le Court en firent de même à Caen de si terribles pour autoriser les duels, que cela obligea l’Université de Paris à en demander justice au Parlement, et à entreprendre cette longue procédure qui a été connue de tout le monde. Le P. Héreau ayant été, sur cette accusation, condamné par le Conseil à tenir prison dans le Collège des Jésuites, avec défenses d’enseigner dorénavant, cela assoupit un peu l’ardeur des casuistes ; mais ils ne faisaient cependant que préparer de nouvelles matières, pour les produire toutes à la fois en un temps plus favorable.
En effet, on vit paraître, un peu après, Escobar, le p. Lamy, Mascarenhas, Caramuel et plusieurs autres, tellement remplis des opinions déjà condamnées, et de plusieurs nouvelles plus horribles qu’auparavant, que nous, qui, par la connaissance que nous avons de l’intérieur des consciences, remarquions le tort que ces dérèglements y apportaient, nous nous crûmes obligés à nous y opposer fortement. Ce fut pourquoi nous nous adressâmes, les années dernières, à l’Assemblée du Clergé qui se tenait alors, pour y demander la condamnation des principales propositions de ces derniers auteurs, dont nous leur présentâmes un extrait. »
XIII, 14. On a vu un semblable succès de l’opinion de tuer pour des médisances. Car elle est aujourd’hui arrivée à une permission pareille sans aucune distinction.
XIII, 14. Je ne m’arrêterais pas à vous en rapporter les passages de vos pères, si cela n’était nécessaire pour confondre l’assurance que vous avez eue de dire deux fois dans votre 15. imposture, p. 26 et 30, qu’il n’y a pas un Jésuite qui permette de tuer pour des médisances.
NOUËT, Impostures XV-XVIII, in Réponses, éd. de 1658, p. 162, « tous les auteurs jésuites qui soutiennent qu’on ne peut tuer un calomniateur en sûreté de conscience » ; p. 169, « j’assure donc tous les catholiques, qu’il n’y a pas un théologien, ni jésuite ni autre, qui permet de tuer pour de simples médisances ».
XII, 14. Quand vous dites cela, mes pères, vous devriez aussi empêcher que je ne le visse, puisqu’il m’est si facile d’y répondre. Car, outre que vos pères Reginaldus, Filiutius, etc., l’ont permis dans la spéculation, comme je l’ai déjà dit, et que de là le principe d’Escobar nous mène sûrement à la pratique, j’ai à vous dire de plus que vous avez plusieurs auteurs qui l’ont permis en mots propres, et entre autres le P. Héreau dans ses leçons publiques, ensuite desquelles le Roi le fit mettre en arrêt en votre maison pour avoir enseigné, outre plusieurs erreurs, que quand celui qui nous décrie devant des gens d’honneur continue après l’avoir averti de cesser, il nous est permis de le tuer ; non pas véritablement en public, de peur de scandale, mais en cachette, SED CLAM.
Le P. Héreau a été évoqué dans Provinciale VII, 12 ; voir éd. Cognet, p. 124.
Le texte cité par Pascal provient d’un Acte fait à la diligence de M. le recteur de l’Université de Paris, en date du 21 août 1643 ; voir Annales des jésuites, I, Requête de l’Université de Paris, en dénonciation au. Parlement de la doctrine homicide, etc. etc. enseignée par le p. Héreau, jésuite, t. 3, p. 862-863. L’acte dont est extrait la citation de Pascal est intitulé Acte fait à la diligence de M. le Recteur de l’Université de Paris, pour découvrir et faire condamner une doctrine préjudiciable à la vie d’un chacun, et particulièrement des rois et princes souverains, enseignée au collège des jésuites à Paris. Le passage, § VIII, est tiré d’un cours du P. Héreau au collège de Clermont, trouvé dans les papiers d’un augustin du collège du Mans. « Savoir, si tu tâches de détracter de mon nom par fausses accusations vers un prince, ou un juge, ou des gens d’honneur, et que je ne puisse en aucune façon détourner cette perte de ma renommée, sinon en te tuant en cachette, si je le peux faire licitement ?
Bannez l’assure, quaest. 64, art. 7, doute 4, ajoutant qu’il faut dire le même, quand bien le crime serait véritable, pourvu qu’il fût caché de telle sorte qu’il ne le pût découvrir selon la justice légale : sa raison est, parce que si tu veux offenser mon honneur, ou ma réputation avec un bâton, ou me donnant un soufflet, je le puis empêcher par les armes ; donc il en est de même, si tu tâches de m’offenser par la langue, et que je ne le puisse autrement éviter, sinon en te tuant, cela importe peu, ce semble, vu que tu pme tuerais également de la langue comme d’un autre instrument. En après, le droit de se défendre s’étend à tout ce qui est nécessaire à un homme pour se garantir de toute injure. Il faudrait toutefois avertir auparavant le détracteur de cesser, et s’il ne le voulait pas, à cause du scandale il ne le faudrait pas tuer ouvertement, mais en cachette ». L’expression sed clam est prise de la version latine placé en colonne de gauche : « Deinde, jus defensionis extendit se ad omne id quod necessarium est, ut se quis ab omni injuria servet immunem. Monendus tamen prius esset detractor ut desisteret, et si nollet, ratione scandali non esset aperte occidendus, sed clam ».
Wendrock cite le texte. Le P. Héreau a effectivement été mis aux arrêts par une décision du conseil d’État, en date du 3 mai 1644. Voir Annales, t. 3, p. 929, Arrêt du conseil d’État du roi, portant très expresse inhibiyions et défenses aux jésuites d’enseigner la doctrine homicide, et de l’enseignement de laquelle ils értaient atteints et convaincus ; avec ordre au p. Héreau, qui l’enseignait, de demeurer en arrêt au collège de Clermont. La Théologie morale des jésuites, 1659, p. 184 sq. donne l’arrêt du Conseil d’État porté contre le p. Héreau en 1644 (référence indiquée par l’éd. Cognet).
XIII, 15. Je vous ai déjà parlé du P. Lamy, et vous n’ignorez pas que sa doctrine sur ce sujet a été censurée en 1649 par l’Université de Louvain.
Sur le P. Francesco Amico ou Lamy, Provinciale VII, 20.
Cas évoqué dans Provinciale VII, 20, éd. Cognet, p. 129 ; dans Provinciale XIV, 10, éd. Cognet, p. 260 ; et repris dans Provinciale XVIII, 22, éd. Cognet, p. 368.
Voir Théologie morale des jésuites, t. 3, p. 187 sq. qui donne une Histoire du p. L’Amy jésuite, écrite par un docteur en théologie de la faculté de Louvain, avec deux censures de cette faculté contre la doctrine de ce jésuite touchant l’homicide, rapportées dans les notes latines de Guillaume Wendrock sur la 13e lettre au Provincial. On peut consulter directement les notes de Nicole-Wendrock, Note unique sur la XIIIe lettre, § 2.
XIII, 15. Et néanmoins il n’y a pas encore deux mois que votre Père Des Bois a soutenu à Rouen cette doctrine censurée du P. Lamy, et a enseigné qu’il est permis à un religieux de défendre l’honneur qu’il a acquis par sa vertu, MÊME EN TUANT celui qui attaque sa réputation, ETIAM CUM MORTE INVASORIS. Ce qui a causé un tel scandale en cette ville-là, que tous les curés se sont unis pour lui faire imposer silence, et [l’]obliger à rétracter sa doctrine, par les voies canoniques. L’affaire en est à l’Officialité.
Officialité : juridiction de l’Official, c’est-à-dire du juge de la cour d’Église. L’official est un clerc gradué en droit canonique et chargé par l’évêque de rendre la justice en son nom. Il a une vaste compétence, dans les affaires ecclésiastiques, dans es affaires séculières où un clerc est impliqué, dans les crimes perpétrés dans les lieux religieux. La politique royale, notamment par l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) tend à diminuer ses compétences aux seules causes spirituelles concernant l’administration des sacrements. Mais on voit par ce passage que l’Officialité intervient encore dans les questions de discipline.
BLUCHE François (dir.), Dictionnaire du grand siècle, p. 804, article Justices ecclésiastiques.
PONTAS, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 239 sq. Official. L’official est celui qui exerce la juridiction ecclésiastique en la place de l’évêque.
Provinciales, éd. Cognet, p. 247. Le P. Desbois, régent de théologie au collège archiépiscopal.
Première requête des curés de Rouen, in Divers écrits des curés de Paris, Rouen, Nevers, Amiens, Evreux et Lisieux contre la morale des jésuites..., 1762, p. 368. « Et c’est encore avec une pareille hardiesse que le même père Des Bois a osé défendre le P. l’Amy théologien de sa compagnie sur le sujet du meurtre de ceux qui calomnient ou menacent de calomnier les prêtres ou religieux, jusque-là même que dans une des dernières leçons qu’il a faites à ses écoliers depuis peu de jours, il a insinué clairement qu’il était permis aux prêtres et religieux de défendre, etiam cum morte invasoris, l’honneur qu’ils ont acquis par leur vertu et leur sagesse, lorsqu’il n’y a point d’autre moyen d’empêcher le calomniateur ». Ce texte est daté du 28 août 1656.
NOUËT Jacques, Réponse à la XIIIe lettre, in Réponses, p. 351, sur le « procès imaginaire » que Pascal attribue au P. Desbois. Mais cette dénégation semble contredite par la lettre des curés de Rouen mentionnée ci-dessus.
PASCAL, Sixième écrit des curés de Paris, éd. Cognet, p. 451-452. « On voit en cela l’esprit de ces Pères, et les bassesses où ils se portent, pour trouver les moyens de résister aux condamnations les plus justes et les plus authentiques. Mais cette première résistance leur fut inutile. On ne s’arrêta point à la multitude de ces docteurs qui les secoururent en foule ; et encore que Caramuel eût décidé nettement en ces termes : La doctrine du père Lamy est seule véritable, et le contraire n’est pas seulement probable, c’est l’avis de tout ce que nous sommes de doctes ; malgré tout cela le livre du Père Lamy demeura condamné; et l’ordre fut si exactement donné par le Conseil de Brabant d’en ôter cet article, que ces Pères n’eurent plus de moyen de s’en défendre. Ne pouvant donc plus s’en sauver par une désobéissance ouverte, ils pensèrent à l’éluder par une obéissance feinte, en ne faisant autre chose que retrancher la fin de cette proposition, et laissant le commencement qui la comprend toute entière: de sorte que malgré la première Faculté de Flandres, et le Conseil souverain du roi d’Espagne, on voit encore aujourd’hui dans le livre de ce Père Lamy cette doctrine horrible : Qu’un religieux peut défendre son véritable honneur, même par la mort de celui qui le veut déshonorer, etiam cum morte invasoris, s’il ne peut l’empêcher autrement. Ce qui n’est que la même chose que la première proposition que nous avons rapportée, qu’un religieux peut tuer celui qui veut médire de lui ou de sa communauté, laquelle subsiste ainsi dans le premier membre et y subsistera toujours. Car qui entreprendrait pour cela une nouvelle guerre contre des gens si rebelles et si artificieux ? »
XIII, 16. Que voulez-vous donc dire, mes pères ? Comment entreprenez-vous de soutenir après cela qu’aucun Jésuite n’est d’avis qu’on puisse tuer pour des médisances ? Et fallait-il autre chose pour vous en convaincre que les opinions mêmes de vos Pères que vous rapportez, puisqu’ils ne défendent pas spéculativement de tuer, mais seulement dans la pratique, à cause du mal qui en arriverait à l’Etat ?
XIII, 16. Car je vous demande sur cela, mes pères, s’il s’agit dans nos disputes d’autre chose, sinon d’examiner si vous avez renversé la loi de Dieu qui défend l’homicide. Il n’est pas question de savoir si vous avez blessé l’État, mais la religion. A quoi sert-il donc, dans ce genre de dispute, de montrer que vous avez épargné l’État, quand vous faites voir en même temps que vous avez détruit la religion, en disant, comme vous faites, p. 28, l. 3, que le sens de Reginaldus sur la question de tuer pour des médisances, est qu’un particulier a droit d’user de cette sorte de défense, la considérant simplement en elle-même ? Je n’en veux pas davantage que cet aveu pour vous confondre. Un particulier, dites-vous, a droit d’user de cette défense, c’est-à-dire de tuer pour des médisances, en considérant la chose en elle-même. Et par conséquent, mes pères, la loi de Dieu qui défend de tuer est ruinée par cette décision.
NOUËT, Impostures XV-XVIII, in Réponses, p. 163. La décision de Reginaldus est donnée dans la Provinciale VII, 15, éd. Cognet, p. 126-127.
XIII, 17. Et il ne sert de rien de dire ensuite, comme vous faites, que cela est illégitime et criminel, même selon la loi de Dieu, à raison des meurtres et des désordres qui en arriveraient dans l’État, parce qu’on est obligé, selon Dieu, d’avoir égard au bien de l’État. C’est sortir de la question. Car, mes pères, il y a deux lois à observer : l’une qui défend de tuer, l’autre qui défend de nuire à l’État. Reginaldus n’a pas peut-être violé la loi qui défend de nuire à l’État, mais il a violé certainement celle qui défend de tuer. Or, il ne s’agit ici que de celle-là seule. Outre que vos autres pères, qui ont permis ces meurtres dans la pratique, ont ruiné l’une aussi bien que l’autre. Mais allons plus avant, mes pères. Nous voyons bien que vous défendez quelquefois de nuire à l’État, et vous dites que votre dessein en cela est d’observer la loi de Dieu qui oblige à le maintenir. Cela peut être véritable, quoiqu’il ne soit pas certain ; puisque vous pourriez faire la même chose par la seule crainte des juges. Examinons donc, je vous prie, de quel principe part ce mouvement.
Passages empruntés à la 15e Imposture du p. Nouët cités littéralement.
Pascal entreprend non pas seulement de faire l’état des propositions que les jésuites soutiennent, mais de montrer dans quel esprit et avec quelles intentions elles ont été déclarées. Il procède ainsi dans la XIe Provinciale, où il expose les règles qui permettent de savoir « si les répréhensions partent d’un esprit de piété et de charité, ou d’un esprit d’impiété et de haine », et qui dévoilent « l’esprit de bouffonnerie, d’impiété et d’hérésie » qui anime les polémistes jésuites (éd. Cognet, p. 203 et p. 205). Il emploie la même argumentation dans la XVe Provinciale, lorsqu’il établit que lorsque les jésuites soutiennent des faussetés, ils le font avec intention, parce qu’ils sont convaincus qu’ils le font sans pécher ( : « je ne ferai pas seulement voir que vos écrits sont remplis de calomnies, je veux passer plus avant. On peut bien dire des choses fausses en les croyant véritables, mais la qualité de menteur enferme l’intention de mentir. Je ferai donc voir, mes pères, que votre intention est de mentir et de calomnier, et que c’est avec connaissance et avec dessein que vous imposez des crimes dont vous savez qu’ils sont innocents, parce que vous croyez le pouvoir faire sans déchoir de l’état de grâce » (éd. Cognet, p. 276). Ce genre d’argumentation demande de grandes précautions, car le cœur de l’homme n’est connu que de lui-même, et parfaitement connu que de Dieu. Le risque de faire à autrui un procès d’intention injustifié est grave. Pascal montre dans la XVe Provinciale comment on peut éviter ce risque par l’examen des différentes manières d’agir selon les différents moments et les circonstances.
XIII, 18. N’est-il pas vrai, mes pères, que si vous regardiez véritablement Dieu, et que l’observation de sa loi fût le premier et principal objet de votre pensée, ce respect régnerait uniformément dans toutes vos décisions importantes, et vous engagerait à prendre dans toutes ces occasions l’intérêt de la religion ? Mais si l’on voit au contraire que vous violez en tant de rencontres les ordres les plus saints que Dieu ait imposés aux hommes, quand il n’y a que sa loi à combattre, et que, dans les occasions mêmes dont il s’agit, vous anéantissez la loi de Dieu, qui défend ces actions comme criminelles en elles-mêmes, et ne témoignez craindre de les approuver dans la pratique que par la crainte des juges, ne nous donnez-vous pas sujet de juger que ce n’est point Dieu que vous considérez dans cette crainte, et que, si en apparence vous maintenez sa loi en ce qui regarde l’obligation de ne pas nuire à l’État, ce n’est pas pour sa loi même, mais pour arriver à vos fins, comme ont toujours fait les moins religieux politiques ?
Les moins religieux politiques : les politiques les moins religieux.
Sur la question de la manière dont les jésuites se conduisent à l’égard de l’État, voir FERREYROLLES Gérard, Pascal et la raison du politique, Presses Universitaires de France, Paris, 1984, notamment le deuxième chapitre, consacré à l’anomie jésuite.
XIII, 19. Quoi, mes pères ! vous nous direz qu’en ne regardant que la loi de Dieu qui défend l’homicide, on a droit de tuer pour des médisances ? Et après avoir ainsi violé la loi éternelle de Dieu, vous croirez lever le scandale que vous avez causé, et nous persuader de votre respect envers lui en ajoutant que vous en défendez la pratique pour des considérations d’État, et par la crainte des juges ? N’est-ce pas au contraire exciter un scandale nouveau, non pas par le respect que vous témoignez en cela pour les juges, car ce n’est pas cela que je vous reproche, et vous vous jouez ridiculement là-dessus, page 29.
Passage auquel Pascal fait allusion : « La religion de la cour lui est-elle si suspecte qu’il estime des jésuites criminels pour avoir établi leurs opinions sur leurs arrêts ? » La cour en question est la cour de justice, et non la cour qui compose l’entourage du roi et des grands.
SUSINI Laurent, « L’éloquence du « vrai combat » dans les Provinciales », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 124. Analyse rhétorique par comparaison avec un passage sur le même sujet, traité sur le mode ironique, dans la VIe Provinciale, éd. Cognet, Garnier, p. 112-113.
XIII, 19. Je ne vous reproche pas de craindre les juges, mais de ne craindre que les juges. C’est cela que je blâme, parce que c’est faire Dieu moins ennemi des crimes que les hommes.
Membre de phrase manquant dans l’édition de 1659 : « ... et non pas le Juge des Juges ». Il est traduit dans Wendrock, et c’est sans doute par erreur qu’il a été omis.
XIII, 19. Si vous disiez qu’on peut tuer un médisant selon les hommes, mais non pas selon Dieu, cela serait moins insupportable ; mais quand vous prétendez que ce qui est trop criminel pour être souffert par les hommes soit innocent et juste aux yeux de Dieu qui est la justice même, que faites-vous autre chose, sinon montrer à tout le monde que, par cet horrible renversement si contraire à l’esprit des saints, vous êtes hardis contre Dieu, et timides envers les hommes ?
XIII, 19. Si vous aviez voulu condamner sincèrement ces homicides, vous auriez laissé subsister l’ordre de Dieu qui les défend ; et si vous aviez osé permettre d’abord ces homicides, vous les auriez permis ouvertement, malgré les lois de Dieu et des hommes. Mais, comme vous avez voulu les permettre insensiblement, et surprendre les magistrats qui veillent à la sûreté publique, vous avez agi finement en séparant vos maximes, et proposant d’un côté qu’il est permis, dans la spéculative, de tuer pour des médisances (car on vous laisse examiner les choses dans la spéculation), et produisant d’un autre côté cette maxime détachée, que ce qui est permis dans la spéculation l’est bien aussi dans la pratique. Car quel intérêt l’État semble-t-il avoir dans cette proposition générale et métaphysique ? Et ainsi, ces deux principes peu suspects étant reçus séparément, la vigilance des magistrats est trompée ; puisqu’il ne faut plus que rassembler ces maximes pour en tirer cette conclusion où vous tendez, qu’on peut donc tuer dans la pratique pour de simples médisances.
Argument selon lequel les jésuites trompent les magistrats et détruisent les lois.
Surprendre les magistrats : surprendre veut dire tromper.
XIII, 20. Car c’est encore ici, mes pères, une des plus subtiles adresses de votre politique, de séparer dans vos écrits les maximes que vous assemblez dans vos avis. C’est ainsi que vous avez établi à part votre doctrine de la probabilité, que j’ai souvent expliquée. Et ce principe général étant affermi, vous avancez séparément des choses qui, pouvant être innocentes d’elles-mêmes, deviennent horribles étant jointes à ce pernicieux principe.
Provinciales, éd. Cognet, p. 251, renvoie à la Réponse de l’Université de Paris à l’Apologie pour les jésuites de Hermant, 1644. Voir en note un passage qui semble avoir inspiré Pascal. Voir Annales des jésuites, p. 945.
Cette remarque est liée à la doctrine de l’interprétation que Pascal développe dans la liasse Loi figurative des Pensées, notamment dans Laf. 257, Sel. 289 : « Contradiction. On ne peut faire une bonne physionomie qu’en accordant toutes nos contrariétés et il ne suffit pas de suivre une suite de qualités accordantes sans accorder les contraires : pour entendre le sens d’un auteur il faut accorder tous les passages contraires. Ainsi pour entendre l’Écriture il faut avoir un sens dans lequel tous les passages contraires s’accordent : il ne suffit pas d’en avoir un qui convienne à plusieurs passages accordants, mais d’en avoir un qui accorde les passages même contraires. Tout auteur a un sens auquel tous les passages contraires s’accordent ou il n’a point de sens du tout. On ne peut pas dire cela de l’Écriture et des prophètes : ils avaient assurément trop de bon sens. Il faut donc en chercher un qui accorde toutes les contrariétés. » Si l’on veut comprendre les intentions profondes des jésuites, il faut arriver à concilier tous leurs discours en divers temps.
Pascal a résumé ses idées sur ce sujet dans un fragment bref des Pensées, Fragment hors Copies, RO 285 r° / v° (Laf. 956, Sel. 791) : « Examiner le motif de la censure par les phénomènes ; faire une hypothèse qui convienne à tous ».
Il est possible que cette méthode ait été inspirée à Pascal par la distinction classique de la rhétorique scolastique entre sens composé et sens divisé.
Voir là-dessus ARNAULD Antoine et NICOLE Pierre, La Logique, III, XVIII, 6, éd. D. Descotes, Paris, Champion, 2014, p. 444 sq.
CLAUBERG Johannes, Logique ancienne et nouvelle, éd. Lagrée et Coqui, Paris, Vrin, 2007, III, De la recherche du vrai sens de la phrase obscure, ch. VIII, p. 206 sq. Quand on joint la signification formelle du prédicat avec la signification formelle du sujet, l’énonciation est dite en sens composé ou conjoint ; par exemple il est impossible que le maître soit esclave. Le sens est conjoint quand divers attributs qui doivent être compris du même sujet simultanément ou au même moment sont affirmés ou niés : ainsi on ne devait pas retirer en même temps aux Juifs le sceptre et le législateur avant que ne vienne le libérateur, bien qu’il le lui ait été enlevé longtemps avant son arrivée. Mais quand le signifié formel du prédicat est uni au signifié matériel du sujet, c’est le sens divisé, comme dans il est possible que marche l’homme assis. Le sens est divisé quand sont dits d’un même sujet différents attributs qui lui conviennent alternativement ou à différents moments : la même eau est bouillante ou gelée en sens divisé.
Cette distinction revient souvent dans les querelles sur la grâce. Pascal connaît cette distinction scolastique ; il s’en sert dans les Écrits sur la grâce, lorsqu’il expose les différents pouvoirs d’agir de l’homme selon qu’on en parle selon le sens composé (les effets en commun) ou selon le sens divisé (les effets séparément). Voir OC III, éd. J. Mesnard, p.617 sq.
NICOLE Pierre, Fratris Nicolaï… molinisticae theses, III, p. 3-4. Gratia quaelibet indifferentem voluntatem relinquit in sensu diviso, non in sensu composito. La doctrine d’Alvavarez est sur ce point en accord avec celle des augustiniens. Selon Alvarez, « quia liberum arbitrium motum a Deo auxilio efficaci non potest illi dissentire in sensu composito, sed in sensu diviso ut inferius patebit, ideo esset magnum inconveniens si hoc possibile poneretur in esse. Sequeretur enim quod voluntas Dei esset inefficax et impedibilis per hominis voluntatem, quod, ut Augustinus dicit, et nos supra ostendimus, est impossibile » : p. 3.
Voir aussi SELLIER Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970, p. 332. La distinction du sens composé et du sens divisé dans la théologie de la grâce.
Lorsque les jésuites déclarent que dans la spéculation l’assassinat est permis, ils parlent selon le sens divisé, en séparant cette thèse soi-disant purement théorique de la loi de Dieu. Mais lorsqu’ensuite ils en parlent au sens composé, ils soutiennent que la même thèse sur la permission de l’assassinat est reçue par la loi civile et par la loi divine tout à la fois.
ROUSSEAU Jean-Jacques, Rousseau juge de Jean-Jacques, Dialogue I, OC I, éd. Starobinski, Pléiade, p. 722. « Le public ne rapproche pas ainsi les idées qu’on a l’adresse de lui montrer séparément ». Tout le passage est inspiré des Provinciales.
XIII, 20. J’en donnerai pour exemple ce que vous avez dit, page 11, dans vos impostures, et à quoi il faut que je réponde : Que plusieurs théologiens célèbres sont d’avis qu’on peut tuer pour un soufflet reçu. Il est certain, mes pères, que, si une personne qui ne tient point la probabilité avait dit cela, il n’y aurait rien à reprendre, puisqu’on ne ferait alors qu’un simple récit qui n’aurait aucune conséquence. Mais vous, mes pères, et tous ceux qui tenez cette dangereuse doctrine, que tout ce qu’approuvent des auteurs célèbres est probable et sûr en conscience, quand vous ajoutez à cela, que plusieurs auteurs célèbres sont d’avis qu’on peut tuer pour un soufflet, qu’est-ce faire autre chose, sinon de mettre à tous les Chrétiens le poignard à la main pour tuer ceux qui les auront offensés, en leur déclarant qu’ils le peuvent faire en sûreté de conscience, parce qu’ils suivront en cela l’avis de tant d’auteurs graves ?
Que plusieurs théologiens célèbres sont d’avis qu’on peut tuer pour un soufflet reçu : voir NOUËT, 4e Imposture, « l’opinion... de Victoria, que Lessius rejette, bien qu’elle soit appuyée de plusieurs théologiens fort célèbres, qui ne sont pas de notre Compagnie. »
Pascal distingue la perspective historique du récit et celle de la doctrine. La première n’exprime qu’une vérité de fait, et ne peut être censurée pour le fond, à moins d’être erronée. La seconde se comprend comme une permission du meurtre appuyée sur l’autorité de certains théologiens. Les conséquences en sont fort différentes : la première est une pure question de fait, dont on ne peut rien conclure sur les règles de la morale. La seconde peut apparaître comme un encouragement au meurtre.
XIII, 21. Quel horrible langage qui, en disant que des auteurs tiennent une opinion damnable, est en même temps une décision en faveur de cette opinion damnable, et qui autorise en conscience tout ce qu’il ne fait que rapporter ! On l’entend, mes Pères, ce langage de votre école. Et c’est une chose étonnante que vous ayez le front de le parler si haut, puisqu’il marque votre sentiment si à découvert, et vous convainc de tenir pour sûre en conscience cette opinion, qu’on peut tuer pour un soufflet, aussitôt que vous nous avez dit que plusieurs auteurs célèbres la soutiennent.
XIII, 22. Vous ne pouvez vous en défendre, mes Pères, non plus que vous prévaloir des passages de Vasquez et de Suarez que vous m’opposez, où ils condamnent ces meurtres que leurs confrères approuvent. Ces témoignages, séparés du reste de votre doctrine, pourraient éblouir ceux qui ne l’entendent pas assez. Mais il faut joindre ensemble vos principes et vos maximes. Vous dites donc ici que Vasquez ne souffre point les meurtres. Mais que dites-vous d’un autre côté, mes Pères ? Que la probabilité d’un sentiment n’empêche pas la probabilité du sentiment contraire. Et en un autre lieu, qu’il est permis de suivre l’opinion la moins probable et la moins sûre, en quittant l’opinion la plus probable et la plus sûre. Que s’ensuit-il de tout cela ensemble, sinon que nous avons une entière liberté de conscience pour suivre celui qui nous plaira de tous ces avis opposés ? Que devient donc, mes Pères, le fruit que vous espériez de toutes ces citations ? Il disparaît, puisqu’il ne faut, pour votre condamnation, que rassembler ces maximes que vous séparez pour votre justification. Pourquoi produisez-vous donc ces passages de vos auteurs que je n’ai point cités, pour excuser ceux que j’ai cités, puisqu’ils n’ont rien de commun ? Quel droit cela vous donne-t-il de m’appeler imposteur ? Ai-je dit que tous vos Pères sont dans un même dérèglement ? Et n’ai-je pas fait voir au contraire que votre principal intérêt est d’en avoir de tous avis pour servir à tous vos besoins ? A ceux qui voudront tuer on présentera Lessius ; à ceux qui ne voudront pas tuer, on produira Vasquez, afin que personne ne sorte malcontent, et sans avoir pour soi un auteur grave. Lessius parlera en païen de l’homicide, et peut-être en chrétien de l’aumône : Vasquez parlera en païen de l’aumône, et en chrétien de l’homicide. Mais par le moyen de la probabilité, que Vasquez et Lessius tiennent, et qui rend toutes vos opinions communes, ils se prêteront leurs sentiments les uns aux autres, et seront obligés d’absoudre ceux qui auront agi selon les opinions que chacun d’eux condamne. C’est donc cette variété qui vous confond davantage. L’uniformité serait plus supportable
Voir Provinciale V, 7-9, éd. Cognet, p. 75-76.
NOUËT, Réponse à la XIIIe lettre, in Réponses, p. 346. Réponse : la diversité d’opinions n’est pas contraire à la doctrine de saint Ignace, qui ne défend que les opinions hérétiques et dangereuses, et non les opinions probables.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 462 sq.
Il suffit de rassembler les maximes des casuistes pour leur faire engendrer des conséquences mauvaises. Cela revient à traiter l’ensemble des maximes des casuistes comme une sorte de système qui repose sur les axiomes de la probabilité. De cette manière, Pascal justifie le branchement des maximes les unes sur les autres.
Pascal a dit dans la Ve Provinciale que les jésuites ont besoin à la fois de directeurs sévères et de directeurs relâchés, pour contenter tous les fidèles qui viennent les consulter.
XIII, 22. Et il n’y a rien de plus contraire aux ordres exprès de saint Ignace et de vos premiers généraux que ce mélange confus de toutes sortes d’opinions. Je vous en parlerai peut-être quelque jour, mes pères, et on sera surpris de voir combien vous êtes déchus du premier esprit de votre Institut, et que vos propres généraux ont prévu que le dérèglement de votre doctrine dans la morale pourrait être funeste non seulement à votre société, mais encore à l’Église universelle.
Pascal ne pense pas que la compagnie de Jésus a toujours été ce qu’elle est devenue à l’époque des Provinciales. Il insiste sur la déchéance de la Compagnie de Jésus, qui a trahi les idéaux poursuivis par ses premiers généraux.
Et il n’y a rien de plus contraire aux ordres exprès de saint Ignace et de vos premiers Généraux que ce mélange confus de toutes sortes d’opinions... : Pascal a pris quelques notes sur la déchéance de la Compagnie de Jésus par rapport à ses débuts dans les Pensées.
Pascal n’a pas consacré d’ouvrage à cette dégradation de la Compagnie de Jésus, mais on trouve dans Laf. 955, Sel. 790, des notes prises par Arnauld dans les Epistolae praepositorum generalium ad patres et fratres Societatis Jesu, Anvers, 1635, tirés des lettres d’Aquaviva et Vitelleschi sur ce sujet ; Pascal a annoté ces passages.

BNF
Voir aussi Pensées, Laf. 966, Sel. 799. « Lettre des établissements violents des jésuites partout.
Aveuglement surnaturel.
Cette morale qui a en tête un Dieu crucifié.
Voilà ceux qui ont fait vœu d’obéir tanquam Christo.
La décadence des Jésuites (...). »
Pensées, Laf. 954, Sel. 789. Déchéance de la Compagnie de Jésus par rapport à ses débuts : « Voyez combien la prévoyance des hommes est faible. Toutes les choses d’où nos premiers généraux craignaient la perte de notre société, c’est par là qu’elle s’est accrue, par les grands, par la contrariété à nos constitutions, par la multitude des religieux, la diversité et la nouveauté, la diversité et nouveauté d’opinions, etc. 182. 157. Politique 181. Le premier esprit de la société éteint. 170. 171 ad 174. 183 ad 187. non e piu quella. Vittelescus. 183. »
SAINTE-BEUVE, Port-Royal, éd. Leroy, Pléiade, t. 2, p. 143 sq.
PETITDIDIER Mathieu, Apologie des Lettres Provinciales de Louis de Montalte ; contre la dernière réponse des P.P. Jésuites intitulée: Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, Deuxième lettre, Henri Van Rhin, Rouen, 1698, p. 67 sq. Texte de la lettre de Vitelleschi du 4 janvier 1617, contre les auteurs imprudents de la Compagnie.
XIII, 23. Je vous dirai cependant que vous ne pouvez pas tirer aucun avantage de l’opinion de Vasquez. Ce serait une chose étrange si, entre tant de jésuites qui ont écrit, il n’y en avait pas un ou deux qui eussent dit ce que tous les chrétiens confessent. Il n’y a point de gloire à soutenir qu’on ne peut pas tuer pour un soufflet, selon l’Évangile ; mais il y a une horrible honte à le nier. De sorte que cela vous justifie si peu qu’il n’y a rien qui vous accable davantage ; puisque, ayant eu parmi vous des docteurs qui vous ont dit la vérité, vous n’êtes pas demeurés dans la vérité, et que vous avez mieux aimé les ténèbres que la lumière.
Vous avez mieux aimé les ténèbres que la lumière : voir Jean, III, 19. « Et le sujet de cette condamnation est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises » (tr. de Port-Royal).
XIII, 23. Car vous avez appris de Vasquez que c’est une opinion païenne, et non pas chrétienne, de dire qu’on puisse donner un coup de bâton à celui qui a donné un soufflet ; c’est ruiner le Décalogue et l’Évangile de dire qu’on puisse tuer pour ce sujet, et que les plus scélérats d’entre les hommes le reconnaissent. Et cependant vous avez souffert que, contre ces vérités connues, Lessius, Escobar et les autres aient décidé que toutes les défenses que Dieu a faites de l’homicide, n’empêchent point qu’on ne puisse tuer pour un soufflet. A quoi sert-il donc maintenant de produire ce passage de Vasquez contre le sentiment de Lessius, sinon pour montrer que Lessius est un païen et un scélérat, selon Vasquez ? Et c’est ce que je n’osais dire. Qu’en peut-on conclure, si ce n’est que Lessius ruine le Décalogue et l’Évangile ; qu’au dernier jour Vasquez condamnera Lessius sur ce point, comme Lessius condamnera Vasquez sur un autre, et que tous vos auteurs s’élèveront en jugement les uns contre les autres pour se condamner réciproquement dans leurs effroyables excès contre la loi de Jésus-Christ ?
VASQUEZ, De restitutione, c. 2, dub. 9, n. 371, passage cité par le P. Nouët dans la 4e Imposture ; Pascal résume le texte et Nicole le suit, mais en reprenant les expressions de Vasquez.
Décalogue : voir BOUYER Louis, Dictionnaire théologique, p. 181. Mot signifiant les dix paroles et donné au texte d’Exode, XX, 1-17 et repris en Deutéronome, V, 6-21. Ce sont les dix commandements que Dieu a donnés à Moïse.
Scélérat : Malin, perfide, qui est chargé de crimes, qui est porté naturellement à les commettre, qui ne fait point scrupule de rien ; méchant, pervers, qui n’a ni foi, ni probité, ni honneur (Furetière).
C’est un thème récurrent chez Pascal que les ennemis de la vérité, de la morale et de la foi se combattent les uns les autres, et qu’ils s’entredétruisent, sans atteindre jamais la vérité, qui demeure hors de leurs atteintes. Pascal en a dit ce qu’il pensait dans la conclusion de la Lettre à Le Pailleur, OC II, éd. J. Mesnard, p. 575-576, sur le vide sur lequel le p. Noël et plusieurs autres proposent des hypothèses diverses en faveur du plein : « Tous ceux qui combattent le vérité sont sujets à une semblable inconstance de pensées, et ceux qui tombent dans cette variété sont suspects de la contredire. Aussi est-il étrange de voir parmi ceux qui soutiennent le plein le plus grand nombre d’opinions différentes qui s’entrechoquent ; l’un soutient l’éther, et exclut toute autre matière ; l’autre, les esprits de la liqueur, au préjudice de l’éther ; l’autre, l’air enfermé dans les pores des corps, et bannit toute autre chose ; l’autre, de l’air raréfié et vide de tout autre corps. Enfin il s’en est trouvé qui, n’ayant pas osé y placer l’immensité de Dieu, ont choisi parmi les hommes une personne assez illustre par sa naissance et par son mérite pour y placer son esprit et le faire remplir toutes choses [sc. Le prince de Conti dans Le plein du vide du p. Noël]. Ainsi chacun d’eux a tous les autres pour ennemis ; et comme tous conspirent à la perte d’un seul, il succombe nécessairement. Mais comme ils ne triomphent que les uns des autres, ils sont tous victorieux, sans que pas un se puisse prévaloir de sa victoire, parce que tout cet avantage naît de leur propre confusion. De sorte qu’il n’est pas nécessaire de les combattre pour les ruiner, puisqu’il suffit de les abandonner à eux-mêmes, parce qu’ils composent un corps divisé, dont les membres contraires les uns aux autres se déchirent intérieurement. Au lieu que ceux qui favorisent le vide demeurent dans une unité toujours égale à elle-même, qui a par ce moyen tant de rapport avec la vérité qu’elle doit être suivie, jusques à ce qu’elle nous paraisse à découvert ». La différence entre les partisans du plein et les jésuites, c’est que les premiers peuvent être laissés à eux-mêmes parce qu’ils ne sont guère nuisibles, alors que les casuistes, eux, méritent qu’on les combatte.
XIII, 24. Concluons donc, mes pères, que puisque votre probabilité rend les bons sentiments de quelques-uns de vos auteurs inutiles à l’Église, et utiles seulement à votre politique, ils ne servent qu’à nous montrer, par leur contrariété, la duplicité de votre cœur, que vous nous avez parfaitement découverte, en nous déclarant d’une part que Vasquez et Suarez sont contraires à l’homicide, et de l’autre, que plusieurs auteurs célèbres sont pour l’homicide, afin d’offrir deux chemins aux hommes, en détruisant la simplicité de l’Esprit de Dieu, qui maudit ceux qui sont doubles de cœur, et qui se préparent deux voies : Vae duplici corde, et ingredienti duabus viis !
Vae duplici corde et ingredienti duabus viis! : Ecclésiastique, II, 14. Commentaire de Sacy, L’Ecclésiastique, p. 30 : « Malheur à ceux qui ont deux cœurs, l’un pour Dieu, l’autre pour le monde; malheur à ceux dont les lèvres sont aussi corrompues que le cœur, puisque la langue est nécessairement double si le cœur est double. Marcher par deux voies est lorsque l’on marche selon Dieu en apparence, et selon le monde dans le fond du cœur. »
Miracles III, 11, Laf. 909, Sel. 451. « Gens sans paroles, sans foi, sans honneur, sans vérité, doubles de cœur, doubles de langue et semblables, comme il vous fut reproché autrefois, à cet animal amphibie de la fable, qui se tenait dans un état ambigu entre les poissons et les oiseaux. » Sur ce texte, voir DESCOTES Dominique, « Jésuites violents et poissons volants », Courrier du Centre International Blaise Pascal, 34, Clermont-Ferrand, 2012, p. 28-36.
ORCIBAL, La spiritualité de Saint-Cyran, p. 268. Chrétiens imparfaits.
SELLIER Philippe, « La rhétorique de Saint-Cyran et le tournant des Provinciales », in SELLIER Philippe, Port-Royal et la littérature, I, Pascal, Champion, Paris, 1999, p.162-163.
Pensées, Laf. 989, Sel. 810. « Les Jésuites. Les Jésuites ont voulu joindre Dieu au monde, et n’ont gagné que le mépris de Dieu et du monde. Car, du côté de la conscience, cela est évident ; et, du côté du monde, ils ne sont pas de bons cabalistes. Ils ont du pouvoir, comme je l’ai dit souvent, mais c’est-à-dire à l’égard des autres religieux. Ils auront le crédit de faire bâtir une chapelle et d’avoir une station de jubilé, non de pouvoir faire avoir des évêchés, des gouvernements de place. C’est un sot poste dans le monde que celui de moines, qu’ils tiennent, par leur aveu même (P. Brisacier, Bénédictins). Cependant... vous ployez sous les plus puissants que vous, et vous opprimez de tout votre petit crédit ceux qui ont moins d’intrigue que vous dans le monde. »
