P 06 : Commentaires
Composition de la Provinciale VI
D’après le catalogue Fouillou, Nicole a revu cette lettre à l’hôtel des Ursins.

L’hôtel des Ursins
OC III, éd. J. Mesnard, p. 450-451. Sans doute Nicole a-t-il désormais rejoint Arnauld dans sa retraite.
JOUSLIN Olivier, Pascal et le dialogue polémique, p. 382 sq. La collaboration de Nicole sensible à partir de la Provinciale VI : p. 383.
De Paris, ce 10 avril 1656. Chronologie de la VIe Provinciale
Réponse et remerciement d’un Provincial à Monsieur E.A.A.B.P.A.F.D.E.P. sur le sujet de ses lettres et particulièrement de la cinquième, où sont marquées plusieurs différences très considérables entre la morale des Docteurs Casuistes de l’Église Catholique et celle des Jansénistes, slnd, 8 p. in-4°. Voir des extraits dans GEF V, p. 56 sq. Parue après la Provinciale VI. Voir Les Provinciales, éd. Cognet, p. XLVII-XLVIII. Jansénius et Arnauld n’ont pas su exprimer leur doctrine : ils sont confus et ennuyeux ; le personnage qui écrit les Provinciales a su à la fois divertir et rendre savant. En fait, l’opuscule attaque Port-Royal en montrant que les “casuistes jansénistes” permettent la calomnie, par exemple. Idée que Pascal, qui ne marche pas au hasard, a mêlé de bons docteurs à sa liste de casuistes. La morale de Port-Royal est “nouvelle et inconnue à tous les siècles”.
Voir sur cet écrit JOUSLIN Olivier, Pascal et le dialogue polémique, p. 378 sq. Thème de l’imposture littéraire de l’auteur des Provinciales : p. 379. Rétorsion des accusations portées contre les jésuites contre Port-Royal : p. 380. Tentative d’assimilation de Port-Royal aux protestants : p. 381-382.
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 181 sq.
24 mars, vers 15 heures. Dans l’église de Port-Royal de Paris, Marguerite Périer, fille de Florin Périer et de Gilberte Pascal, vient adorer et embrasser une Sainte Épine. Sœur Catherine de Sainte-Flavie Passart lui applique la relique sur un œil atteint d’une fistule lacrymale. Quelques heures plus tard l’œil redevient normal. Ce miracle de la Sainte Épine attire beaucoup de monde à Port-Royal de Paris.
24 mars 1656. ARNAULD, Deuxième lettre apologétique.
30-31 mars 1656. Visite du lieutenant civil d’Aubray à Port-Royal.
31 mars 1656. Lettre en latin d’Arnauld au Cardinal F. Barberini, De adversariorum suorum iniquitate in ferenda nomine Facultatis Parisiensis censura, deque doctrina sua circa gratiam.
4 avril 1656. NICOLE Pierre, Fratris Joannis Nicolai doctoris theologi parisiensis, et apud praedicatores primarii Regentis molinisticae theses, thomisticis notis expunctae, 4 avril 1656, 28 p. in-4°. BN : D 8958. Suivi de Appendix, seu fratris Ioannis Nicolai calumniarum specimen ex libello cui titulus, Censorium Suffragium. Voir WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 14 ; Litterae Provinciales, p. 11. Voir ARNAULD Antoine, Œuvres, XIX, p. LXXVI. Les thèses du P. Nicolaï ont été soutenues au mois de janvier.
PASCAL, Sixième Lettre, 10 avril 1656, datée du 10 avril 1656, mais on ne sait pas à quelle date exacte s’est faite la mise en circulation, le Journal de Saint-Gilles s’arrêtant au 8 avril. Voir OC III, p. 451, et Provinciales, éd. Cognet, p. 95.
RAPIN, Mémoires..., II, éd. Aubineau, p. 368 sq. Voir OC I, p. 851. Selon Rapin, on en envoie un exemplaire avant parution à l’Hôtel de Nevers, à Mme du Plessis-Guénégaud, pour la lire devant des personnes favorables à Port-Royal. La lecture lance la publicité.
La Deuxième lettre apologétique d’Antoine Arnauld (24 mars 1656).
Voir le dossier de cet écrit.
GEF IV, p. 195, n. 1.
ARNAULD Antoine, Œuvres, XIX, p. LXXI. Date : 24 mars 1656.
GRES-GAYER Jacques M., Le jansénisme en Sorbonne, 1643-1656, p. 195.
Frises de la Provinciale VI
Frise du recueil R 1035 de Clermont

Cette frise est identique à celle de l’exemplaire mis en ligne par la BNF.
Frise du recueil R 5452 de Clermont
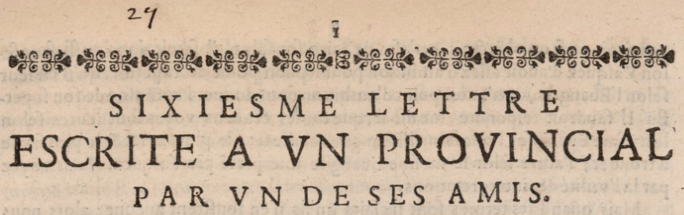
Frise du recueil R 5597 de Clermont

Frise de la BNF

Monsieur,
VI, 1. Je vous ai dit à la fin de ma dernière lettre que ce bon père jésuite m’avait promis de m’apprendre de quelle sorte les casuistes accordent les contrariétés qui se rencontrent entre leurs opinions, et les décisions des papes, des conciles et de l’Écriture. Il m’en a instruit en effet dans ma seconde visite, dont voici le récit.
C’était une objection que l’auteur est censé avoir proposée au jésuite à la fin de la cinquième Provinciale.
Le programme porte sur la résolution des contrariétés entre les opinions des casuistes et les décisions de l’Église. La question ne semble pas présenter de difficulté, puisque rien n’interdit logiquement deux discours d’être contraires l’un à l’autre. Mais le vrai problème consiste en ce que les décisions des casuistes prétendent justement représenter les principes et les maximes de l’Église.
La suite va mentionner des « contradictions apparentes », entre le discours des casuistes et celui de l’Église. On a l’impression de voir se dessiner un thème qui prendra toute son ampleur dans la liasse des Pensées consacrée aux Figuratifs. Mais si dans les Pensées ces contradictions sont apparentes au double sens du mot, c’est-à-dire visibles et purement imaginaires dans le cas présent, quoique le jésuite prétende que les contradictions sont apparentes au second sens, elles sont en réalité tout à fait réelles. Alors que le mode de résolution des contradictions dans les Pensées, fondé sur la notion de figure, est tout à fait valide, le mode des casuistes est purement illusoire, et se présente comme une falsification.
Autrement dit, on a deux versions du problème de la résolution des contrariétés, l’un qui présente un problème réel assorti d’une solution valide, l’autre qui présente un problème factice, résolu de manière sophistique. D’un côté, les contradictions ne sont vraiment qu’une apparence qu’il est facile de dissiper en s’appuyant sur l’idée de figure. De l’autre les contradictions sont niées, et il faut montrer qu’elles sont réelles. Il y a là une mise en regard des Pensées et des Provinciales qui montre à quel point leur liaison est forte.
VI, 1. Je le ferai plus exactement que l’autre. Car j’y portai des tablettes, pour marquer les citations des passages, et je fus bien fâché de n’en avoir point apporté dès la première fois. Néanmoins si vous êtes en peine de quelqu’un de ceux que je vous ai cités dans l’autre Lettre, faites-le moi savoir, je vous en satisferai facilement.
Ce passage a été introduit dans la première impression, parce que Port-Royal a vu que l’absence de référence des passages dans la Ve Provinciale pouvait prêter à reproche de la part des polémistes jésuites. En revanche, comme à la réimpression, les références ont été rétablies dans la Ve Provinciale, il devenait inutile et même incohérent ; il a donc été supprimé dans l’édition de 1659, et omis par Nicole dans sa traduction latine. Le passage ne se trouve pas dans l’édition Cognet, et on ne le trouve que dans l’apparat critique, p. 486. En revanche, il apparaît dans le texte même dans GEF V, p. 28.
Le mot citation signifie ici référence. Le Dictionnaire de Furetière ne donne que le sens courant. Le Dictionnaire de l’Académie donne pour sens allégation.
Tablettes : feuilles de parchemin, de papier préparé, qui sont ordinairement attachées ensemble, et qu’on porte ordinairement dans la poche, pour écrire avec un crayon, ou avec une aiguille d’or ou d’argent, les choses dont on veut se souvenir.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, p. 188. Pascal suit vraisemblablement le conseil de Nicole, qui aurait été choqué par le manque de références des citations. Mais Pascal a toujours du mal à s’astreindre à citer en érudit ; il pratique le centon : p. 384.
Centon : voir Dictionnaire de l’académie : ouvrage de poésie, composé de vers ou partie de vers empruntés de quelque auteur célèbre. On appelle aussi, par extension centon un ouvrage rempli de morceaux dérobés.
Marquer les citations des passages : il faudrait vérifier que cela se trouve dès les premières impressions. Cela se trouve en tout cas sur l’exemplaire que j’ai en reproduction. C’est aussi le cas sur l’exemplaire du recueil 1035 et dans le recueil 5997. Le souci est donc venu très vite. Car il n’était pas question de citations dans les premières lettres.
Cette proposition sera remplie, mais de manière ironique : ce sont les jésuites eux-mêmes qui, en récusant les allégations de Pascal, vont le conduire à donner avec plus de détail références et contextes des propositions des casuistes.
Références
Voir Provinciale 12, sur les références et les citations de Pascal.
I, 2. Ce bon Père me parla de cette sorte. Une des manières dont nous accordons ces contradictions apparentes, est par l’interprétation de quelque terme.
Le mot d’interprétation fait partie du lexique de Pascal mathématicien. Il désigne la substitution à une cellule du triangle arithmétique des deux cellules qui l’engendrent par addition. L’idée principale n’est donc pas tant la dualité que celle de substitution.
Sur la question des contradictions et de la manière de les accorder, voir la Lettre sur la possibilité des commandements et le dossier Loi figurative. De même que la Provinciale V dénonce dans la casuistique des opinions probables une caricature du raisonnement géométrique, la méthode d’accord des contrariétés des casuistes est une caricature de la méthode d’interprétation telle qu’elle est ordinairement pratiquée. Le problème de l’accord des contrariétés forme une liaison avec la fin de la Ve Provinciale, où la question était posée. Cela permet de faire rebondir la discussion dans un autre sens.
A priori, il n’y a pas de raison de s’indigner de cette formule : c’est toujours par l’interprétation des termes que l’on peut résoudre une contradiction apparente.
Voir dans les Pensées, la liasse Loi figurative, qui traite de la question de la conciliation des contradictions par le moyen des figures et des métaphores : il peut paraître contradictoire de dire d’une part que Dieu est purement spirituel par nature, et qu’il a aimé le parfum des sacrifices qui lui ont été offerts ; ou encore que Dieu, qui n’a pas de corps, dira aux élus de siéger à sa droite. La contradiction est résolue par l’idée que certains termes doivent être entendus non pas dans un sens littéral charnel, mais dans un sens métaphorique spirituel. Pascal traite aussi dans la Lettre sur la possibilité des commandements des contradictions apparentes de l’Écriture et de saint Augustin, mais cette fois par la seule polysémie de termes comme pouvoir et prochain. Il tente de montrer que les expressions que l’on trouve dans saint Augustin, comme que les commandements sont possibles aux justes, et qu’ils ne le sont pas, ne sont contraires que de manière purement apparente, et que ces deux expressions doivent être prises dans des contextes différents, ou avec des sens différents de possible ou impossible. Ce n’est donc pas la volonté de concilier les contradictions en elle-même qui est à ses yeux condamnable, mais la volonté de dissimuler celles qui sont réelles par des procédés malhonnêtes. Tout ce passage doit être interprété en rapport avec ces deux textes.
RAPIN René, Mémoires..., II, éd. Aubineau, p. 369 sq. Défense de la légitimité de l’interprétation des textes religieux. Rétorsion à Port-Royal sur la propre méthode d’interprétation des jansénistes.
NOUËT Jacques, Impostures XXV, in Réponses, p. 217 sq. Les jésuites se contentent d’interprétations “authentiques ou doctrinales”, “reçues dans l’École et enseignées par les plus grands théologiens” : p. 218. Le P. Nouët soutient par exemple que l’interprétation du mot assassin incriminée par Pascal est “commune parmi les théologiens” et à l’intelligence vulgaire : p. 221 sq.
REGUIG-NAYA Delphine, « Pratiques herméneutiques dans les Provinciales », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 211-224. Voir p. 214-215 sur ce passage. Comment la contradiction entre les opinions des casuistes et les décisions des papes se fait par l’interprétation de quelque terme, abusant des principes de l’herméneutique sacrée.
VI, 2. Par exemple le pape Grégoire XIV. a déclaré que les assassins sont indignes de jouir de l’asile des Églises, et qu’on les en doit arracher.
L’édition Molinier indique que la décision de Grégoire XIV se trouve dans la décrétale Cum alias nonnulli, du 28 mai 1591, qui réglemente le droit d’asile accordé aux églises et aux monastères et exclut expressément les assassins et leurs complices ; voir éd. Cognet, p. 96, et GEF V, p. 29. Voir Bullarium romanum, éd. de Turin, t. IX, p. 414.
Sur le droit d’asile, voir Encyclopédie saint Augustin, p. 517 sq.
Provinciales, éd. Cognet, p. 96, renvoie au Bullarium romanum, éd. de Turin, t. IX, p. 424.. L’exclusion concerne non seulement l’assassin, mais les complices.
VI, 2. Cependant nos 24 vieillards disent en la page 660. Que tous ceux qui tuent en trahison ne doivent pas encourir la peine de cette Bulle. Cela vous paraît être contraire, mais on l’accorde, en interprétant le mot d’assassin, comme ils font par ces paroles : Les assassins ne sont-ils pas indignes de jouir du privilège des Églises ? Oui par la bulle de Grégoire XIV. Mais nous entendons par le mot d’assassins, ceux qui ont reçu de l’argent pour tuer quelqu’un en trahison. D’où il arrive que ceux qui tuent sans en recevoir aucun prix, mais seulement pour obliger leurs amis, ne sont pas appelés assassins.
Nos 24 vieillards : voir Provinciale V, 14.
Pascal résume Escobar.
La référence dans le texte primitif, en la page 660, n’est pas précise, puisqu’on ne sait pas à quelle édition elle renvoie. Sur mon édition de 1659, il faudrait p. 698. NB : c’est celle à laquelle renvoie GEF, V, p. 19-20.
La référence à la p. 660 doit permettre de reconnaître l’édition à laquelle Pascal a recours. Voir GEF IV, p. 286 : les éditeurs n’ont pas retrouvé l’édition qui a servi pour la sixième Provinciale, et dont il cite les pages. Mais on trouve effectivement le passage à la page indiquée, dans l’édition de Bologne, 1647.
Cette édition est-elle pour autant celle que Pascal a en main ? Un peu plus bas, il donne la p. 704, qui ne répond pas au texte qu’il cite.
Elle est remplacée dans l’édition de Lyon de 1659 par Tr. 6, ex. 4, n. 27. Voir l’éd. Cognet, p. 96. Pour être complète, la référence devrait être : Tract. VI, Status, Examen IV, De immunitate templorum, Caput III, Quinam sint templi immunitate privati ?
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tract. VI, Examen IV, III, 27, éd. Lyon, Bordes, Arnaud et Rigaud, 1659, p. 698. “Num assassini rei gaudent Ecclesiae privilegio ? Non gaudent, ex Constitut. Greg. XIV. Assassini autem nomine cum intelligo, qui pecunia aut pretio ad hominem incautum occidendum ex insidiis, conducitur. Quare sine pretio aliquem interficit, ut amico rem gratam faciat, non dicitur assassinus. Porro etiam assassini coopoeratores, fautores, auxiliatores, et receptatores, privilegio immunitatis privantur.” Voir GEF V, p. 20.
On a affaire à deux systèmes de référence différents. Le premier, qui est fondé sur la pagination, est précis et facile, mais il ne peut servir que sur une édition, alors que les éditions d’Escobar sont multiples. Pascal va d’abord au plus simple, la pagination ; mais il manque de précision, puisqu’il y a plusieurs éditions. La seconde est plus complexe, mais vaut pour toutes les éditions. Elle est surtout plus technique. Les autres sont moins faciles à noter et à lire, mais ils apportent plus d’information, et ils sont moins équivoques. Mais cette technicité n’éclaire guère le lecteur mondain, puisque Pascal ne donne pas le titre du Traité VI, De statu clericali circa materiam de beneficiis, pensionibus, spoliis clericorum, et rerum ecclesiasticarum alienatione, ni celui de l’Examen IV, De imunitate templorum, ni celui du chapitre III, Quinam sint templi immunitate privati ? C’est une référence purement locale, et non relative à la matière.
Nouët défend la distinction, Impostures XXV, in Réponse aux lettres que les jansénistes publient contre les jésuites, p. 219 : il ne faut pas confondre ceux qui tuent en trahison, et les assassins qui tuent pour de l’argent ; c’est confondre le genre et l’espèce. Escobar demande d’abord si ceux qui tuent en trahison (proditores) sont privés de l’asile des églises, et répond que « carent », c’est-à-dire qu’ils n’en jouissent pas. Il faut dire que, dans les lignes qui précèdent, il ajoute que celui qui tue un ennemi n’est pas appelé un proditor ; Nouët n’en dit rien. En n°27, Escobar pose le problème de l’assassin, défini en son sens ; Nouët estime que sa définition est « selon les termes du droit » (Réponses..., p. 220).
WENDROCK, Lettres Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 363 sq., Note III, Chicane ridicule des jésuites sur le terme d’assassin, en réponse à l’Imposture XXV. Le langage courant, dit Nicole, identifie les verbes tuer en trahison et assassiner un homme, aussi bien que les expressions nominales assassin et homme qui tue en trahison ; Montalte parle le langage ordinaire, et il ne veut pas expliquer les différentes idées que les casuistes attachent sans raison aux termes : p. 365-366. Sens commun du mot assassin selon le Dictionnaire de l’Académie et le Dictionnaire de Furetière : p. 367.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 227 sq. Commentaire du passage. Le P. Daniel se plaint d’une falsification de Pascal non seulement sur la lettre du texte d’Escobar, mais aussi sur le fond, car Escobar aboutit à la conclusion que tous ceux qui contribuent à un assassinat sont privés du droit d’asile des églises. Rappel de l’histoire de la bulle en question : p. 229 sq.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, Paris, Didot 1851, p. 254 sq. Discussion sur le sens italien de assassini. Dans le droit, d’après les canonistes d’Espagne et d’Italie, l’assassin est celui qui tue pour une embûche et pour un prix fixé. Il ne s’agit pas du crime devant Dieu, mais d’une censure ecclésiastique, dans laquelle odiosa sunt restringenda et rigorose applicanda.
JOUSLIN Olivier, Pascal et le dialogue polémique, p. 385 sq. Thème de l’imposture littéraire de l’auteur des Provinciales : p. 385 sq.
Comparer avec la méthode du moliniste pour accréditer une opinion nouvelle dans l’Église d’après le Discours sur la Possibilité des commandements, OC III, éd. J. Mesnard, p. 730-732. La technique consiste à créer une lacune dans la doctrine de l’Église, qui permet de développer des conséquences qui, à terme, aboutissent à contredire les principes de l’orthodoxie. Dans le cas présent, le procédé consiste à définir l’assassin d’une manière qui le distingue de toutes les autres sortes de meurtriers, de telle manière que les mêmes conséquences ne peuvent plus en être tirées. Dans le Discours sur la possibilité des commandements, OC III, éd. J. Mesnard, p. 730-732, Pascal imagine des hérétiques qui raisonnent comme suit : « Nous nous soumettons au concile et anathématisons les luthériens et tous ceux qui disent qu’on ne peut accomplir les commandements quand on est secouru par la grâce ; mais comme le concile ne fait que défendre la nécessité de la grâce pour les observer, sans déclarer qu’elle soit jamais présente, il nous laisse la liberté de dire qu’elle ne l’est jamais, et de soutenir dans cette supposition, sans blesser sa définition, l’impossibilité » continuelle des préceptes ». Cette manière de raisonner consiste à s’appuyer, non sur les passages formels du concile, « mais sur le défaut de passages contraires, non sur une vérité solide et palpable, mais sur le néant, non sur des propositions, mais sur une supposition » : p. 730. Elle conduit à laisser libre cours à la fantaisie des hérétiques.
Le pape Grégoire XIV, Niccolo Sfondrato, 1535-1591
LEVILLAIN, Dictionnaire historique de la papauté, p. 763 sq. Le droit des églises a été réglé par la bulle Cum alias du 24 mai 1591.
VI, 2. De même, il est dit dans l’Évangile : Donnez l’aumône de votre superflu.
Donnez l’aumône de votre superflu : voir Luc, XI, 41, « Verumtamen quod superest date elemosynam, et ecce omnia munda sunt vobis ».
Saint AUGUSTIN, La crise pélagienne, I, Œuvres de saint Augustin, 21, Bibliothèque augustinienne, Paris, Desclée de Brouwer, 1966, p. 95 et note p. 590-591, sur saint Cyprien et le devoir de l’aumône. En théologien, il estime que si le baptême efface les péchés antérieurs, l’aumône rachète les péchés commis après le baptême : p. 591.
VI, 2. Cependant plusieurs casuistes ont trouvé moyen de décharger les personnes les plus riches de l’obligation de donner l’aumône. Cela vous paraît encore contraire, mais on en fait voir facilement l’accord, en interprétant le mot de superflu, en sorte qu’il n’arrive presque jamais que personne en ait. Et c’est ce qu’a fait le docte Vasquez en cette sorte, dans son traité de l’Aumône, c. 4. Ce que les personnes du monde gardent pour relever leur condition et celle de leurs parents n’est pas appelé superflu ; Et c’est pourquoi à peine trouvera-t-on qu’il y ait jamais de superflu dans les gens du monde, et non pas même dans les Rois.
c. 4 : Nicole précise n. 14. La référence de Pascal n’est donc que partielle.
Gabriel Vasquez, 1539-1604 : voir Provinciales, éd. Cognet, p. 97 ; RAPIN René, Mémoires, éd. Aubineau, I, p. 13. Jésuite né en 1551 à Belmonte ; il devient jésuite en 1539, mort le 23 septembre 1604 à Alcala. Il fut professeur à Alcala, puis à Rome. Ses œuvres occupent 10 volumes (Lyon, 1620). Voir sur ses idées HURTUBISE Pierre, La casuistique dans tous ses états. De Martin Azpilcueta à Alphonse de Liguori, Ottawa, Novalis, 2005.
RAPIN René, Mémoires, éd. Aubineau, I, p. 13.
La décision de Vasquez est citée in GEF V, p. 11-13. Mais Pascal ne semble pas être remonté à l’original. Dans la Provinciale VI, il cite Vasquez d’après Diana, Resolutiones morales, pars II, tr. 15, resp. 32, le De eleemosyna, c. 4, dubium 4, n. 14. Mais il a lui-même lu Diana ; voir Laf. 958, les notes qu’il a prises sur ses livres.
Le texte de Vasquez est cité d’après DIANA, Resolutiones morales, Part II, tr. 15, Misc. Resp. 32, in 13e éd., Tres priores partes, 1646, p. 246. « Ex his omnibus respondeo ad propositam quaestionem negative : et licet opinio affirmativa esset vera, tamen in praxi nunquam, aut rarius eveniet. Nam ut ait Vasquez in Opusc. De eleemos. Cap. 4, n. 14 laïci possunt de bonis patrimonialibus servare as statum suum, vel consanguineorum mutandum, et tunc illud non dicitur superfluum. Unde vix ex saecularibus invenies, etiam in regibus, superfluum statui. Illaec Vasquez, quae quidem confessariis divitum multulm plausibilia erunt. » La citation de Vasquez que fait Diana est exacte.
Cognet donne la référence p. 97. De eleemosyna, c. 4, dub. 4, n. 14. Le texte est le suivant : « Secundo quod laici possunt de bonis patrimonialibus servare ad statum suum, vel consanguineorum mutandum, et tunc illud non dicitur superfluum. Unde vix in secularibus invenies etiam in regibus superfluum statui ». La suite précise l’intention de Vasquez : il veut distinguer la condition des laïcs de celle des ecclésiastiques de rang supérieur : « At episcopi et alii ecclesiastici non possunt ex bonis beneficii statum muta re, altiorem, sibi, vel consaguineis, val amicis, ut bene docuit Corduba, quia ista bona non sunt data nisi ad congruam sustentationem : cum ergo urget proximi nécessitas, quod superest congruae sustentationi, proximo ex misericordia debetur, et ita fere nullum invenies, qui pingue habeat beneficium, qui non habeat aut habere possit, si parce viveret ut decet, superfluum statui, et decenti sustentationi : nécessitâtes autem, etiam graves fere nunquam déficient, si quis inquireret ut esset opus. »
Dans ce cas particulier, comme Vasquez est cité par Diana, la référence ne porte pas sur l’original, mais sur la citation.
Les textes de Diana avaient déjà été utilisés par Arnauld dans ses Remontrances aux PP. Jésuites touchant un libelle qu’ils sont fait courir dans Paris sous ce titre : Le manifeste de la véritable doctrine des Jansénistes, Paris, 1651, Œuvres, XXIX. Voir dans GEF V, p. 11, le texte de Diana, tiré de la Remontrance aux Pères jésuites touchant un libelle qu’ils ont fait courir dans Paris, sous ce faux titre : Le manifeste de la véritable doctrine des jansénistes, telle qu’on la doit exposer au peuple composé par l’assemblée du P. R., Paris, 1651 : « Est-ce prescrire des bornes à l’ambition des grands, ou plutôt n’est-ce point les exhorter à n’y en mettre aucune, que de leur enseigner que plus leur ambition sera grande et démesurée, moins ils seront obligés d’être charitables envers les pauvres. Et n’est-ce pas le faire, que de reconnaître d’une part que dans les grandes nécessités ils sont obligés de donner l’aumône de leur superflu, et de ruiner de l’autre, comme fait votre Vasquez, cette obligation importante par cette subtilité pernicieuse : Que tout ce qui peut servir à l’élever à une plus haute condition ou à y élever ses proches, ne doit point être estimé superflu : et ainsi, dit ce moliniste, à peine trouvera-t-on dans les séculiers, non pas même dans les rois, quelque chose qui soit superflu à leur état. D’où le fameux Diana votre bon ami conclut fort bien que suivant cette pensée de Vasquez, la doctrine constante de tous les pères établie sur l’Évangile, qu’on est obligé de donner aux pauvres son superflu, ne sera plus qu’une vaine spéculation, qui n’aura jamais, ou presque jamais aucun lieu dans la pratique : c’est-à-dire, mes Pères, que selon votre morale corrompue, l’ambition est une légitime excuse de ne point faire l’aumône ; que pourvu qu’on ait été bien ambitieux, on ne sera point damné pour n’avoir pas été charitable... »
Le P. Nouët tente de défendre Vasquez dans sa Réponse aux lettres que les jansénistes publient contre les jésuites, p. 3. Pascal y répond dans la Provinciale XII. Sur les doctrines de Vasquez, voir les notes de l’abbé Maynard.
Sur l’écrit du P. Nouët que Pascal reprend, voir Première imposture, in Réponse aux lettres que les jansénistes publient contre les jésuites, p. 93-96 ; texte cité in GEF V, p. 346 sq. : “PREMIÈRE IMPOSTURE. Que les Jésuites favorisent l’ambition des riches, et qu’ils ruinent la miséricorde envers les pauvres, parce que Vasquez dit en son traité de l’aumône, c. 4. Que ce que les personnes du monde gardent pour relever leur condition, et celle de leurs parents, n’est pas appelé superflu, et qu’à peine trouvera-t-on qu’il y ait jamais de superflu dans les gens du monde, non pas même dans les Rois. Lettre 6. p. 1. Edition de Cologne p. 77.
« RÉPONSE. A prendre les paroles de Vasquez dans le sens supposé que leur donne cet écrivain janséniste, l’on dirait qu’il veut dispenser les riches de l’obligation de donner l’aumône. Mais si vous allez à la source pour y trouver le véritable sens de l’auteur, vous verrez avec étonnement qu’il enseigne tout le contraire.
Vasquez dans cet excellent traité prend à tâche de régler le devoir des riches, et montrer pour quelle raison ils sont obligés de secourir les pauvres dans leur besoin : et pour ce sujet il fait distinction des personnes laïques, qui possèdent de grands biens dans le monde, et des ecclésiastiques qui jouissent des biens de l’Église. Quant aux ecclésiastiques, il soutient qu’ils ne peuvent en sûreté de conscience se servir des biens et des revenus de leurs bénéfices pour relever leur condition, ni celle de leurs parents, et qu’ils sont obligés de les employer au soulagement des pauvres, et même de s’enquérir de leurs besoins, parce qu’ils leur tiennent lieu de Pères.
Pour les personnes laïques, qui ont de grandes richesses, soit qu’ils les aient acquises par leur industrie, ou qu’ils les aient trouvées dans leur maison, il assure aussi qu’ils sont obligés sous peine de damnation à donner l’aumône. Mais il demande sur quel principe est fondée cette obligation, et rejetant l’opinion de Cajetan, qui l’établit sur ce qu’un homme riche est tenu de donner aux pauvres le superflu de ses biens, qui est leur partage, il dit que cette raison ne lui semble pas assez forte, et que les riches s’en pourraient facilement défendre, disant qu’ils n’ont rien de superflu ; vu que dans le sentiment même de Cajetan, les personnes du monde peuvent se servir de leurs biens pour relever leur condition par des voies légitimes, statum quem licite possunt acquirere, et pour acquérir des charges, pourvu qu’ils en soient dignes, statum quem digne possunt acquirere (ce sont les mots de Vasquez qu’il répète par deux fois en ce traité ch. I, dub. 3. n. 26 et que le janséniste a supprimés) par conséquent qu’on n’appelle point superflu ce qui leur est nécessaire pour y parvenir. D’où il conclut qu’il faut établir ce devoir sur un autre fondement qui le rende indispensable, qui est celui de la charité, qui n’oblige pas seulement les riches à faire l’aumône du superflu de leurs biens, mais encore du nécessaire dans le sens que je viens de dire. Cette doctrine n’est-elle pas toute contraire à celle qu’on lui attribue ? Se peut-il voir une imposture plus visible ? Je prie le lecteur de voir ce traité et de commencer par le premier chapitre, où il parle des obligations des riches du siècle. Je l’assure qu’il ne sera pas moins édifié de la prudente conduite de ce Père, qu’étonné de la malice de son calomniateur.
Avertissement aux Jansénistes.
Il faut que je rende le bien pour le mal, et la vérité pour le mensonge. J’avertis donc les disciples de Jansénius, que toutes les aumônes qu’ils tirent des veuves, et tous les testaments qu’ils leur font faire en faveur du Jansénisme condamné par le Pape, f sont autant de larcins qui tiennent en quelque façon du sacrilège : parce qu’ils abusent d’un bien donné à Dieu contre l’Église de Dieu : et que les personnes riches qui font subsister ce parti hérétique, soit qu’ils y contribuent de leur autorité ou de leurs richesses, se rendent complices de leur rébellion, et se perdent avec eux”
a. Le Ministre du Moulin reproche aussi à l’Église, qu’elle ruine les aumônes, mais d’une autre manière, page 344. Par les indulgences un homme est déchargé des aumônes et oraisons enjointes, qui est un grand soulagement. Armill. ver. Indulg. dist. 22. q. 4.
b. Quod ex superfluo teneantur beneficiarii alere pauperes, illud juris etiam divini est : alias posset Summus Pontifex dispensare, ut quis ex superfluo consanguineos ditaret, quod non est credibile ; et paulo post : In Clerico enim beneficiario, quia pater est, lex charitatis obligat de superfluo, in quo excedit oligationem saeculanum. Vasq. de Eleem. 4. n. 11.
c. Ecclesiastici vero, praecipue Episcopi, tenentur pauperes inquirere, quia sunt pauperum parentes, et esse debet illorum cura erga pauperes. Ib. n. 14.
d. Sed contra est, quod si necessarium, quod aliquis meo superfluo egeat, ut ego tenear erogare illud : ergo non tantum superfluum est ratio dandi ellëmosynam, sed etiam alterius necessitas : ratio ergo illius obligationis illinc nascitur, quod charitas postulet, ut mihi superfluum, quod est alteri necessarium, illi erogem, ne alius indigeat. C. 1. d. 3. n. 21.
e. Ordo ergo charitatis talis esse debet, etc. vitam enim proximi cum detrimento vitae meae non teneor tueri, cum detrimento caeterorum teneor, et sic de reliquis, alias quomodo charitas Dei manet in nobis ? C. 1. dub. 3. n. 25.
Secundo, si alicui imminet periculum famae amittejdae, tenetur quis cum detrimento sui status, et rei familiaris superfluae naturae similem necessitatem propellere, ut ordinata sit charitas.
Tertio, si alicui immineat periculum cadendi a statu suo, tenetur quis ex superfluo status illi subvenire. Ibidem n. 26.
f. Res pauperum non pauperibus dare pars sacrilegium est. Ber. »
Sur la doctrine de Vasquez, voir Provinciales, éd. Cognet, p. 223.
PASCAL, Œuvres complètes, I, éd. Le Guern, p. 1177.
Pascal répond dans la XIIe Provinciale, 2, éd. Cognet, p. 217-223, où la question est rediscutée, à propos de la réponse du P. Nouët dans sa Première imposture, in Réponses, p. 93 sq. Pascal ne mentionne pas la question des ecclésiastiques, mais il recourt à un autre passage de Vasquez, où il déclare que la décision de Corduba sur l’obligation de l’aumône sur le superflu. Mais cette fois, Pascal ne s’est apparemment pas contenté de lire Diana, il semble avoir été à l’original de Vasquez. Voir De eleemosyna, ch. I, Dub. III, c. 32, p. 16. « Cordubae placitum in quo conveniat cum autore, et in quo dissentiat. Postea tamen legi Cordubam in quaestionario q. 26. lib. I et in aliquibus nobiscum convenit, in aliis vero differt. Primo de extrema necessitate idem quod nos asserit. Secundo cum quis habet superfluum status, sentit quod etiam si non sint nécessitâtes urgentes, tenetur communiter egentibus aliquid tribuere, licet non totum superfluum, ut saltem in aliquo praeceptum impleatur, nec in totum omittatur. Sed hoc non placet, supra enim contra Cajetanum et Navarrum contrarium probavimus. Et sane si ad id teneretur, ad totum superfluum erogandum obligandus esset. »
Le P. Nouët va être conduit par la réponse de Pascal dans la XIIe Provinciale, à répondre à son tour : voir NOUËT, Réponse à la XIIe lettre, in Réponse aux lettres que les jansénistes publient contre les jésuites, p. 297 sq. Il fait la critique des coupes faites par Pascal dans la citation de Vasquez. Pascal n’oserait, contre Cajetan et Vasquez, prétendre qu’il est interdit de soutenir sa condition par des voies légitimes, ce que précise Vasquez, “statum quem licite possunt acquirere”. On ne voit pas le licite dans GEF V, p. 12. Nouët avait déjà argué de la présence de ce mot dans Imposture I, in Réponses, p. 13 sq., cité in GEF V. Voir p. 93 sq., sur le texte de Vasquez : Nouët rapproche ce reproche de ceux de Du Moulin. Réfutation de l’idée que Vasquez dispense pratiquement les riches de l’aumône : p. 301. Vasquez distingue le cas des personnes laïques et celui des ecclésiastiques : p. 93-94. Pascal omet de dire que Vasquez distingue plusieurs sortes de nécessaire et de superflu : par rapport à la vie, à l’honneur, à la condition présente, dans l’absolu, etc. Nouët montre que Vasquez est plus sévère que Cajetan : p. 304. Vasquez dirait qu’il faut établir le devoir d’aumône sur celui de charité : p. 95-96.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 232 sq., dénonce une falsification de la citation de Vasquez, qui a dit « qu’à peine trouvera-t-on que les gens du monde aient du superflu par rapport à leur état ». Explication de sa doctrine : p. 235 sq. Problème du fondement de l’aumône : p. 235-236. Différentes sortes de superflu : p. 236. Critique du raisonnement de Pascal : p. 239. Il invente une proposition qui n’est pas de Vasquez, que les riches ont rarement du superflu : p. 239.
L’abbé Maynard donne dans les notes de son édition des Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot, 1851, p. 255 sq., une présentation des idées de Vasquez sur l’aumône. Il reprend d’ailleurs la réponse du P. Nouët que Vasquez, trouvant insuffisant le motif qui oblige à l’aumône sur le superflu à la commodité, prétend le fonder plus solidement sur la charité. Il y a diverses sortes de superflus selon Vasquez :
nécessaire et superflu à l’égard de la vie,
superflu à la vie et nécessaire à l’égard de l’honneur,
superflu à l’honneur et nécessaire à l’égard de la condition présente,
superflu à la condition présente et nécessaire à l’égard de la condition qu’on peut acquérir,
superflu à tous égards, dont on n’a besoin ni pour le présent, ni pour l’avenir, ni pour soi, ni pour sa famille.
On peut en citer le passage suivant, p. 257.
« Les biens se classent en nécessaires et en superflus. Il y a nécessaire au superflu au regard de la vie, superflu à la vie et nécessaire à l’honneur, superflu à l’honneur et nécessaire à la condition présente, superflu à la condition présente et nécessaire à la condition qu’on peut acquérir, et enfin superflu à tous égards, dont on n’a besoin ni pour le présent, ni pour l’avenir, ni pour soi, ni pour sa famille.
Les nécessités du prochain se divisent en extrêmes, en graves et en communes, suivant que sa vie est menacée ou sa santé », son honneur, sa condition, ou qu’enfin il se procure avec peine ce que réclame la nature.
Toutes ces distinctions établies, Vasquez pose ce principe : Je ne suis pas obligé à secourir mon prochain, s’il m’en doit coûter un bien égal à celui qu’il perdrait sans mon assistance ; mais il y a obligation pour moi de lui venir en aide au prix de quelque bien que ce soit moindre que celui qu’il va perdre : tel est l’ordre de la charité. Principe admirablement sage, dont il tire toutes ses conséquences pratiques.
1. Dans le cas de nécessité extrême, obligation de secourir le prochain de tout le superflu à la vie et du nécessaire à la condition.
2. Même obligation dans certaines nécessités graves, par exemple, lorsque la misère va conduire le prochain à quelque maladie sérieuse, ou qu’il est en danger de perdre sa réputation, bien plus précieuse que l’or. Autrement, dit-il, comment est-ce que la charité de Dieu demeure en moi ?
Jusqu’ici Vasquez est exact et même sévère, plus sévère que Cajetan et la plupart des théologiens qui restreignent au cas de nécessité extrême l’obligation de donner du nécessaire à son état, obligation qu’il étend, lui, à certaines nécessités graves.
(…)
4. Dans les nécessités communes, il n’y a d’obligation de secourir les pauvres que du superflu. Seulement Vasquez établit ici entre les ecclésiastiques et les laïques une double distinction (…). C’est un devoir pour les ecclésiastiques d’aller chercher les pauvres, dont ils sont les protecteurs et les pères ; ce à quoi les laïques ne sont pas obligés. Comme les laïques, dans les nécessités extrêmes et quelques nécessités graves, ils doivent faire l’aumône du superflu à leur état, et même du nécessaire. Mais la notion de superflu n’est pas la même pour eux que pour les laïques, car tout ce qui leur reste en dehors de leur entretien est pour eux du superflu, et ils ne peuvent en rien garder pour relever leur condition ni celle de leurs parents ; tandis qu’on n’appelle pas superflu chez les laïques ce qu’ils destinent à l’amélioration de leur état. Et alors viennent les paroles qui forment la première partie de la proposition condamnée pat Innocent X : A peine trouverez-vous du superflu à l’état dans les gens du monde, et même dans les rois. Comment les entendre ? Veut-il dire que tous les riches et tous les rois n’ont jamais de superflu ? Non, croyons-nous ; mais seulement qu’il peut arriver que les rois eux-mêmes n’en aient pas. Du reste, cela est sans conséquence pour les aumônes ordinaires et de tous les jours, qui n’empêchent pas de conserver son état, et même de le relever. Ne confondons jamais avec la pratique les abstractions rigoureuses de la théorie. »
WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, II, p. 214 sq. Défense de Pascal sur l’aumône.
FERREYROLLES Gérard, Pascal et la raison du politique, p. 62 sq.
JOUSLIN Olivier, Pascal et le dialogue polémique, p. 387 sq. Voir p. 546 sq., la réponse des Impostures sur le superflu. Voir aussi p. 601 sq. et p. 617 sq. : la réponse de Port-Royal à la critique formulée par le P. Nouët confirme l’idée que la Provinciale XII attribuait à Vasquez, il ne faut qu’avoir beaucoup d’ambition pour n’avoir pas de superflu : p. 618.
Le superflu et l’aumône
Sur l’aumône, voir la note de Provinciale VI, 2-3, éd. Cognet, p. 96-97.
Voir Abbé A., La doctrine catholique, § 302, p. 231 sq. Au sens général, le mot aumône désigne toute œuvre de miséricorde spirituelle ou corporelle, accomplie par charité chrétienne ; au sens restreint, le mot s’entend de tout secours matériel par lequel on vient en aide au prochain lorsqu’il est dans la misère ; c’est une contribution matérielle donnée à un indigent pour le retirer de son état misérable. C’est un devoir qui s’impose aux riches : p. 232. Sur les mesures et les formes de l’aumône, voir § 303, p. 234 sq. L’aumône doit être proportionnée aux moyens de celui qui possède. On distingue entre le nécessaire à la vie (nourriture, vêtement, logement) et nécessaire à la condition (frais exigés par le rang social) ; le superflu est ce qui n’est nécessaire ni à la vie, ni à la condition. Mais il est aussi proportionnel à la nécessité de celui qui sollicite : p. 234. Applications : on distingue nécessité extrême, nécessité pressante, nécessité commune ; selon les cas, on doit secourir avec le nécessaire, ou avec le superflu : p. 235. Distinction entre l’aumône occasionnelle et l’aumône permanente : p. 235 sq.
PONTAS Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 185-186. Article Aumône.
Sur l’aspect social de l’aumône, voir BLUCHE François (dir.), Dictionnaire du grand siècle, p. 1104 sq., article Œuvres de miséricorde. L’importance de l’aumône se mesure par exemple par le sermon célèbre de Bossuet sur l’éminente dignité des pauvres dans l’Église. Les organisations chrétiennes destinées à venir en aide aux misérables sont très nombreuses, aussi bien du côté des augustiniens que de leurs adversaires. Pascal, lorsqu’il lance l’affaire des carrosses à cinq sols, a pour but d’en verser les bénéfices aux pauvres de Blois, et il en fait don, en fin de compte, aux hôpitaux de Paris. Monsieur Vincent a aussi donné une puissante impulsion aux actions de charité. L’entreprise ne se limitait d’ailleurs pas à l’aspect matériel de la pauvreté ; l’effort portait aussi sur l’enseignement des pauvres.
On braillait moins qu’aujourd’hui contre les injustices sociales, mais on s’y attaquait avec plus d’ardeur et d’efficacité.

Abraham Bosse, Les sept œuvres de miséricorde, Donner à manger à ceux qui ont faim
Saint AUGUSTIN, La crise pélagienne, I, Œuvres, 21, Paris, Bibliothèque augustinienne, Desclée de Brouwer, p. 590.
RAPIN René, Mémoires..., II, éd. Aubineau, p. 370 sq. « Rien n’est plus difficile dans la morale que de bien régler en quoi consiste ce superflu... »
Il y a dans ces décisions des casuistes sur l’aumône quelque chose qui devait choquer directement Pascal, chez qui l’aumône et le secours des pauvres a été un souci constant ; voir sur ce point la Vie de Pascal de Gilberte, première version, § 52, OC I, éd. J. Mesnard, p. 588 : « Cet amour qu’il avait pour la pauvreté le portait à aimer le pauvres avec une tendresse si grande qu’il n’a jamais pu refuser l’aumône quoiqu’il n’en fît que de son nécessaire, ayant peu de bien et étant obligé de faire une dépense qui excédait son revenu à cause de ses infirmités. Mais lorsqu’on lui voulait représenter cela quand il faisait quelque aumône considérable, il se fâchait et disait : « J’ai remarqué une chose, que quelque pauvre qu’on soit, on laisse toujours quelque chose en mourant ». Et ainsi il fermait la bouche ; et il a été quelquefois si avant qu’il s’est réduit à prendre de l’argent au change, pour avoir donné aux pauvres tout ce qu’il avait, et ne voulant pas après cela importuner ses amis. ». Le § 53 rapporte l’emploi que Pascal a fait des bénéfices de l’entreprise des carrosses à cinq sols. Après quoi Gilberte précise en ces termes la pensée de son frère sur la signification du nécessaire et du superflu dans l’aumône, § 54, OC I, p. 589 : « Sa charité envers les pauvres avait toujours été fort grande, mais elle était si fort redoublée à la fin de sa vie que je ne pouvais le satisfaire davantage que de l’en entretenir (...). Il nous disait encore que la fréquentation des pauvres est extrêmement utile, en ce que, voyant continuellement les misères dont ils sont accablés, et que même dans l’extrémité de leurs maladies ils manquent des choses les plus nécessaires, qu’après cela il faudrait être bien dur pour ne pas se priver volontairement des commodités inutiles et des ajustements superflus ». Voir aussi le § 68, p. 595, dans lequel Gilberte rapporte une note retrouvée dans les papiers de son frère : « J’aime la pauvreté, parce que Jésus-Christ l’a aimée. J’aime les biens, parce qu’ils donnent le moyen d’en assister les misérables. » Voir le § 80, § 598-599 : « Il fit même son testament pendant ce temps-là, où les pauvres ne furent pas oubliés, et ils se fit violence pour ne leur pas donner davantage, car il me dit que si M. Périer eût été à Paris, et qu’il y eût consenti, il aurait disposé de tout son bien en faveur des pauvres. Enfin il n’avait rien dans l’esprit et dans le cœur que les pauvres, et il me disait quelquefois : « D’où vient que je n’ai jamais rien fait pour les pauvres, quoique j’air toujours eu un si grand amour peur eux ? » Je lui dis : « C’est que vous n’avez jamais eu assez de bien pour leur donner de grandes assistances ». Il me répondit : « Puisque je n’avais pas de bien pour leur en donner, je devais leur avoir donné mon temps et ma peine ; c’est à quoi j’ai failli ; et si les médecins disent vrai, et que Dieu permette que je relève de cette maladie, je suis résolu de n’avoir point d’autre emploi ni d’autre occupation tout le reste de sa vie que le service des pauvres ». Ce sont là les sentiments dans lesquels Dieu l’a pris ». Il est clair que, dans ces dispositions, le pinaillage des casuistes sur le nécessaire et le superflu ne pouvait que heurter Pascal.
VI, 3. Aussi Diana ayant rapporté ces mêmes paroles de Vasquez, car il se fonde ordinairement sur nos Pères, il en conclut fort bien. Que dans la question : Si les riches sont obligés de donner l’aumône de leur superflu encore que l’affirmative fût véritable, il n’arrivera jamais, ou presque jamais, qu’elle oblige dans la pratique.
DIANA Antonio, Resolutionum moralium partes duodecim, 2 vol., Palerme, 1623-1641 ; editio XIII, Lugduni, 1646-1650, 2 vol.
Texte cité dans GEF V, p. 12. « Ex his omnibus respondeo ad propositam quaestionem negative : et licet opinio affirmativa esset vera, tamen in praxi nunquam, aut rarius eveniet ». Diana renvoie alors à Vasquez, Opusc. De eleemos. Cap. 4, dub. 4, n. 14.
La source, selon M. Le Guern, est la Remontrance aux pères jésuites d’Arnauld, p. 33-34. Voir dans GEF V, p. 11, le texte de Diana, tiré de la Remontrance aux Pères jésuites touchant un libelle qu’ils ont fait courir dans Paris, sous ce faux titre : Le manifeste de la véritable doctrine des jansénistes, telle qu’on la doit exposer au peuple composé par l’assemblée du P. R., Paris, 1651 : « Est-ce prescrire des bornes à l’ambition des grands, ou plutôt n’est-ce point les exhorter à n’y en mettre aucune, que de leur enseigner que plus leur ambition sera grande et démesurée, moins ils seront obligés d’être charitables envers les pauvres. Et n’est-ce pas le faire, que de reconnaître d’une part que dans les grandes nécessités ils sont obligés de donner l’aumône de leur superflu, et de ruiner de l’autre, comme fait votre Vasquez, cette obligation importante par cette subtilité pernicieuse : Que tout ce qui peut servir à l’élever à une plus haute condition ou à y élever ses proches, ne doit point être estimé superflu : et ainsi, dit ce moliniste, à peine trouvera-t-on dans les séculiers, non pas même dans les rois, quelque chose qui soit superflu à leur état. D’où le fameux Diana votre bon ami conclut fort bien que suivant cette pensée de Vasquez, la doctrine constante de tous les pères établie sur l’Évangile, qu’on est obligé de donner aux pauvres son superflu, ne sera plus qu’une vaine spéculation, qui n’aura jamais, ou presque jamais aucun lieu dans la pratique : c’est-à-dire, mes Pères, que selon votre morale corrompue, l’ambition est une légitime excuse de ne point faire l’aumône ; que pourvu qu’on ait été bien ambitieux, on ne sera point damné pour n’avoir pas été charitable... »
Pascal revient sur ce texte dans Provinciale XII, 6, éd. Cognet, p. 220. « Vous vous plaignez ensuite hautement de ce qu’après avoir rapporté cette maxime de Vasquez : A peine se trouvera-t-il que les gens du monde, et même les Rois, aient jamais de superflu, j’en ai conclu que les riches sont donc à peine obligés de donner l’aumône de leur superflu. Mais que voulez-vous dire, mes Pères ? S’il est vrai que les riches n’ont presque jamais de superflu, n’est-il pas certain qu’ils ne seront presque jamais obligés de donner l’aumône de leur superflu ? Je vous en ferais un argument en forme, si Diana, qui estime tant Vasquez, qu’il l’appelle le Phénix des esprits, n’avait tiré la même conséquence du même principe. Car, après avoir rapporté cette maxime de Vasquez, il en conclut : Que dans la question, savoir si les riches sont obligés de donner l’aumône de leur superflu, quoique l’opinion qui les y oblige fût véritable, il n’arriverait jamais, ou presque jamais, qu’elle obligeât dans la pratique. Je n’ai fait que suivre mot à mot tout ce discours. Que veut donc dire ceci, mes Pères ? Quand Diana rapporte avec éloge les sentiments de Vasquez, quand il les trouve probables, et très commodes pour les riches, comme il le dit au même lieu, il n’est ni calomniateur ni faussaire, et vous ne vous plaignez point qu’il lui impose : au lieu que, quand je représente ces mêmes sentiments de Vasquez, mais sans le traiter de phénix, je suis un imposteur, un faussaire et un corrupteur de ses maximes. »
On trouve dans les Pensées (Laf. 958 (éd. du Luxembourg) ou Laf. 956 (Seuil), Sel. 793), des notes prises par Pascal sur Diana. Voici le texte :
« C’est à quoi sert Diana.
11. Il est permis de ne point donner les bénéfices qui n’ont pas charge d’âmes aux plus dignes ; le Concile de Trente semble dire le contraire. Mais voici comme il le prouve, car si cela était tous les prélats seraient en état de damnation. Car ils en usent tous de la sorte.
11. Le roi et le pape ne sont point obligés de choisir les plus dignes. Si cela était, le pape et les rois auraient une terrible charge.
21. Et ailleurs si cette opinion n’était pas vraie les pénitents et les confesseurs auraient bien des affaires, et c’est pourquoi j’estime qu’il faut la suivre dans la pratique.
(21. Si cette opinion était vraie touchant la restitution, O qu’il y aurait de restitutions à faire.)
Et en un autre endroit où il met les conditions nécessaires pour faire qu’un péché soit mortel, il y met tant de circonstances qu’à peine pèche-t-on mortellement et après l’avoir établi, il s’écrie : O que le joug du Seigneur est doux et léger.
11. Et ailleurs l’on n’est pas obligé de donner l’aumône de son superflu dans les communes nécessités des pauvres. Si le contraire était vrai il faudrait condamner la plupart des riches et de leurs confesseurs.
Ces raisons-là m’impatientaient lorsque je dis au Père : mais qui empêche de dire qu’ils le sont. Diana.
C’est ce qu’il a prévu aussi en ce lieu me répondit-il, ou après avoir dit - 22 - si cela était vrai les plus riches seraient damnés. Il ajoute : à cela Arragonius répond qu’ils le sont aussi et Bauny, jésuite ajoute, de plus, que leurs confesseurs le sont de même mais je réponds avec Valentia, autre jésuite, et d’autres auteurs qu’il y a plusieurs raisons pour excuser ces riches et leurs confesseurs.
J’étais ravi de ce raisonnement quand il me finit par celui-ci :
Si cette opinion était vraie pour la restitution, O qu’il y aurait de restitutions à faire !
O mon Père, lui dis-je, la bonne raison. - O, me dit le Père, que voilà un homme comme. - O, mon Père, répondis-je, sans vos casuistes qu’il y aurait de monde damné. (O répliqua-t-il qu’on a tort de ne nous pas laisser en parler) - O mon Père, que vous rendez large la voie qui mène au ciel ! O qu’il y a de gens qui la trouvent ! Voilà un... »
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 260. Selon Maynard, Diana ne parle ici que des nécessités communes, qu’il n’y a pas péché mortel à ne pas soulager.
VI, 4. Je vois bien, mon Père, que cela suit de la doctrine de Vasquez. Mais que répondrait-on si on objectait, qu’afin de faire son salut, il serait donc aussi sûr selon Vasquez d’avoir assez d’ambition pour n’avoir point de superflu, qu’il est sûr selon l’Évangile, de n’avoir point d’ambition pour donner l’aumône de son superflu. Il faudrait répondre, me dit-il, que toutes ces deux voies sont sûres selon le même Évangile, l’une selon l’Évangile dans le sens le plus littéral et le plus facile à trouver, l’autre selon le même Évangile interprété par Vasquez. Vous voyez par là l’utilité des interprétations.
Texte de 1659 : « Je vois bien, mon Père, que cela suit de la doctrine de Vasquez ; mais que répondrait-on, si l’on objectait qu’afin de faire son salut, il serait donc aussi sûr, selon Vasquez, de ne point donner l’aumône, pourvu qu’on ait assez d’ambition pour n’avoir point de superflu, qu’il est sûr, selon l’Évangile, de n’avoir point d’ambition, afin d’avoir du superflu pour en pouvoir donner l’aumône ? ».
L’utilité : Wendrock traduit quanta commoditas. Le mot peut signifier avantage.
Sur ce passage, voir NOUËT, Réponse à la douzième lettre..., in Réponse aux lettres que les jansénistes publient contre les jésuites, p. 299.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 234 ; voir p. 245 sq., l’analyse de ce passage.
VI, 5. Mais quand les termes sont si clairs qu’ils n’en souffrent aucune ; alors nous nous servons de la remarque des circonstances favorables, comme vous verrez par cet exemple. Les Papes ont excommunié les religieux qui quittent leur habit, et nos 24 vieillards ne laissent pas de parler en cette sorte p. 704. En quelles occasions un Religieux peut-il quitter son habit sans encourir l’excommunication ? Il en rapporte plusieurs, et entre autres celles-ci. S’il le quitte pour une cause honteuse, comme pour aller filouter, ou pour aller incognito en des lieux de débauche, le devant bientôt reprendre. Aussi est-il visible que les bulles ne parlent point de ces cas-là.
En quelles occasions un religieux peut-il quitter son habit sans encourir l’excommunication ? : voir GEF V, p. 20 : voir Escobar, n. 103, p. 734, « Quandonam religiosus sine excommunicatione potest habitum exuere ? Si in loco secreto exuat, ut commodius ei sit, velut melius currat, et saltet. Vel si injuste gravatus a praelato immediato fugiat as superiorem sine habitu, ne agnitus comprehendatur. Vel si ad turpem causam, v. gr. Ut furetur occulte, vel fornicetur, illum dimittat mox reassumpturus. Sanchez ita. » Escobar cite Sanchez comme référence. La citation de Pascal est exacte. Wendrock reprend le texte d’Escobar.
L’impression originale donne la référence p. 704. Elle est citée dans GEF V, p. 31. C’est bien la page à laquelle on trouve le passage dans l’édition de 1647. Noter que le plan n’est pas le même qu’en 1659. Le texte est le suivant : « Quandonam religiosus sine excommunicatione poteste habitum exuere. Si in loco secreto exuat, ut coùmmodius ei sit, vel ut melius currat, et saltet. Vel si injuste gravatus a praelato immediatus fugiat ad superiorem sine habitu, ne agnitus comprehendatur. Vel si ad turpem causam, v. g. ut furetur occulte, vel fornicetur, ilum dimittat mox reassumpturus. Sanchez ita. »
Le verbe fornicare ne signifie pas exactement qu’on aille opérer en un lieu de débauche. Mais ce sera donné immédiatement après, à partir d’une citation de Diana.
Cognet donne pour référence Escobar, p. 734, sans préciser l’année d’édition. Cela correspond à l’édition de 1659. Le texte est cité dans GEF V, p. 20, qui donne la même pagination que Cognet.
Le visiteur demandant à voir la citation dans l’original, il est juste que le lecteur d’aujourd’hui puisse vérifier l’exactitude du fait par lui-même.

« 103. Quandonam religiosus sine excommunicatione poteste habitum exuere ? Si in loco secreto exuat, ut commodius ei sit, vel ut melius currat, et saltet. Vel si injuste gravatus à praelato immediato fugiat ad superiorem sine habitu, ne agnitis comprehenderetur. Vel si ad turpem causam, v. g. ut furetur occulte, vell fornicetur, illum dimittat mox reassumptus. »
A la place de la référence p. 704, qui se trouve dans la première impression, Wendrock substitue tr. 6, ex. 7, n. 103, comme l’indique l’édition Cognet. Cette référence est exacte, et plus commode, car dans certaines éditions d’Escobar, la référence à la page est différente (p. 734 dans l’édition de Lyon, 1659).
Aussi est-il visible... : l’édition de 1659 donne Aussi il est visible...
Filou : ce mot originairement et proprement signifie un petit corps d’ivoire large de quatre doigts, de figure prismatique, qui a six pans ou cannelures, dont on a fait un jeu en le roulant sur une table unie, où l’on ne gagne que quand il s’arrête sur une autre cannelure que celle qui est marquée de noir. Mais comme à ce jeu le maître peut facilement tromper, soit en chargeant de plomb quelqu’un des endroits de ce petit corps, soit en inclinant un peu plus le plan sur lequel on le pousse, on a appelé filous tous ceux qui se servent de quelque tromperie pour gagner au jeu. Filou se dit par extension de tous ceux qui se servent de mauvaises voies pour s’emparer du bien d’autrui : comme de ceux qui sous prétexte de belles espérances, trompent les imprudents et de bonne foi, en les engageant dans des affaires dont ils tirent tout le profit par devers eux. Filou : se dit aussi d’un tireur de laine, de celui qui vole par adresse ou par surprises. Filouter : tirer la laine, ou voler et tromper quelqu’un par de mauvaises voies et artifices.
PONTAS Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 349-350. Circonstances. On appelle circonstance tout accident sans lequel une action peut subsister, et qui rend plus ou moins bonne, ou plus ou moins mauvaise, l’action qu’elle accompagne. Nos actions morales peuvent avoir sept circonstances qui sont comprises dans ce vers : Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.
Mais quand les termes sont si clairs qu’ils n’en souffrent aucune : Contravention au principe interpretatio cessat in claris. Voir PERELMAN Chaïm, Logique juridique, p. 36. Dans l’interprétation des lois, si le sens obvie suffit, il faut s’y tenir. Voir DOMAT Jean, Traité des lois, p. 25 : Si les termes d’une loi expriment nettement le sens et l’intention, il faut s’y tenir.
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 184. Le cas de Diana qui demande si le religieux qui quitte son habit pour une cause honteuse, commettre un vol ou aller au lupanar, est soumis à l’excommunication prévue par la bulle du pape Pie V, Contra clericos, qui mentionne le cas de l’habit religieux. Diana ne dit pas qu’un religieux qui agit de la sorte ne commet pas un péché mortel.
En fait Pascal n’allègue pas ici Diana, mais Escobar, qui se recommande de Vasquez.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 246 sq. Analyse de ce passage ; explication du contexte de la citation et de la pensée d’Escobar : p. 247 sq. « Il y a, me dit-il, plusieurs décrets contre les religieux qui quittent leur habit et sortent de leur cloître à l’insu de leurs supérieurs. Celui dont il s’agit ici est le chapitre Ut periculosa, qui défend aux religieux sous peine d’excommunication de quitter témérairement leur habit pour aller aux écoles publiques ou ailleurs. Les canonistes demandent, si en vertu de ce chapitre, tout religieux qui quitte son habit, dès là qu’il le quitte, encourt l’excommunication. Et ils répondent tous que ce décret, comme tous les autres, doit être entendu selon l’intention du législateur, c’est-à-dire du pape qui l’a fait ; que cette intention est manifeste par ces termes : Ut periculosa religiosis evagandi materia subtrahatur. Afin d’ôter aux religieux l’occasion de courir hors de leurs cloîtres avec danger de se perdre : qu’ainsi un religieux qui se déguise et va en cet équipage hors du monastère se promener et se divertir, est excommunié. De sorte qu’à plus forte raison un religieux qui quitterait son habit pour aller filouter, ou pour aller incognito en des lieux de débauche, encourrait sans doute l’excommunication.
Cela posé, les canonistes marquent diverses occasions où le religieux pourrait quitter son habit sans encourre l’excommunication ; les unes, où il le pourrait sans péché, les autres où il le pourrait sans péché mortel. C’est ce que fait Escobar en proposant ainsi la question. Quandonam religiosus potest sine excomunicatione habitum exuere ? Et il répond qu’il n’encourt point l’excommunication dans les cas suivants qu’il apporte pour exemple.
1. S’il ne quitte son habit qu’afin de se mettre à son aise, ou pour courir et sauter plus commodément en quelque lieu où il ne sera vu de personne, Si in loco secreto exuat, ut commodius ei sit, velut melius currat, et saltet. 2. Si étant opprimé par son supérieur immédiat, il se déguise pour aller en sûreté trouver son supérieur médiat : Vel si injuste gravatus a praelato immediato fugiat as superiorem sine habitu, ne agnitus comprehendatur. 3. Quand même il quitterait son habit pour une fin criminelle, par exemple pour dérober en cachette, ou pour faire quelque chose de pis, devant le reprendre aussitôt : Vel si ad turpem causam, v. gr. Ut furetur occulte, vel fornicetur, illum dimittat mox reassumpturus. Et ce sont ces dernières paroles qu’il a plu à Pascal de traduire, ou plutôt de paraphraser ainsi : S’il le quitte pour une cause honteuse, comme pour aller filouter ou pour aller incognito en des lieux de débauche. Mais ce n’est là nullement le sens d’Escobar.
Car par ces exceptions et ces exemples il prétend instruire un confesseur du sens précis du décret, qui défend seulement aux religieux de changer d’habit pour aller hors du monastère, et y être avec plus de liberté ; et par lequel le pape n’a pas pensé à excommunier celui qui quitterait premièrement son habit dans le couvent, quand même il le ferait avec une intention mauvaise et peu honnête » : p. 247-249.
L’explication du P. Daniel est difficilement recevable : le texte d’Escobar se présente sous la forme d’une question suivie de sa réponse, sans aucune allusion à un décret dont il donnerait l’explication.
RAPIN René, Mémoires..., II, éd. Aubineau, p. 372 sq. La plainte de Pascal “est plausible en apparence et injuste en effet. L’excommunication n’étant que pour ceux qui scandalisent leur habit en le déshonorant par des actions scandaleuses, il ne doit pas y avoir d’excommunication quand il n’y a pas de scandale. Voilà la doctrine des jésuites...”
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 260 sq. Défense d’Escobar sur cette proposition.
CARIOU Pierre, Pascal et la casuistique, p. 65 sq. Sur le port réglementaire des habits des religieux : p. 66.
Sur la fréquentation des cabarets par les fidèles et par les ecclésiastiques, envisagée par un casuiste ami de Port-Royal, Jacques de Sainte-Beuve, voir CARIOU Pierre, Les idéalités casuistiques. Aux origines de la psychanalyse, Paris, P. U. F., 1992, p. 169 sq. L’esprit n’est manifestement pas le même que chez les casuistes à la mode jésuite. Le principe est que les ecclésiastiques qui vont aux cabarets offensent Dieu actuellement. La défense est valable pour tout temps, à l’exception de la « nécessité des voyages », p. 170. Les ecclésiastiques qui vont boire et manger dans les cabarets hors nécessité encourent l’excommunication. Le cabaret est en effet un lieu qui porte à l’intempérance, et un lieu « où ceux qui s’assemblent ne s’occupent à rien de bon » ; enfin la promiscuité qui y règne favorise les désordres, l’impudicité et la licence. Le règlement du cas d’un prêtre porté sur le bistrot est expressément réservé à l’évêque : p. 171. Il n’est nulle part question d’adoucissement de ces maximes, qui sont justifiées par une longue suite de décisions conciliaires et synodales.
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 221. Réponse du P. Pirot, Apologie pour les casuistes, p. 67-68, sur le problème du prêtre qui se rend au lupanar. « Il n’a pas plus de raison de reprendre les casuistes qui excusent un religieux qui aurait quitté pour peu de temps son habit, afin de se transporter dans un lieu de débauche. Et pour voir comme il sont bien fondés, il est expédient de savoir ce qui meut Boniface VIII à excommunier les religieux qui quitteraient témérairement leurs habits, et à faire cette constitution qui commence, ut periculose, au titre, ne clerici vel monachi in sexto. C’est que du temps de ce pape, plusieurs religieux sortaient de leurs couvents et quittaient leur habit pour vaguer et courir çà et là sans être reconnus. Ce qui fomentait grandement les désordres qui s’étaient glissés en plusieurs monastères. A l’occasion de cette constitution, plusieurs cas arrivèrent, sur quoi on consulta les canonistes, par exemple si un religieux quittait son habit dans sa chambre, pour étudier plus commodément, s’il était excommunié ; la plupart des canonistes répondirent que non. Si un religieux s’oubliait de ses vœux, jusques à quitter son habit, pour aller à un lieu de débauche, et plusieurs ont répondu qu’il serait excommunié ; d’autres ont répondu qu’en ce cas, il pécherait mortellement, contre son vœu, de même que s’il y allait avec son habit ; mais qu’il n’encourrait pas l’excommunication portée par le chapitre ut periculosa. Parce que cette excommunication, n’est pas contre les impudiques, mais contre les vagabonds qui quittent leur habit, pour n’être point connus pour religieux, dans les provinces, et dans les villes où ils séjourneront et où ils passeront. Et d’autant que les lois ne sont pas pour les choses qui arrivent rarement, comme sont les actions honteuses, dont parle le secrétaire des religieux ». Pirot allègue l’avis de Sayrus, « qui n’est pas jésuite », Barbosa Sanchez et Suarez, et conclut : « Après ces autorités, et ces preuves, le secrétaire fait-il pas voir évidemment que le désir qu’il a de décrier les religieux et les casuistes a fait qu’il ne s’est pas soucié de passer pour un ignorant. »
VI, 6. J’avais peine à croire cela, et je priai le père de me le montrer dans l’original ; et je vis que le chapitre où sont ces paroles, est intitulé : Pratique selon l’école de la Société de Jésus, Praxis ex Societatis Jesu scola : et j’y vis ces mots : Si habitum dimittat ut furetur occulte, vel fornicetur. Et il me montra la même chose dans Diana en ces termes : ut eat incognitus ad lupanar. Et d’où vient, mon Père, qu’ils les ont déchargés de l’excommunication en cette rencontre ? Ne le comprenez-vous pas, me dit-il, Ne voyez-vous pas quel scandale ce serait de surprendre un religieux en cet état avec son habit de Religion ?
Cas ironique où c’est le latin qui accrédite le français.
ESCOBAR, Theologia moralis, Examen VII, De statu religioso, cap. VII, Praxis circa materiam de statu religioso ex Societatis Jesu doctoribus, n° 103, Lyon, 1659, p. 734. Le passage est cité dans GEF V, p. 20. « Quandonam religiosus sine excommunicatione potest habitum exuere ? Si in loco secreto exuat, ut commodius ei sit, velut melius currat, et saltet. Vel si injuste gravatus a praelato immediato fugiat ad superiorem sine habitu, ne agnitus comprehendatur. Vel si ad turpem causam, v. gr. Ut furetur occulte, vel fornicetur, illum dimittat mox reassumpturus. Sanchez ita.
Praxis ex Societatis Jesu scola : le titre exact est Praxis... ex Societatis Jesu doctoribus ; Nicole rétablit le vrai texte dans Wendrock.
Ut eat incognitus ad lupanar : voir DIANA, Resolutiones morales, Pars III, tr. II, De dubiis regularium, Resol. 115. Le incognitus est un ajout de Pascal au texte de Diana : Aliqui casus in quo religiosi dimittentes habitum suae religionis non incidunt in censuras cap. ut periculosa, ne clerici, vel Monachi in 6. Voir le passage dans GEF VI, p. 12 : « imo ego puto neque religiosum incurrere in dictam excommunicationem si habitum dimittat ut eat ad lupanar ad fornicandum, vel ut secreto furetur, statim habitum iterum sumpturus, etsi habitum alium ad sic se occultandum eo brevi spatio assumat. » Voir l’éd. tertia des Resolutiones morales in tres partes distributae, Montibus, F. Waudraeus, 1636, p. 351.
ARNAULD Antoine, Remontrance aux pères jésuites touchant un libelle qu’ils ont fait courir dans Paris, sous ce faux titre : La manifeste de la véritable doctrine des jansénistes, telle qu’on la doit exposer au peuple, composé par l’assemblée du Port-Royal, Œuvres, XXIX, p. 514, mentionne la proposition du P. Bauny qui autorise les religieux à fréquenter les lupanars, Théologie morale tract. 4, q. 14, p. 94. « Licere singulis ingredi lupanar, ad odium peccati ingenerandum meretricibus, Etsi metus sit, ac vero etiam verisimilitudo non parva, eos peccaturos, eo quod malo suo saepe sunt experti blandis muliercularum sermonibus ac illecebris flecti solitos ad libidinem. »
Lupanar n’est ni dans Furetière, ni dans Richelet, ni dans le Dictionnaire de l’Académie. Même le dictionnaire de Nicot ne le donne pas. Bordel, au sens de lieu de débauche où les femmes se prostituent, était disponible (Furetière, et Richelet) ; le Dictionnaire de l’Académie précise que bordeau, au même sens, est vieux. Lupanar est donc un latinisme qui n’est pas encore passé dans la langue française courante. Le lecteur pouvait se demander de quoi il s’agit ; Pascal évite tout langage déshonnête en traduisant par lieu de débauche.
Ne voyez-vous pas quel scandale ce serait de surprendre un religieux en cet état avec son habit de religion : c’est tout à fait vrai, mais Pascal en juge par des règles qui ne sont pas celles des convenances sociales.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 261 sq. Défense d’Escobar et de Diana sur cette décision : « Ce vilain texte d’Escobar ne se trouve pas le même dans toutes les éditions ; mais Pascal a eu soin de puiser dans toutes, pour représenter Escobar comme plus coupable. Les mots latins qu’il cite plus bas, et que le père lui aurait montrés dans l’original ; Si habitum dimittat ut furetur occulte, vel fornicetur, se lisent textuellement, en effet, dans une édition d’Escobar, qui paraîtrait celle qu’il aurait consultée. Or, dans cette édition, la décision d’Escobar est irrépréhensible, car elle est fondée sur le droit. En effet, le but du chapitre Ut periculosa est d’empêcher les religieux d’ôter leur habit pour aller courir hors de leur cloître avec danger de se pervertir. Et, dans ce sens, un religieux qui irait se promener hors de son cloître sans son habit serait excommunié ; à plus forte raison, s’il le quittait pour aller dans un lieu de débauche. Mais Escobar, et le plus grand nombre des canonistes, marquent divers cas où un religieux pourrait quitter son habit sans encourir l’excommunication, et entre autres celui qu’expriment les mots latins cités par Pascal, où ils supposent que le crime s’accomplit dans l’intérieur du monastère. Comment donc Pascal a-t-il pu écrire plus haut ces paroles : S’il le quitte pour aller incognito en des lieux de débauche, qui semblent la traduction d l’original montré par le père, et cependant ne se trouvent nullement dans l’édition d’où sont extraites les paroles latines ? Les mots français sont la traduction de ces mots latins, ut incognitus ineat lupanar, qui se lisent dans une édition différente, et qu’Escobar avait empruntés à Diana. Pascal ne devait-il pas prévenir de cette confusion ? d’autant plus que le texte exprimant le sentiment commun des canonistes se lit dans des éditions antérieures aux Provinciales, ce qui suppose qu’Escobar se serait corrigé lui-même, dans le cas où l’autre décision aurait été répréhensible. Exposons-la, cette décision. Escobar, après avoir dit en général qu’un religieux qui quitte témérairement son habit est excommunié, se demande ensuite s’il commettrait un péché grave et s’il encourrait l’excommunication, dans le cas où il le quitterait pour peu de temps, même pour une cause déshonnête ? Il expose les deux sentiments, à son ordinaire, et il conclut : 1° Il pécherait grièvement, car le temps ne fait rien à l’affaire ; 2° il n’encourrait pas l’excommunication. Quoique en effet, dit-il, l’action de quitter son habit pour un peu de temps soit grave, à raison de la malice d’une autre espèce qui y est jointe, néanmoins, considérée comme téméraire, rapport sous lequel elle est soumise à la censure, elle est en matière légère ; - et il étend cet intervalle à l’espace d’une heure. On voit cependant combien Pascal a été perfide, et en confondant les éditions, et en supposant qu’Escobar exempte d’excommunication, en général et absolument, le religieux qui quitte son habit pour aller en des lieux de débauche, parce qu’il est visible que les bulles ne parlent point de ces cas-là, et en omettant de dire qu’Escobar impute à ce religieux un péché mortel pour la seule action de quitter son habit, indépendamment de son énorme crime. Que sa décision soit fausse, nous le voulons bien ; mais en quoi va-t-elle à la corruption des mœurs ? Comment est-elle un argument à l’appui de ce que Pascal avançait à la fin de se cinquième Provinciale, que les casuistes avaient trouvé le moyen d’éluder l’autorité de l’Écriture sainte, des papes, des conciles, qui sont tous dans la voie unique de l’Évangile ? Une censure est-elle l’Évangile ? Et si, dans un cas particulier, on en exempte sans raison, la morale évangélique sera-t-elle renversée ? Du reste, notons bien que, dans ce cas même, Suarez, Castro Palao et la plupart des théologiens jésuites ont décidé autrement qu’Escobar. Ce n’est donc pas là une opinion des vingt-quatre vieillards, comme le dit Pascal. – Et, en passant, expliquons ce praxis e Societatis Jesu schola, conclusion de tous les chapitres d’Escobar, et où Pascal va puiser presque toutes ses citations. Il ne faut pas en induire que la doctrine exprimée sous ce titre soit celle de la Société, ni même que les vingt-quatre et les auteurs cités par Escobar, en marge de ses pages, aient été dans les sentiments qu’il leur prête. D’abord, sur beaucoup de points de morale, chez les jésuites comme chez les autres théologiens, les uns sont pour, les contre ; et c’est une nécessité. De plus, Escobar cite pour lui un auteur lorsqu’il croit y avoir vu son principe, d’où il s’imagine, quelquefois à tort, avoir bien tiré la conséquence. Enfin et surtout, Escobar est un grand ramasseur, qui a trop, beaucoup trop écrit. Aussi ses vingt volumes in-folio, composés au milieu d’immenses préoccupations, fourmillent d’inexactitudes. Souvent il cite à faux, ou trompé par sa mémoire, ou faut d’y apporter une suffisante attention ; et il impute telle ou telle doctrine à des auteurs qui ne contiennent pas un mot de ce qu’il leur fait dire. Ne voyons donc pas dans Escobar ni un auteur sérieux, ni surtout l’organe de la Société, pas même des vingt-quatre jésuites dans lesquels il aurait compilé sa Théologie morale ».
VI, 6. Et n’avez-vous point ouï parler, continua-t-il, comment on répondit à la première Bulle Contra sollicitantes ? Et de quelle sorte nos 24, dans un Chapitre aussi de la pratique de l’École de notre Société, expliquent la Bulle de Pie V, Contra clericos, etc. ? Je ne sais ce que c’est que tout cela, lui dis-je. Vous ne lisez donc guères Escobar, me dit-il. Je ne l’ai que d’hier, mon père, et même j’eus de la peine à le trouver. Je ne sais ce qui est arrivé depuis peu qui fait que tout le monde le cherche. Ce que je vous disais, repartit le Père, est en la p. 117. Voyez-le en votre particulier, Vous y trouverez un bel exemple de la manière d’interpréter favorablement les Bulles. Je le vis en effet dès le soir même ; mais je n’ose vous le rapporter, car c’est une chose effroyable.
Tout le monde le cherche : allusion au succès de la cinquième Provinciale.
Une suite de bulles est ici en question. Sur les trois papes qui les ont fulminées, voir LEVILLAIN Philippe (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 1994.
La Bulle Contra sollicitantes a été fulminée par le pape Pie IV (1499- élu 1559-1565) le 16 avril 1561 : elle ordonnait de dénoncer à l’Inquisition les confesseurs qui profitaient de leur office pour faire des propositions malhonnêtes à leurs pénitentes.
Le pape Grégoire XV (1554-élu 1621-1623) a publié une constitution le 30 août 1622, sur le même sujet, pour supprimer les interprétations laxistes qui étaient faites de la bulle de Pie IV par les casuistes.
Provinciales VI, 6, éd. Cognet, p. 98; PASCAL, Œuvres complètes, I, éd. Le Guern, p. 1178. La bulle Contra sollicitantes de Pie IV, du 16 avril 1561, faisait obligation de dénoncer à l'Inquisition le confesseur qui, profitant de la confession, aurait fait à une pénitente des propositions malhonnêtes. La première bulle Contra sollicitantes avait été interprétée de manière si laxiste par les casuistes que Grégoire XIV avait dû, par une nouvelle bulle du 30 août 1622, rappeler très fermement cette obligation de dénoncer le confesseur poussant au péché. Escobar consacre à cette question un chapitre, tr. V, ex. II, cap. 5, De sacerdote paenitentem sollicitante ad Venerem, n. 108-136. Le chapitre d’Escobar, p. 584, tr. V, ex. II, parle surtout de la 2e bulle, celle de Grégoire XV du 30 août 1622. Wendrock a donc supprimé l’adjectif première qui se trouve devant Contra sollicitantes. Voir l’éd. Cognet, Garnier, p. 98.
L’édition Le Guern, Pléiade, I, p. 1178, indique que dans les Resolutiones morales de Diana, un traité entier porte sur le sujet en question, Pars IV, tr. V, De confessariis sollicitantibus, Lyon, Prost, 1636, p. 276-304. Il contient 54 résolutions, qui envisagent des situations diverses, et posent presque toutes sur la question de savoir si l’on doit dénoncer des clericos sollicitantes.
Sur Pie V (1504 - élu 1566 - 1572) et son œuvre pour l’assainissement moral du clergé régulier et séculier, voir LEVILLAIN Philippe (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, p. 1328-1330. La bulle de Pie V Contra clericos, dite constitution Horrendum, date du 30 août 1568. Elle condamne les clercs sodomites.
La référence à la p. 117 convient à l’édition de 1647 d’Escobar. « Num bulla Pii V contra clericos sodomitas obliget in foro conscientiae ? » Au lieu de en la p. 117, l’édition de 1659 donne la référence au tr. I, ex. 8, n. 102, reprise par Wendrock. Voir ESCOBAR, Liber theologiae moralis, p. 151, sur la Constitution Horrendum de Pie V, 30 août 1658.
Nicole en a traduit un passage dans une note de Wendrock, éd. de 1700, t. 1, p. 359. : « Ce crime horrible [...] pour lequel Dieu par un jugement terrible fit autrefois descendre le feu du ciel sur des villes entières, nous cause une extrême douleur, et nous porte à faire tous nos efforts pour le réprimer autant qu’il est possible. Personne n’ignore ce qui a été ordonné par le concile de Latran, Que tous les clercs que l’on découvrirait être adonnés à cette incontinence qui est contre la nature, et qui a attiré la colère du ciel sur les incrédules, seraient chassés du clergé, ou renfermés dans des monastères pour y faire pénitence. Mais dans la juste crainte que nous avons que la contagion d’un si grand désordre ne s’augmente par l’impunité, qui est le plus grand attrait dont le démon se serve pour porter les hommes au péché, nous avons résolu de punir plus sévèrement les clercs qui en seront coupables, afin que ceux qui ne craignent point de perdre leur âme, soient au moins retenus par la crainte du glaive séculier, qui punit ceux qui contreviennent aux lois de l’État. C’est pourquoi ayant intention de faire présentement exécuter plus parfaitement, et plus fortement ce que nous avons déjà ordonné sur ce sujet dès le commencement de notre pontificat, nous privons par l’autorité de la présente constitution de tout privilège de la cléricature, de tout emploi, dignité et bénéfice ecclésiastique tous, et chacun des prêtres, et autres ecclésiastiques séculiers de quelque degré et dignité qu’ils soient qui s’abandonneraient à un crime si détestable » : p. 359-360.
Nicole passe ensuite à la manière dont Escobar a traité ce sujet. Il le fait avec précautions, car « la pudeur ne permet pas de traduire cet endroit en français ». Le texte latin se trouve dans le Liber theologiae moralis de l’édition de Lyon, 1659, p. 151 : « Num Bulla Pii V contra clérico sodomitae obliget in foro conscientiae ? Henriquez sentit usu non esse receptam probabiliter, nec in conscientiae foro obligare. Quod si usu recepta sit, clericus foeminam in indebito subigens vasi, non committit proprie sodomiam, quia licet non servet debitum vas, servat tamen sexum. Nec incurrit ex Suario poenas bullae intra vas masculi semen non immitens ; quia delictum non esse consummatum. Nec ex eodem qui non sibi bis, aut ter in sodomiam sunt lapsi ; quia pontifex has poenas clericis exercentibus sodomiam infligit. Nec (adhuc ex Suario) ante sententia judicis declaratoriam poenas bullae in foro conscientiae incurrunt ; quia nulla lex poenalis obligat homlines, ad se prodendum. Colligo clericum exercentem sodomiam, si sit contritus, etiam retento beneficio, officio, et dignaitate, omnino esse absolvendum ».
Provinciales, éd. Cognet, p. 98-99. Constitution Horrendum de Pie V, 30 août 1568, concernant les clercs sodomites (voir plus haut). Le commentaire de Cognet tente de ne pas trop aborder les circonstances alléguées par les casuistes sur ce sujet, car « la pudeur ne permet pas de traduire cet endroit en français ». Il écrit que le passage est « peu traduisible en français » ; mais c’est vrai aussi en anglais, en allemand, ou en serbo-croate... ; voir cependant, pour savoir tout et en bon français, éd. Le Guern, p. 345-346, ou Œuvres, I, p. 1178-1179 : « Est-ce que la bulle de Pie V contre les clercs sodomites obligerait en conscience ? Henriquez est d’avis, d’une manière probable, qu’elle n’a pas été reçue par l’usage, et quelle n’oblige pas en conscience. A supposer qu’elle ait été reçue par l’usage, un clerc qui pénètre une femme par le réceptacle indu ne commet pas à proprement parler une sodomie, parce que, bien qu’il ne conserve pas le réceptacle approprié, il conserve néanmoins le sexe approprié. Et il n’encourt pas d’après Suarez les peines de la bulle s’il n’émet pas sa semence dans le réceptacle d’un homme, parce que le délit n’a pas été consommé. Ni non plus, d’après le même, ceux qui n’ont glissé dans la sodomie que deux ou trois fois, parce que le pontife a infligé ces peines aux clercs qui exercent la sodomie. Et (encore d’après Suarez) ils n’encourent pas en conscience les peines de la bulle avant la sentence du juge, parce qu’aucune loi pénale n’oblige les hommes à se livrer. Je conclus qu’un clerc qui exerce la sodomie, s’il est contrit, doit être absous totalement, même s’il retient son bénéfice, son emploi et sa dignité. »
Le résumé qu’en donne Nicole est fidèle pour l’essentiel, et pouvait être lu par tout le monde : « Cependant Escobar [tr. I. ex. 8. n. 102] s’étant fait cette question : Si la Bulle de Pie V contra clericos sodomitas oblige en conscience ? il invente mille détours pour la rendre inutile. Il répond 1. Qu’Henriquez a cru probablement qu’elle n’est point reçue par l’usage, et qu’ainsi elle n’oblige point dans le for de la conscience. 2. Que si elle est reçue elle n’a lieu, selon Suarez, qu’en telles et telles circonstances. 3. Que selon le même Suarez : elle n’a point lieu non plus à l’égard de ceux qui ne sont tombés dans ce crime que deux ou trois fois. 4. Que selon encore le même Suarez : ceux mêmes qui sont dans l’habitude de ce péché, n’encourent point dans le for de la conscience les peines portées par la bulle qu’après la sentence du juge, parce qu’il n’y a point de loi qui oblige un coupable à se déclarer, et à s’accuser soi-même : D’où je conclu, dit Escobar, qu’un ecclésiastique qui est dans le cas de la bulle de Pie V, s’il est contrit doit être absous, même en retenant son bénéfice, son emploi et sa dignité ».
Mais ce qui est réellement en cause dans ce passage est la réaction des docteurs probabilistes malgré la condamnation prononcée par le pape.
La pratique de l’École de notre Société : en fait, Praxis ex Societatis Jesu doctoribus. Comme l’indique L. Cognet, p. 98, Nicole-Wendrock corrige dans l’édition latine. En revanche, la correction n’est pas faite dans l’édition de Wendrock en français.
ESCOBAR, Theologia moralis, Tr. I, Ex. VIII, De luxuria, cap. III, n. 102, p. 151 de l’éd. de 1659. Cité dans GEF V, p. 19. Voir la traduction dans l’éd. Le Guern, Pléiade, I, p. 1178-1179.
GEF V, p. 33 indique que dès 1643, Hermant a signalé avec indignation les obscénités des casuistes dans ses Vérités académiques, p. 116.>
WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 358. Doctrine abominable d’Escobar. Nicole insiste sur la sévérité des sanctions ecclésiastiques prévues dans ces cas : p. 358-359. Texte de la constitution de Pie V : p. 359 sq. Escobar demande si cette constitution oblige : p. 360.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 250 sq. Commentaire de ce passage sur la chose effroyable. « La chose est effectivement effroyable, me dit mon canoniste, si Pascal parle de la matière : car le crime dont il s’agit là est presque le plus infâme qui se puisse commettre. Le détail aussi où descend Escobar a quelque chose qui fait de la peine à lire. Mais serait-ce la faute d’un docteur en médecine d’être obligé de faire à ses écoliers l’exposition de certains maux sur lesquels ils peuvent être un jour consultés ? La prudence oblige à ne mettre le cas de conscience qu’en une langue qui n’est pas entendue de tout le monde, et dans des livres qui ne sont lus communément que par les gens qui doivent être occupés au confessionnal, qui en entendent tous les jours de bien pires encore. Si quelqu’un est coupable en cette matière, n’est-ce pas Pascal, lui qui donne envie de voir ce que c’est à ceux qui n’en ont que faire ?
Que si en disant que c’est une chose effroyable, il parle de la décision d’Escobar, il se montre encore ici ou fort ignorant, ou fort malin. Car voici à quoi se réduit tout ce que dit Escobar sur ce sujet. Il apporte le sentiment d’un autre théologien espagnol, qui est que cette bulle probablement n’est point en usage et que par conséquent elle n’oblige point en conscience à subir toutes les peines qu’elle impose. C’est un fait tout pur, qu’Escobar ne garantit point, et d’ailleurs il n’est pas plus surprenant que cette bulle ne soit point reçue ni pratiquée en Espagne, qu’il n’est surprenant qu’elle ne soit ni reçue ni pratiquée en France, où en effet elle ne l’a jamais été.
En second lieu, supposé qu’elle fût reçue, Escobar explique en quelles circonstances elle oblige ou n’oblige pas, à subir ces peines ; et cela par un principe du droit indubitable, selon lequel les papes savent bien qu’on entend toujours leurs décrets : savoir que quand ils parlent de quelque péché, c’est d’un péché consommé en son espèce, à moins que le contraire ne soit expressément marqué.
3. Escobar ajoute qu’avant la sentence déclaratoire du juge, les criminels n’écoutent point au for de la conscience les peines de cette bulle ; et ces peines sont d’être privés de leurs bénéfices ou de leurs charges s’ils en ont ; d’être dégradés et livrés au bras séculier pour être punis comme les laïques, c’est-à-dire, du supplice du feu. Ce que dit Escobar est incontestable par le principe qu’il pose, que nulle loi pénale n’oblige les coupables à se déférer eux-mêmes, et certainement ce serait ici en particulier une grande extravagance de dire qu’un misérable, après avoir commis ce péché, fût obligé en conscience d’aller se déceler, afin qu’on le dégradât, et qu’on le brûlât tout vif. »
L’abbé Maynard consacre une note à ce passage dans son édition des Provinciales. Voir.Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 264 sq. L’abbé Maynard reproche surtout à Pascal d’avoir osé parler dans un écrit public de fautes fâcheuses qui n’auraient pas dû sortir de l’obscurité des débats entre théologiens.
VI, 7. Le bon Père continua donc ainsi. Vous entendez bien maintenant comment on se sert des circonstances favorables. Mais il y en a quelquefois de si précises, qu’on ne peut accorder par là les contradictions. De sorte que ce serait bien alors que vous croiriez qu’il y en aurait. Par exemple. Trois papes ont décidé que les religieux qui sont obligés par un vœu particulier à la vie quadragésimale n’en sont pas dispensés, encore qu’ils soient faits évêques. Et cependant Diana dit, que nonobstant leur décision, ils en sont dispensés.
De sorte que ce serait bien alors que vous croiriez qu’il y en aurait : entendre qu’il y aurait des contradictions.
Trois papes ont décidé que les religieux qui sont obligés par un vœu particulier à la vie quadragésimale n’en sont pas dispensés, encore qu’ils soient faits évêques : GEF V, p. 33, renvoie à la p. 13, qui fournit un texte partiel des Resolutiones morales de Diana, Pars V, Tr. 13, Res. 39, « An episcopus ex religione minimorum assumptus teneatur ad votum vitae quadragesimalis ? », p. 303. Les trois papes en question sont Paul V, Grégoire XV et Urbain VIII. Diana tire cette information du minime italien Laurent de Peyrinis (Peyrins), qui approuve la décision affirmative,
fut, sous trois papes, examinateur des évêques. Il s’agit d’Urbain VIII, d’Innocent X et d’Alexandre VII. Les Resolutiones morales sont de 1629-1641.
Quadragésimal : du carême. La vie quadragésimale consiste à s’abstenir toute l’année des aliments défendus en carême ; c’était surtout le cas des minimes, fondés par saint François de Paule : éd. Cognet, Garnier, p. 99. Voir PASCAL, Œuvres complètes, I, éd. Le Guern, p. 1179. Le Dictionnaire de Richelet indique que l’auteur n’a guère vu cette expression que dans les Provinciales.
Voir BRUNAULT Jean, « Vie quadragésimale et régime alimentaire des pères minimes aux XVe et XVIe siècles », in 1588-1988. Quatrième centenaire de la naissance de Marin Mersenne, Actes du colloque, CNRS et Célébrations nationales, 1994, p. 113-125. « Étude concrète du régime du Carême étendu à toute l’année ».
Nonobstant leur décision, ils en sont dispensés : les éditions françaises mettent ces mots en italique, mais ce n’est pas une citation de Diana, mais un résumé. Wendrock laisse en romain.
Ce passage annonce la réflexion de Pascal sur les contrariétés dans les Pensées. Dans les Provinciales, il est clair que, quoi qu’en dise le jésuite, les contradictions ne sont résolues que fallacieusement. En revanche, dans les Pensées, la contradiction entre grandeur et misère de l’homme est effectivement non seulement résolue, mais expliquée par sa raison, la corruption due à la faute originelle d’Adam. La question qui se pose est de savoir ce qui distingue les deux modes de conciliation des contrariétés.
La manière dont, dans les Pensées, Pascal résout les contradictions procède comme suit : l’hypothèse du péché originel permet de distinguer deux périodes chronologiques, avant et après la faute, comme une rupture d’un état et l’instauration d’un état nouveau. Le premier temps ne subsiste en l’homme que comme trace et postulation vide. Le second temps est celui de la misère, qui consiste en l’aspiration à ce qui est perdu.
La résolution des contradictions apparentes chez les casuistes procède aussi en introduisant une distinction. Cette distinction s’inscrit dans une circonstance qui permet de dire que la décision qui contredit celle du casuiste parle d’autre chose. Ainsi du terme d’assassin : on précise que par assassin on entend celui qui tue en trahison, et que par suite on parle d’autre chose.
Il y a une ressemblance entre Pascal et les casuistes : c’est que la distinction rend nécessaire que l’on avertisse du contexte dans lequel on parle. On parle de l’assassinat au sens des casuistes, ou au contraire au sens des Pères. Voir la définition du superflu.
La différence est que dans le cas de Pascal, les éléments qui forment la contradiction sont imposés par la problématique initiale : il faut, pour éviter une absurdité, distinguer deux états de la nature de l’homme : c’est ce que dira le Traité de la prédestination. Du côté des casuistes, la distinction surgit par la volonté du casuiste qui veut contredire la règle de l’Église, ou plutôt par sa fantaisie.
On se trouve dans une situation analogue à celle d’une notion qui est introduite dans une définition, mais sans justification ni démonstration. On se trouve au fond un peu dans la même situation que le père Noël lorsqu’il prétend réfuter le vide, invente un air subtil dont il est incapable de prouver l’existence. Pascal lui reproche de faire travailler son imagination sans rien prouver.
Par ce biais, on rencontre un problème important, qui est suggéré plutôt que traité par Pascal, c’est celui de la part de l’imagination et de la fantaisie dans l’exercice de la casuistique.
VI, 7. Et comment accorde-t-il cela, lui dis-je ? C’est, répliqua le Père, par la plus subtile de toutes les nouvelles méthodes ; et par le plus fin de la probabilité. Je vas vous l’expliquer. C’est que, comme vous le vîtes l’autre jour, l’affirmative et la négative de la plupart des opinions, ont chacune quelque probabilité, au jugement de nos docteurs, et assez pour être suivies avec sûreté de conscience. Ce n’est pas que le pour et le contre soient ensemble véritables dans le même sens ; cela est impossible, mais c’est seulement qu’ils sont ensemble probables, et sûrs par conséquent.
Indifférence de la probabilité au vrai et au faux. Voir sur ce point et ses conséquences DESCOTES Dominique, « Les Provinciales et l’axiomatique des probabilités », in La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 189-197, et Blaise PASCAL, Antoine ARNAULD, François de NONANCOURT, Géométries de Port-Royal. Édition critique de Dominique Descotes, Paris, Champion, 2009, p. 61 sq.
Je vas vous l’expliquer : comme disait Vaugelas en mourant : je m’en vais ou je m’en vas, l’un et l’autre se dit ou se disent.
VI, 8. Sur ce principe Diana notre bon ami parle ainsi en la part. 5, tr. 13, Rés. 39. Je réponds à la décision de ces trois Papes, contraire à mon opinion qu’ils ont parlé de la sorte, en s’attachant à l’affirmative laquelle en effet est probable, à mon jugement même : mais il ne s’ensuit pas de là que la négative n’ait aussi sa probabilité. Et dans le même traité, R. 65 sur un autre sujet dans lequel il est encore d’un sentiment contraire à un Pape. Il parle ainsi : Que le Pape l’ait dit comme chef de l’Église. Je le veux. Mais il ne l’a fait que dans l’étendue de la sphère de probabilité de son sentiment. Or vous voyez bien que ce n’est pas blesser les sentiments des Papes, on ne le souffrirait pas à Rome où Diana est en un si haut crédit. Car il ne dit pas que ce que les Papes ont décidé ne soit pas probable ; mais en laissant leur opinion dans toute la sphère de probabilité, il ne laisse pas de dire que le contraire est aussi probable. Cela est très respectueux, lui dis-je.
Diana, notre bon ami : voir ARNAULD Antoine, Remontrances, Œuvres, XXIX, p. 516 : « le fameux Diana, votre bon ami... »
L’édition de 1659 donne : « Je réponds à la décision de ces trois Papes, qui est contraire à mon opinion... »
Texte de 1659 : « à Rome où Diana est en un si grand crédit ».
La première citation de Diana renvoie à Resolutiones morales, Tomus secundus, Pars V, Tract. XIII, Misc. I, Res. XXXIX, An episcopus ex religione minorum assumptus teneatur ad votum vitae quadragesimalis ?, 1653, p. 303. L’édition de 1659 donne : en la part. 5, tr. 13, r. 39. « Ad auctoritatem vero summorum pontificum quam affert Peyrinus, respondeo primo de illis responsionibus non constare authentice, vel dicendum est dictos pontifices ita respondisse adhaerendo opinioni affirmativae, quam nos, ut diximus probabilem etiam esse existimamus, sed non exinde sequitur negativam sententia carere probabilitate ».
GEF V, p. 34 ; texte de DIANA, Resolutiones morales, P. V., tr. 13, r. 65, 1653, p. 312 ; cité in GEF V, p. 13 : “nam est ut caput rubricam illam tradit, id efficit intra sphaeram probabilitatis...”
DESCOTES Dominique, « Les Provinciales et l’axiomatique des probabilités », in La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 189-197.
Sphère de probabilité : du moment que la validité d’une proposition dépend non de la conformité au vrai en général, mais de la sphère de probabilité dans laquelle on la considère, toutes les opinions probables sont sûres : cela revient à tourner le principe qu’une seule opinion est vraie pour un énonciateur. Cela revient à transposer le problème de la vérité en problème judiciaire : comment éviter les censures.
Cette notion qui permet de supprimer des « contradictions apparentes », est peut-être formée sur celle de sphère d’activité. Voir Furetière : « Sphère d’activité est l’étendue dans laquelle un corps peut agit tout autour de soi. Le feu ne peut pas échauffer des objets éloignés, quand ils sont hors de sa sphère d’activité. Sphère se dit aussi figurément, quand on parle de ceux qui veulent entreprendre une chose au-delà de leur force ou de leurs connaissances. Il ne réussira pas dans cette affaire ; il est hors de sa sphère, elle est au-dessus de ses connaissances ».
C’est une caricature d’axiomatique. Voir BLANCHÉ, L’axiomatique, p. 59. En logique et même en géométrie, règne un principe de tolérance de la syntaxe : dans la logique, il n’y a pas de morale, il ne s’agit que de parvenir à des conventions ; chacun est libre de construire à sa guise une logique, pourvu qu’il l’énonce clairement, et qu’il la suive ensuite rigoureusement. En géométrie, on est habitué à la tolérance des théories : on peut raisonner selon un système d’axiomes ou un autre, selon la méthode des anciens comme par celle des mouvements. Mais cela ne met pas en cause les axiomes fondamentaux : on raisonne toujours en s’appuyant sur le principe de non-contradiction ou sur le principe du tiers exclu, par exemple. Avec les jésuites et les casuistes, la règle de la sphère de probabilité étend la possibilité d’engendrer des énoncés au-delà du principe fondamental de contradiction : de ce fait on peut dire n’importe quoi. C’est un choix conscient et volontaire, qui répond à un besoin effectif. Par conséquent la seule critique possible est de montrer que cela ne satisfait pas les exigences normales des chrétiens. L’insistance sur le concept de sphère de probabilité est donc significative : c’est un terme clé, puisque c’est lui qui permet que des propositions contraires, étant réduites chacune à une sphère de probabilité, soient ensemble probables.
DESCOTES Dominique, « Les Provinciales et l’axiomatique des probabilités », in La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 189-197.
VI, 8. Et cela est plus subtil, ajouta-t-il, que la réponse que fit le P. Bauny quand on eût censuré ses livres à Rome. Car il lui échappa d’écrire contre M. Hallier qui le persécutait alors furieusement : Qu’a de commun la censure de Rome avec celle de France ?
Ce que Pascal suggère, c’est que, quoiqu’en disent les ennemis de Port-Royal, ce sont les jésuites qui sont rebelles au pouvoir du pape.
Les mots Qu’a de commun la censure de Rome avec celle de France ? se trouvent en latin à la fin du factum du P. Bauny, Catalogus authorum quos cum P. Bauny Doctor theologus censura notandos judicavit, slnd, p. 20 : « (...) De quibus, quia quid judicii haberet author, non Romano, sed Gallico more, hoc est sincere aperuit ac candide, Romae est damnatus, hoc vero typis mandare, hoc ad infamiam vulgari doctori theologo quid erat necesse ? ac Romanae censurae, quid est cum sua, aut gallica doctrorum, quam mendicat commune ? » Pascal emprunte probablement ce texte à la Théologie morale, p. 91, où on lit : « Le pape ayant censuré les trois livres de Bauny, il a eu la hardiesse de dire dans un petit livre qu’il a fait, pour éviter la censure de la faculté de Paris, Que la censure de Rome n’avait rien de commun avec celle de France » ; voir GEF V, p. 13-14. Arnauld a cité intégralement le texte de Bauny, avec sa fin Ac romanae censurae, quid est cum sua, aut gallica doctorum quam mendicat, commune ?, dans sa Lettre d’un théologien à Polémarque, Œuvres, XIX, p. 127, précisant que le passage a été supprimé dans certains exemplaires : GEF V, p. 14.
Trois ouvrages de Bauny furent mis à l’Index en septembre et décembre 1640.
Hallier : voir Provinciales, IV, 3. François Hallier fut syndic de la Faculté de théologie, évêque de Toul, puis de Cavaillon ; il fut d’abord vivement hostile aux jésuites, et il prépara probablement les extraits de Bauny en vue de la censure de 1641 ; il fit écrire à Arnauld la Théologie morale de 1643. Par la suite, il se réconcilia avec les jésuites. Voir la notice du Dictionnaire de Port-Royal, p. 500.
BAUDRY DE SAINT-GILLES D’ASSON Antoine, Journal d’un solitaire de Port-Royal, éd. Ernst et Lesaulnier, Paris, Nolin, 2008, p. 95 sq.
CEYSSENS Lucien, “François Hallier”, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 40 (1969) 157-264, Jansenistica minora, XI.
CEYSSENS Lucien, “Correspondance romaine de François Hallier (1585-1659)”, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 42 (1972) 307-329, Jansenistica minora, XI.
GRES-GAYER Jacques M., Le Jansénisme en Sorbonne, 1643-1656, Klincksieck, Paris, 1996. Voir p. 228.
Le mot alors souligne le retournement de François Hallier : celui-ci, après avoir publié contre Bauny un Extrait d’un livre intitulé Somme des péchés..., s’était allié aux ennemis d’Arnauld.
VI, 8. Vous voyez assez par là que soit par l’interprétation des termes, soit par la remarque des circonstances favorables, soit enfin par la double probabilité du pour et du contre, on accorde toujours ces contradictions prétendues, qui vous étonnaient auparavant, sans jamais blesser les décisions de l’Écriture, des conciles ou des papes, comme vous le voyez. Mon Révérend Père, lui dis-je, que l’Église est heureuse de vous avoir pour défenseurs ! Que ces probabilités sont utiles ! Je ne savais pourquoi vous aviez pris tant de soin d’établir qu’un seul Docteur, s’il est grave, peut rendre une opinion probable ; que le contraire peut l’être aussi ; et qu’alors on peut choisir du pour et du contre celui qui agrée le plus, encore qu’on ne le croie pas véritable, et avec tant de sûreté de conscience, qu’un Confesseur qui refuserait de donner l’absolution sur la foi de ces Casuistes serait en état de damnation. D’où je comprends qu’un seul Casuiste peut à son gré faire de nouvelles règles de morale, et disposer, selon sa fantaisie, de tout ce qui regarde la conduite de l’Église.
Texte de 1659 : Que le monde est heureux de vous avoir pour maîtres.
Texte de 1659 : Tout ce qui regarde la conduite des mœurs.
D’où je comprends qu’un seul Casuiste peut à son gré faire de nouvelles règles de morale, et disposer, selon sa fantaisie, de tout ce qui regarde la conduite de l’Église : voir Provinciale V, § 14, éd. Cognet, p. 85 : « un seul docteur peut tourner les consciences et les bouleverser à son gré, et toujours en sûreté ». Le père jésuite répond : « Il n’en faut pas rire (...), ni penser combattre cette doctrine. Quand les jansénistes l’ont voulu faire, il y ont perdu leur temps. Elle est trop bien établie ». C’est une synthèse sommaire de l’enseignement de la Provinciale V : Pascal répète d’une lettre à l’autre certaines conséquences fâcheuses des probabilités, sans y insister lourdement.
DESCOTES Dominique, « Les Provinciales et l’axiomatique des probabilités », in La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 189-197. Sur les conséquences logiques des principes de la probabilité.
VI, 8. Il faut, me dit le Père, apporter quelque tempérament à ce que vous dites. Apprenez bien ceci. Voici notre méthode, où vous verrez le progrès d’une opinion nouvelle depuis sa naissance jusqu’à sa maturité.
Tempérament, se dit figurément en choses morales, d’un adoucissement, d’une voie mitoyenne qu’on trouve dans les affaires pour accorder des parties.
Progrès : avancement, mouvement en avant. Ce mot se dit particulièrement d’une suite de conquêtes, d’une suite d’avantages remportés à la guerre. Progrès se dit aussi en général de toute sorte d’avancement, d’accroissement, d’augmentation, soit en bien, soit en mal : la Réformation fit de grands progrès en peu de temps (Furetière).
Sur la genèse des opinons probables, voir Factum pour les curés de Paris, éd. Cognet, p. 407 sq. Forme non ironique, plus large et plus forte de la même critique. « § 8. C’est une chose étonnante, que la témérité des hommes se soit portée jusqu’à ce point. Mais cela s’est conduit insensiblement et par degrés en cette sorte. § 9. Ces opinions accommodantes ne commencèrent pas par cet excès, mais par des choses moins grossières, et qu’on proposait seulement comme des doutes. Elles se fortifièrent peu à peu par le nombre des sectateurs, dont les maximes relâchées ne manquent jamais : de sorte qu’ayant déjà formé un corps considérable de casuistes qui les soutenaient, les ministres de l’Église, craignant de choquer ce grand nombre, et espérant que la douceur et la raison seraient capables de ramener ces personnes égarées, supportèrent ces désordres avec une patience qui a paru par l’événement, non seulement inutile, mais dommageable : car, se voyant ainsi en liberté d’écrire, ils ont tant écrit en peu de temps, que l’Église gémit aujourd’hui sous cette monstrueuse charge de volumes. La licence de leurs opinions, qui s’est accrue avec le nombre de leurs livres, les a fait avancer à grands pas dans la corruption des sentiments et dans la hardiesse de les proposer. Ainsi les maximes qu’ils n’avaient jetées d’abord que comme de simples pensées furent bientôt données pour probables ; ils passèrent de là à les produire pour sûres en conscience, et enfin pour aussi sûres que les opinions contraires, par un progrès si hardi, qu’enfin les puissances de l’Église commençant à s’en émouvoir, on fit diverses censures de ces doctrines. L’Assemblée générale de France les censura en 1642, dans le livre du P. Bauny Jésuite, où elles sont presque toutes ramassées ; car ces livres ne font que se copier les uns les autres. La Sorbonne les condamna de même ; la Faculté de Louvain ensuite, et feu M. l’Archevêque de Paris aussi, par plusieurs censures. De sorte qu’il y avait sujet d’espérer que tant d’autorités jointes ensemble arrêteraient un mal qui croissait toujours. Mais on fut bien éloigné d’en demeurer à ce point : le P. Héreau fit, au Collège de Clermont, des leçons si étranges pour permettre l’homicide, et les PP. Flahaut et Le Court en firent de même à Caen de si terribles pour autoriser les duels, que cela obligea l’Université de Paris à en demander justice au Parlement, et à entreprendre cette longue procédure qui a été connue de tout le monde. Le P. Héreau ayant été, sur cette accusation, condamné par le Conseil à tenir prison dans le Collège des Jésuites, avec défenses d’enseigner dorénavant, cela assoupit un peu l’ardeur des casuistes ; mais ils ne faisaient cependant que préparer de nouvelles matières, pour les produire toutes à la fois en un temps plus favorable. § 10. En effet, on vit paraître, un peu après, Escobar, le P. Lamy, Mascarenhas, Caramuel et plusieurs autres, tellement remplis des opinions déjà condamnées, et de plusieurs nouvelles plus horribles qu’auparavant, que nous, qui, par la connaissance que nous avons de l’intérieur des consciences, remarquions le tort que ces dérèglements y apportaient, nous nous crûmes obligés à nous y opposer fortement. Ce fut pourquoi nous nous adressâmes, les années dernières, à l’Assemblée du Clergé qui se tenait alors, pour y demander la condamnation des principales propositions de ces derniers auteurs, dont nous leur présentâmes un extrait. § 11. Ce fut là que la chaleur de ceux qui les voulaient défendre parut : ils employèrent les sollicitations les plus puissantes, et toutes sortes de moyens pour en empêcher la censure, ou au moins pour la faire différer, espérant qu’en la prolongeant jusqu’à la fin de l’Assemblée, on n’aurait plus le temps d’y travailler. Cela leur réussit en partie ; et néanmoins, quelque artifice qu’ils y aient apporté, quelques affaires qu’eût l’Assemblée sur la fin, et quoique nous n’eussions de notre côté que la seule vérité, qui a si peu de force aujourd’hui, cela ne put empêcher, par la providence de Dieu, que l’Assemblée ne résolût de ne se point séparer sans laisser des marques authentiques de son indignation contre ces relâchements, et du désir qu’elle avait eu d’en faire une condamnation solennelle, si le temps le lui eût permis. »
DESCOTES Dominique, « L’éloquence ecclésiastique dans les Écrits des curés de Paris composés par Pascal », in VÉNUAT Monique et JÉRÉMIE Christian, L’éloquence ecclésiastique de la pré-Réforme aux Lumières, Paris, Champion, 2015, p. 351-374.
Comparer avec la méthode du moliniste pour accréditer une opinion nouvelle dans l’Église d’après le Discours sur la Possibilité des commandements, OC III, éd. J. Mesnard, p. 730-732.
Comparaison avec l’établissement des coutumes selon Hermant : GEF V, p. 9.
VI, 9. D’abord le Docteur grave qui l’a inventée l’expose au monde, et la jette comme une semence pour prendre racine. Elle est encore faible en cet état ; mais il faut que le temps la mûrisse peu à peu.
Pensées, Laf. 516, Sel. 452. « On aime la sûreté, on aime que le pape soit infaillible en la foi, et que les docteurs graves le soient dans les mœurs, afin d’avoir son assurance. »
VI, 9. Et c’est pourquoi Diana qui en a introduit plusieurs, dit en un endroit : J’avance cette opinion, mais parce qu’elle est nouvelle, je la laisse mûrir au temps, relinquo tempori maturandam.
GEF V, p. 36, remarque que les éditeurs n’ont pas trouvé ce texte chez Diana. Cognet non plus.
VI, 9. Ainsi en peu d’années on la voit insensiblement s’affermir, et, après un temps considérable, elle se trouve autorisée par la tacite approbation de l’Église, selon cette grande maxime du P. Bauny : Qu’une opinion étant avancée par quelques casuistes, et l’Église ne s’y étant point opposée ; c’est un témoignage qu’elle l’approuve.
Qu’une opinion étant avancée par quelques casuistes, et l’Église ne s’y étant point opposée, c’est un témoignage qu’elle l’approuve. C’est un résumé de l’opinion du P. Bauny et non citation exacte ; mais c’est l’expression exacte de sa pensée.
Proposition condamnée par Alexandre VII, sous la forme donnée dans Denzinger, n°1127, et Enchiridion symbolorum, Bononiae, impr. de 2003, n°2047, p. 802 : « Si liber sit alicujus junioris et moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constet rejectam esse a sede apostolica tamquam improbabilem ».
JOUSLIN Olivier, Pascal et le dialogue polémique, p. 389 sq.
Et c’est en effet par ce principe qu’il autorise un de ses sentiments dans son traité 6. p. 312.
Traité VI, p. 312 : Theologia moralis, P. I, tr. VI, p. 312. Voir GEF V, p. 14, qui donne le texte de Bauny. Celui-ci admet qu’on puisse satisfaire au précepte dominical en entendant deux parties de deux messes différentes.
Voir GEF V, p. 14, qui donne un passage de Bauny sur ce sujet. Mais on n’y trouve pas la justification qu’évoque Pascal.
La référence que donne Cognet, pour l’opinion condamnée par Innocent XI, Denzinger, 1203, ou Enchiridion symbolorum, Bononiae, impr. de 2003, n°2051, p. 804, ne me paraît pas correspondre. C’est une proposition sur le jeûne.
Vous ne connaissez pas Denzinger ?
Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul. Henri Denzinger est un jésuite décédé en 1883, qui composa un recueil des textes conciliaires et pontificaux relatifs aux dogmes. Son travail a été mis à jour par des éditions successives, et permet de vérifier le contenu de l’enseignement théologique catholique. L’édition Cognet s’appuie sur son travail pour marquer les propositions des casuistes condamnées par Rome. Il est évidemment assez plaisant que ce soit un jésuite qui serve à vérifier que les propositions des casuistes ont été condamnées.
VI, 9. Et quoi, lui dis-je, mon Père, l’Église à ce compte-là approuverait donc tous les abus qu’elle souffre, et toutes les erreurs des livres qu’elle ne censure point ? Disputez, me dit-il, contre le P. Bauny. Je vous fais un récit, et vous contestez contre moi. Il ne faut jamais disputer sur le fait. Je vous disais donc que quand le temps a ainsi mûri une opinion, alors elle est tout à fait probable et sûre.
Texte de 1659 : « Il ne faut jamais disputer sur un fait ».
Récit : rapport, sans que soit impliquée l’idée de diégèse.
Il ne faut jamais disputer sur le fait : allusion discrète et ironique à la controverse sur le fait et le droit.
Il y a un raisonnement de même nature dans le Discours sur la possibilité des commandements.
VI, 9. Et de là vient que le docte Caramuel, dans la lettre où il adresse à Diana sa Théologie fondamentale, dit que ce grand Diana a rendu plusieurs opinions probables qui ne l’étaient pas auparavant, quae antea non erant : Et qu’ainsi on ne pèche plus en les suivant, au lieu qu’on péchait auparavant, jam non peccant, licet ante peccaverint.

Jean Caramuel de Lobkowicz (1606-1682)
Il est mathématicien, homme de lettres, philosophe. Il étudie les humanités et la philosophie à Alcalá de Henares, où il a entre autres Benito Sánchez comme professeur. En 1625, il intègre le monastère de La Espina, près de Médine. Il étudie sous la direction de l’astronome et théoricien de la musique Pedro de Ureña, puis, à Salamanque, la théologie avec le célèbre thomiste Francisco de Araujo. En 1632, à l’Université de Louvain, il est l’élève d’Ignatius der Kennis (1589-1656), il obtient le doctorat en théologie en 1638. On lui doit un nombre considérable d’ouvrages qui témoignent de son érudition, ainsi que de son imagination. Il prétendait résoudre toutes les questions théologiques par des règles mathématiques. Caramuel a traité des partis : voir FRANKLIN James, The science of conjecture, p. 316 sq. Sa theologia moralis fundamentalis decalogica, Francfort, 1652-1653, le fit surnommer princeps laxistarum. En 1635, il dirige les travaux de fortification de la ville de Louvain menacée par les troupes françaises et hollandaises. En 1644, il est abbé à Disibodenberg (Mayence). Il est à Prague, où il prend les armes contre les armées suédoises. Il se fixe au monastère de Montserrat. En 1654, son ami Fabio Chigi devient le pape Alexandre VII, et le nomme Cardinal. En 1656, il est évêque de Campagna, et en 1673, de Vigevano. Il meurt en 1682.
Caramuel ne figure pas dans la liste des casuistes de la Provinciale V.
KRABBENHOFT Kenneth, “Pascal contre Caramuel”, XVIIe Siècle, oct.-déc. 1981, p. 435-442, a tenté une méritoire défense de Caramuel contre les critiques contenues dans les Provinciales. A ma connaissance, l’auteur n’a pas réitéré, et après cet article, on n’a plus jamais entendu parler de lui.
PASCAL, Les Provinciales, éd. Cognet, p. 102, n. 3.
RAPIN, Mémoires..., II, éd. Aubineau, p. 373.
GEF V, p. 21 sq.
CEYSSENS Lucien, “Autour de Caramuel”, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 33 (1961) 329-410, in Jansenistica minora, VII.
VI, 10. En vérité, mon Père, lui dis-je, il y a bien à profiter auprès de vos Docteurs. Quoi de deux personnes qui font les mêmes choses, celui qui ne sait pas leur doctrine, pèche ; celui qui la sait, ne pèche pas ! Elle est donc tout ensemble instructive et justifiante. La loi de Dieu faisait des prévaricateurs, selon S. Paul ; Et celle-ci fait qu’il n’y a presque que des innocents. Je vous supplie, mon Père, de m’en bien informer, je ne vous quitterai point que vous ne m’ayez dit les principales maximes que vos casuistes ont établies.
Texte de 1659 : « Est-elle donc tout ensemble instructive et justifiante ? »
Texte de 1659 : « Celle-ci fait qu’il n’y a presque que des innocents ».
La loi de Dieu faisait des prévaricateurs : saint Paul, Epître aux Romains, IV, 15, « parce que la loi produit la colère, et que là où il n’y a point de loi il n’y a point non plus de transgression », et V, 20, « Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ».
Prévariquer : trahir son devoir.
VI, 11. Hélas ! me dit le Père, notre principal but aurait été de n’établir point d’autres maximes que celles de l’Évangile dans toute leur sévérité. Et l’on voit assez par le règlement de nos mœurs, que si nous souffrons quelque relâchement dans les autres, c’est plutôt par condescendance que par dessein. Nous y sommes forcés. Les hommes sont aujourd’hui tellement corrompus, que ne pouvant les faire venir à nous, il faut bien que nous allions à eux. Autrement ils nous quitteraient, ils feraient pis, ils s’abandonneraient entièrement. Et c’est pour les retenir que nos Casuistes ont considéré les vices auxquels on est le plus porté dans toutes les conditions, afin d’établir des maximes si douces, sans toutefois blesser la vérité, qu’on serait de difficile composition si l’on n’en était content. Car le dessein capital que notre société a pris pour le bien de la Religion, est de ne rebuter qui que ce soit, pour ne pas désespérer le monde.
Ne pouvant les faire venir à nous, il faut bien que nous allions à eux : voir Paul Féval, Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi.
HERMANT, Vérités académiques, reproche dès 1643 aux jésuites « d’accommoder la loi à la corruption du siècle ». Voir SAINT-CYRAN, Apologie pour La Rocheposay, 1615, louait les casuistes d’avoir formé une « morale fort alléchante... » (avant sa conversion).
L’on voit assez par le règlement de nos mœurs que, si nous souffrons quelque relâchement dans les autres, c’est plutôt par condescendance que par dessein : voir V, 3, où Pascal fait dire à son personnage principal : je l’assurai que j’en connaissais qui sont aussi sévères que ceux qu’il me citait sont relâchés... Il ne conteste donc ni la vertu personnelle des jésuites, ni le fait que certains d’entre eux sont sévères du point de vue doctrinal. Les choses changeront après la mort de Pascal.
DANIEL Gabriel, Entretiens..., p. 254 sq. Pascal voit que les mœurs des jésuites sont une objection à sa thèse : il est contre l’ordinaire d’être sévère avec soi et doux avec les autres.
Condescendance : voir RABOURDIN David, Pascal. Foi et conversion, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p. 155. La notion de condescendance est classique dans la tradition de l’Église et permet de comprendre le mouvement de révélation divine comme adapté à la nature et à la constitution de l’homme. Elle qualifie la teneur des Écritures saintes ainsi que le mystère de l’Incarnation par le respect de la nature humaine dans le Christ. Le mot n’enferme aucune nuance de mépris.
Désespoir
Pour ne pas désespérer le monde : ce casuiste annonce Jean-Paul Sartre...
BOULENGER A., La doctrine catholique, § 290. Le désespoir est la perte totale de l’espérance. Il y a désespoir lorsque l’on regarde le salut comme impossible, soit parce qu’on se défie trop de ses forces, soit parce qu’on se juge trop coupable et qu’on ne compte plus sur la miséricorde divine pour obtenir le pardon de ses péchés ; c’est la faute de Caïn et de Judas. Ne pas confondre le désespoir avec l’abattement passager et avec la crainte excessive des peines de l’enfer. Opposition à la présomption.
MOREL Jacques, “Le péché de désespérance…”, in Aimables mensonges, p. 145 sq. Définition du théologien : p. 146. Acte de la volonté se détournant de Dieu comme fin dernière, parce qu’on juge l’acquisition du bonheur entièrement impossible pour soi-même : p. 146. Impuissance à agir et refus de l’effort : p. 146. Renoncement passif et volonté de se détruite : p. 146. Désespérance amoureuse : p. 147. Désespérance politique : p. 149. Désespérance héroïque : p. 151.
La définition du désespoir est donnée dans Laf. 192, Sel. 225, dans la liasse Excellence des Pensées : “La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l’orgueil. La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. La connaissance de J.-C. fait le milieu parce que nous y trouvons, et Dieu et notre misère.” Voir Laf. 208, Sel. 240 : “S’ils reconnaissent l’infirmité de la nature, ils en ignorent la dignité, de sorte qu’ils pouvaient bien éviter la vanité, mais c’était en se précipitant dans le désespoir” ; Laf. 352, Sel. 384 : “La misère persuade le désespoir. L’orgueil persuade la présomption. L’incarnation montre à l’homme la grandeur de sa misère par la grandeur du remède qu’il a fallu.”
La genèse psychologique du désespoir est donnée dans Laf. 622, Sel. 515. “Ennui. Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme, l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir.”
Le christianisme est le remède à la fois de l’orgueil et du désespoir : voir Laf. 354, Sel. 386. “Il n’y a point de doctrine plus propre à l’homme que celle-là qui l’instruit de sa double capacité de recevoir et de perdre la grâce à cause du double péril où il est toujours exposé de désespoir ou d’orgueil.”
Laf. 208, Sel. 240. “Sans ces divines connaissances qu’ont pu faire les hommes sinon ou s’élever dans le sentiment intérieur qui leur reste de leur grandeur passée, ou s’abattre dans la vue de leur faiblesse présente. Car ne voyant pas la vérité entière ils n’ont pu arriver à une parfaite vertu, les uns considérant la nature comme incorrompue, les autres comme irréparable, ils n’ont pu fuir ou l’orgueil ou la paresse qui sont les deux sources de tous les vices, puisqu’il ne peut sinon ou s’y abandonner par lâcheté, ou en sortir par l’orgueil. Car s’ils connaissaient l’excellence de l’homme, ils en ignorent la corruption de sorte qu’ils évitaient bien la paresse, mais ils se perdaient dans la superbe et s’ils reconnaissent l’infirmité de la nature ils en ignorent la dignité, de sorte qu’ils pouvaient bien éviter la vanité mais c’était en se précipitant dans le désespoir. De là viennent les diverses sectes des stoïques et des épicuriens, des dogmatistes et des académiciens, etc. La seule religion chrétienne a pu guérir ces deux vices, non pas en chassant l’un par l’autre par la sagesse de la terre, mais en chassant l’un et l’autre par la simplicité de l’Évangile. Car elle apprend aux justes qu’elle élève jusqu’à la participation de la divinité même, qu’en ce sublime état ils portent encore la source de toute la corruption qui les rend durant toute la vie sujets à l’erreur, à la misère, à la mort, au péché, et elle crie aux plus impies qu’ils sont capables de la grâce de leur rédempteur. Ainsi donnant à trembler à ceux qu’elle justifie et consolant ceux qu’elle condamne, elle tempère avec tant de justesse la crainte avec l’espérance par cette double capacité qui est commune à tous et de la grâce et du péché, qu’elle abaisse infiniment plus que la seule raison ne peut faire mais sans désespérer, et qu’elle élève infiniment plus que l’orgueil de la nature, mais sans enfler, et que faisant bien voir par là qu’étant seule exempte d’erreur et de vice il n’appartient qu’à elle et d’instruire et de corriger les hommes.”
Voir Laf. 449, Sel. 690. La religion chrétienne, “qui consiste proprement au mystère du Rédempteur, qui unissant en lui les deux natures, humaine et divine, a retiré les hommes de la corruption du péché pour les réconcilier à Dieu en sa personne divine. Elle enseigne donc ensemble aux hommes ces deux vérités : et qu’il y a un Dieu, dont les hommes sont capables, et qu’il y a une corruption dans la nature, qui les en rend indignes. Il importe également aux hommes de connaître l’un et l’autre de ces points ; et il est également dangereux à l’homme de connaître Dieu sans connaître sa misère, et de connaître sa misère sans connaître le Rédempteur qui l’en peut guérir. Une seule de ces connaissances fait, ou la superbe des philosophes, qui ont connu Dieu et non leur misère, ou le désespoir des athées, qui connaissent leur misère sans Rédempteur.”
Sur le désespoir des athées, voir Laf. 449, Sel. 690 : “le désespoir des athées, qui connaissent leur misère, sans Rédempteur”.
Ce sont aussi les pyrrhoniens à souligner la misère de l’homme (voir par exemple l’Entretien avec M. de Sacy : le pyrrhonien Montaigne établit la “faiblesse” de l’homme, p.125 de l’éd. P. Mengotti et J. Mesnard, Paris, Desclée de Brouwer, 1994).
A l’objection des athées “rien ne paraît”, correspond à l’”objection : “nous n’avons nulle lumière”, de sorte que même si l’on cherche, on ne trouve rien, la réponse de Pascal “Ne désespérez pas” renvoie au fondement de la religion : “Dieu a tempéré sa connaissance en sorte qu’il a donné des marques de soi visibles à ceux qui le cherchent et non à ceux qui ne le cherchent pas” (Sel.274 ; voir la dernière partie du Sel.182). Voir aussi Laf. 158, Sel.190 (“Commencement”), où Pascal reproche à l’ami de négliger les signes. “Ne désespérez pas” signifie donc “Dieu a donné des marques de soi visibles à ceux qui le cherchent”.
Laf. 352, Sel. 384. “La misère persuade le désespoir. L’orgueil persuade la présomption. L’incarnation montre à l’homme la grandeur de sa misère par la grandeur du remède qu’il a fallu.”
Le fragment Sel. 690 : (“le désespoir des athées, qui connaissent leur misère, sans Rédempteur”), qui se réfère explicitement à Sel.277 (on parle des athées) et à Sel. 225, Sel. 240 et Sel. 384, fait une sorte de synthèse entre deux désespoirs :
1. le désespoir de ceux qui disent qu’on ne peut rien trouver (Sel.277 : “Mais nous n’avons aucune lumière” ; Sel. 39 : “Rien ne paraît”)
2. le désespoir de ceux qui, après avoir cherché, ont trouvé que l’homme est misérable, sans avoir trouvé Dieu (Sel. 225 ; Sel. 240 ; Sel. 384).
La recherche commence par la volonté d’échapper au désespoir : Laf. 198, Sel. 229. “H. 5. En voyant l’aveuglement et la misère de l’homme, en regardant tout l’univers muet et l’homme sans lumière abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l’univers sans savoir qui l’y a mis, ce qu’il y est venu faire, ce qu’il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j’entre en effroi comme un homme qu’on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s’éveillerait sans connaître et sans moyen d’en sortir. Et sur cela j’admire comment on n’entre point en désespoir d’un si misérable état. Je vois d’autres personnes auprès de moi d’une semblable nature. Je leur demande s’ils sont mieux instruits que moi. Ils me disent que non et sur cela ces misérables égarés, ayant regardé autour d’eux et ayant vu quelques objets plaisants s’y sont donnés et s’y sont attachés. Pour moi je n’ai pu y prendre d’attache et considérant combien il y a plus d’apparence qu’il y a autre chose que ce que je vois j’ai recherché si ce Dieu n’aurait point laissé quelque marque de soi (...).”
Le désespoir apparaît dans le discours de l’incrédule de Laf. 427, ou plus exactement dans les remarques qui l’accompagnent : “Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de toute l’éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu’un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir ; mais ce que j’ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Comme je ne sais d’où je viens, aussi je ne sais où je vais ; et je sais seulement qu’en sortant de ce monde je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d’un Dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage. Voilà mon état, plein de faiblesse et d’incertitude. Et, de tout cela, je conclus que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer à chercher ce qui doit m’arriver. Peut-être que je pourrais trouver quelque éclaircissement dans mes doutes ; mais je n’en veux pas prendre la peine, ni faire un pas pour le chercher ; et après, en traitant avec mépris ceux qui se travailleront de ce soin - (quelque certitude qu’ils en eussent, c’est un sujet de désespoir, plutôt que de vanité) - je veux aller, sans prévoyance et sans crainte, tenter un si grand événement, et me laisser mollement conduire à la mort, dans l’incertitude de l’éternité de ma condition future.”
L’antonyme de désespoir est consolation : voir Laf. 432. “(18.) Quel sujet de joie de ne plus attendre que des misères sans ressources ! quelle consolation dans le désespoir de tout consolateur !”
Le remède au désespoir est dans le Christ : voir Laf. 212. “J.-C. est un Dieu dont on s’approche sans orgueil et sous lequel on s’abaisse sans désespoir”. Voir Laf. 416. “La nature est corrompue. Sans J.-C. il faut que l’homme soit dans le vice et dans la misère. Avec J.-C. l’homme est exempt de vice et de misère. En lui est toute notre vertu et toute notre félicité. Hors de lui il n’y a que vice, misère, erreur, ténèbres, mort, désespoir.”
Il y a un désespoir chrétien : voir Laf. 908. “Superstition et concupiscence. Scrupules, désirs mauvais. Crainte mauvaise. Crainte, non celle qui vient de ce qu’on croit Dieu, mais celle de ce qu’on doute s’il est ou non. La bonne crainte vient de la foi, la fausse crainte du doute ; la bonne crainte jointe à l’espérance, parce qu’elle naît de la foi et qu’on espère au Dieu que l’on croit ; la mauvaise jointe au désespoir parce qu’on craint le Dieu auquel on n’a point eu foi. Les uns craignent de le perdre, les autres de le trouver.”
Rapport du désespoir avec la théologie de la grâce : Laf. 912. “Quand on dit que J.-C. n’est pas mort pour tous, vous abusez d’un vice des hommes qui s’appliquent incontinent cette exception, ce qui est favoriser le désespoir au lieu de les en détourner pour favoriser l’espérance. Car on s’accoutume ainsi aux vertus intérieures par ces habitudes extérieures.”
Il y a un désespoir caricatural, lié au renversement qui, dans la nature humaine, grossit les choses insignifiantes et anéantit celles qui sont essentielles : voir Laf. 427 : “Rien n’est si important à l’homme que son état ; rien ne lui est si redoutable que l’éternité. Et ainsi, qu’il se trouve des hommes indifférents à la perte de leur être et au péril d’une éternité de misères, cela n’est point naturel. Ils sont tout autres à l’égard de toutes les autres choses : ils craignent jusqu’aux plus légères, ils les prévoient, ils les sentent ; et ce même homme qui passe tant de jours et de nuits dans la rage et dans le désespoir pour la perte d’une charge ou pour quelque offense imaginaire à son honneur, c’est celui-là même qui sait qu’il va tout perdre par la mort, sans inquiétude et sans émotion. C’est une chose monstrueuse de voir dans un même cœur et en même temps cette sensibilité pour les moindres choses et cette étrange insensibilité pour les plus grandes. C’est un enchantement incompréhensible, et un assoupissement surnaturel, qui marque une force toute-puissante qui le cause.”
VI, 12. Nous avons donc des maximes pour toutes sortes de personnes, pour les Bénéficiers, pour les Prêtres, pour les Religieux, pour les Gentilshommes, pour les domestiques, pour les riches, pour ceux qui sont dans le commerce, pour ceux qui sont mal dans leurs affaires, pour ceux qui sont dans l’indigence, pour les femmes dévotes, pour celles qui ne le sont pas, pour les gens mariés, pour les gens déréglés. Enfin rien n’a échappé à leur prévoyance. C’est-à-dire, lui dis-je, qu’il y en a pour le Clergé, la Noblesse et le tiers État. Me voici bien disposé à les entendre.
Il y en a pour le Clergé, la Noblesse et le tiers État : ce sont les trois ordres, en dehors desquels il n’y en a pas. Autrement dit, les casuistes ont traité de la société dans sa totalité.
Laf. 956, Sel. 791. « Si peu qu’elle incommode ils en font d’autres (grâces), car ils en disposent comme de leur ouvrage. (...) (A chaque occasion chaque grâce ; à chaque personne grâce pour les grands, grâce pour les coquins.). »
L’énumération burlesque est une technique rhétorique fréquente chez Pascal : il en a donné un exemple dans la Ve Provinciale, avec la liste des casuistes, mais c’est dans le fragment Laf. 148, Sel. 181, de la liasse Souverain bien des Pensées qu’il en a donné un exemple plus proche de ce passage : « Tous les hommes recherchent d’être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu’ils y emploient ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n’y vont pas est ce même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. La volonté [ne] fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, c’est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu’à ceux qui vont se pendre. Et cependant depuis un si grand nombre d’années jamais personne, sans la foi, n’est arrivé à ce point où tous visent continuellement. Tous se plaignent, princes, sujets, nobles, roturiers, vieux, jeunes, forts, faibles, savants, ignorants, sains, malades, de tous pays, de tous les temps, de tous âges, et de toutes conditions. »
Voir aussi dans De l’Esprit géométrique, II, De l’art de persuader, § 11, éd. J. Mesnard, p. 417 : « Les principes du plaisir ne sont pas fermes et stables. Ils sont divers en tous les hommes, et variables dans chaque particulier avec une telle diversité, qu’il n’y a point d’homme plus différent d’un autre que de soi même dans les divers temps. Un homme a d’autres plaisirs qu’une femme ; un riche et un pauvre en ont de différents ; un prince, un homme de guerre, un marchand, un bourgeois, un paysan, les vieux, les jeunes, les sains, les malades, tous varient ; les moindres accidents les changent. »
L’énumération donne l’impression d’un bric-à-brac, dans lequel il glisse des termes fâcheux ou compromettants. Les femmes qui ne sont pas dévotes, par opposition à celles qui le sont, les gens déréglés, par opposition à ceux qui ne le sont pas, quoique ces termes reprennent le système d’oppositions de ceux qui précèdent, aboutissent à tout compromettre, dans la mesure où les casuistes s’accommodent même de ceux qui sont visiblement contraires à la loi divine.
VI, 13. Commençons, dit le Père, par les bénéficiers. Vous savez quel trafic on fait aujourd’hui des bénéfices ; et que s’il fallait s’en rapporter à ce que s. Thomas et les anciens en ont écrit, il y aurait bien des simoniaques dans l’Église.
Bénéficier : charge spirituelle accompagnée de certains revenus que l’Église donne à un homme qui est tonsuré, ou dans les ordres, afin de servir Dieu. Voir dans CABOURDIN Guy et VIARD Georges, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1978, p. 189, l’article Bénéfice ; et dans BLUCHE François (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, p.185186, l’article Bénéfices ecclésiastiques, qui les définit comme suit : on appelle bénéfice ecclésiastique un ensemble de biens destinés à financer un office ecclésiastique. Il n’est pas alors nécessaire que le titulaire d’un bénéfice soit un ecclésiastique. Sur les problèmes que posait ces bénéfices, voir p. 185, B.
PILLORGET R. et S., France baroque France classique, II, Dictionnaire, p. 101.
PONTAS Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 229-230. Bénéfice, bénéficier.
Pour la manière dont Port-Royal envisageait les cas de conscience relatifs aux bénéficiers, consulter CARIOU Pierre, Les idéalités casuistiques. Aux origines de la psychanalyse, Paris, P. U. F., 1992, p. 185 sq., qui présente les décisions du casuiste augustinien Jacques de Sainte-Beuve.
Saint Thomas : Somme théologique, 2a 2ae, Q. 100.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, p. 198 sq., sur l’Imposture II sur la simonie.
La simonie
Le trafic des choses spirituelles et religieuses s’appelle la simonie. Pascal revient sur la simonie dans Provinciale XII, 11 sq.
BOUYER Louis, Dictionnaire théologique, p. 609. Du nom de Simon le Mage et de l’épisode narré en Actes des Apôtres, VIII, 9 sq., le mot simonie est traditionnellement attaché à tout achat ou vente de réalités spirituelles, ou de réalités temporelles inséparables des réalités spirituelles. Considérée comme un péché d’une particulière gravité, équivalent à l’hérésie ; voir Saint Thomas, in Somme théologique, IIa, IIae, q. 100. Voir Actes des Apôtres, VIII, 18. « Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l’imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, 19 en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint Esprit. 20 Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à prix d’argent ! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. 22 Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s’il est possible ; 23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité. 24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit. ». Elle entraîne la nullité de la collation de quelque bénéfice ou fonction ecclésiastique que ce soit.
Provinciales, éd. Cognet, p. 224, sur le Breviarium theologicum de Polman, 1655 : “c’est un vice contraire à la religion et une sorte de sacrilège ; sa malice consiste en ce que les choses spirituelles et sacrées y sont méprisées et indignement traitées, par le fait qu’elles sont mises sur le même pied que les choses profanes, qu’elles font l’objet de contrats et qu’elles sont estimées à un prix temporel.” A l’époque de Pascal, la simonie se manifeste surtout dans le trafic des bénéfices ecclésiastiques.
JOMBART Emile, Manuel de droit canon, p. 225-226. La simonie est un sacrilège réel qui consiste à échanger un bien spirituel contre un bien temporel. Il est gravement injurieux à Dieu de prétendre donner ou se procurer à prix d’or ses grâces surnaturelles : p. 225. La simonie de droit divin (interdite par la loi divine) est la volonté d’acheter ou de vendre (cela s’entend au sens large de tout contrat onéreux) moyennant une compensation d’ordre temporel (pro pretio temporali) une chose intrinsèquement spirituelle (sacrement, juridiction ecclésiastique, consécration, indulgence) ou une chose étroitement attachée à une chose spirituelle. La simonie de droit ecclésiastique consiste à donner du temporel attaché à du spirituel pour du temporel attaché à du spirituel, ou du spirituel pour du spirituel, ou même du temporel pour du temporel, si c’est interdit par l’Église à cause du danger d’irrévérence envers les choses spirituelles : p. 225-226. Il n’y a pas simonie
1. si le temporel n’est pas donné comme paiement du spirituel, mais à l’occasion du spirituel, en vertu d’un juste titre admis par les canons ou une coutume légitime ;
2. si l’on vend un objet temporel auquel est attaché quelque chose de spirituel (un calice consacré) si l’on n’élève pas le prix à cause de ce caractère spirituel (la consécration).
Sanctions canoniques de la simonie : C 2.371 et 2.392. Tout contrat simoniaque est nul de plein droit. Avant toute sentence judiciaire, la chose obtenue par simonie doit être abandonnée ou restituée ; on ne peut toucher les fruits d’un bénéfice acquis par simonie : p. 226.
Saint THOMAS, Somme théologique, IIa IIae, q. 100.
BAUNY Étienne, Somme des péchés, ch. XX, p. 567. Simonies recelées ès renonciations, collations, permutations, présentations. Devoir d’abandon du bénéfice obtenu par simonie : p. 567. Pratique en France : p. 568. Devoir de restitution des biens acquis par simonie : p. 569. Les simoniaques sont inhabiles au bénéfice qu’ils ont acquis : p. 569. Le simoniaque est de droit et de fait excommunié : p. 570.
NOUËT Jacques, Imposture II, in Réponses..., p. 98. Selon Nouët, il y a deux sortes de simonie, de droit divin et de droit positif : p. 98.
LANGE, La Bruyère critique..., p. 308. Sainte-Beuve, Résolution de plusieurs cas de conscience..., II, 1692, p. 117 : on n’a pas le droit de retenir plusieurs bénéfices “quand un est suffisant pour s’entretenir honnêtement” : p. 308. L’archevêque de Reims, Maurice Le Tellier, jouit de plus de 100 000 livres de revenus par ses abbayes de Saint-Etienne de Caen, de Lagny, Breteuil, Saint Bénigne de Dijon, etc. Les revenus de l’évêque d’Orléans vont à 120 000 livres. L’abbé Dunois a, à lui seul, neuf abbayes : p. 208.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 273 sq. Théorie de la simonie selon le P. Maynard.
Formes de la simonie : voir LANGE, La Bruyère critique..., p. 309. Le curé de paroisse exige une rétribution pour les baptêmes et les mariages. Le concile de Trente a interdit aux prêtres de rien recevoir pour les sacrements et les sépultures : p. 310. Ordonnance d’Orléans les fidèles à donner ce que bon leur semble ; ordonnance de Blois confirmant les curés dans la jouissance des droits paroissiaux qu’ils ont déjà accoutumé de percevoir ; un arrêt du Parlement (28 avril 1673) ordonne qu’il sera fait par l’archevêque de Paris un règlement des honoraires dus aux ecclésiastiques pour les sacrements : p. 310. Tarif homologué le 10 juin 1693 :
droit curial : 6 livres pour les grandes personnes
droit de présence : 4 livres
+ 1 livre pour chaque prêtre
Voir GUYOT, Répertoire de jurisprudence, article Honoraires des ecclésiastiques, VIII, p. 545-547.
Selon archives de Dijon, G 194, année 1742, on reçoit
| pour les baptêmes | ce qui est offert volontairement (souvent rien du tout) |
| la publication des bans de mariage | 3 livres |
| la messe nuptiale | 15 sols |
| l’enterrement d’un adulte | 3 livres |
| l’enterrement d’un enfant | 20 sols |
| le drap mortuaire d’un adulte | 3 livres |
| le drap mortuaire d’un enfant | 10 sols |
| mes extraits de baptême, de mariage et mortuaires | 10 sols |
LANGE, La Bruyère critique..., p. 313. Offrandes et rétributions pour les prédicateurs.
| un Avent prêché à la Cour par Bourdaloue rétribution d’un prédicateur à Saint Sulpice | 1 500 livres |
| un Carême | 600 livres |
| un Avent | 300 livres |
| l’octave du Saint-Sacrement | 60 livres |
| dimanches et fêtes | 3 livres |
en province, les sommes sont plus modiques
| 1676, un viatique et un Avent par le P. Germain de Verville à Rouen | 110 livres |
| 1676, le Carême prêché par Bourdaloue | 165 livres |
| 1677, un Avent par le P. d’Harouys | 99 livres |
| 1678, un Carême | 175 |
LANGE, La Bruyère critique..., p. 314. Dots et pensions considérables par lesquelles certaines communautés s’enrichissent. En 1667, un projet de déclaration est rédigé, aux termes duquel on défend aux monastères de filles de prendre aucune dot, présent ou pension pour la réception des novices, avant d’avoir “représenté par devant leur évêque l’état de leurs biens et de leurs charges” pour empêcher les “traités illicites” par lesquels des personnes étant admises aux vœux moyennant des sommes certaines : p. 314. Mais certains trouvent ces mesures trop sévères et les pensions légitimes : p. 315. On distingue pour les dots entre couvents riches et pauvres : p. 315. En 1693, déclaration au profit des Carmélites, Filles de S. Marie, Ursulines et autres, permettant de prendre dans les villes où il y a Parlement 8 000 livres de dot et 500 de pension, et dans les autres villes 350 de pension et 6 000 de dot : p. 316.
ARNAULD Antoine, Troisième écrit des Curés de Paris, in Divers écrits,..., p. 73. Saint Thomas faussement allégué touchant la simonie. Sur la distinction entre prix et motif. Le P. Pirot conscient du fait que la décision de Valentia est contraire à saint Thomas : p. 73. Falsification des textes de saint Thomas : p. 74 sq. Saint Thomas n’a jamais cru que pour être simoniaque en donnant de l’argent pour obtenir une dignité ecclésiastique, il fût nécessaire d’avoir la pensée que cet argent était un prix égal à cette dignité : p. 75. Cas des gens qui donnent des bénéfices à leurs parents : p. 78 sq.
DONETZKOFF Denis, Saint-Cyran épistolier, p. 39. Casuistique chez Saint-Cyran dans L’Apologie pour La Rocheposay. Morale alléchante qui donne aux gentilshommes le moyens de paraître vaillants, s’ils sont tant soit peu raisonnables, et de conserver leur honneur sans appeler en duel ceux qui les ont offensés ; et aux gens d’Église de s’accommoder honnêtement de bénéfices sans commettre une exécrable simonie : p. 39. Sans usure ni mauvais trafic : p. 40. Pour les hommes de robe : p. 40.
JOUSLIN Olivier, Pascal et le dialogue polémique, p. 394 sq. Voir p. 547, sur l’Imposture II sur la simonie.
CARIOU Pierre, Les idéalités casuistiques. Aux origines de la psychanalyse, Paris, P. U. F., 1992, p. 187 sq. Jacques de Sainte-Beuve sur la simonie. Définition de la confidence comme « pacte exprès ou tacite que deux ecclésiastiques font ensemble, et dans lequel l’un d’eux accepte un bénéfice pour le donner à l’autre, ce qu’on nomme simonie confidentielle » : p. 188. Comparer les décisions de Sainte-Beuve à celles des casuistes mentionnés par Pascal peut être un exercice intéressant de mise en perspective...
VI, 13. Et c’est pourquoi il a été fort nécessaire que nos Pères aient tempéré les choses par leur prudence, comme ces paroles de Valentia, qui est l’un des 4 animaux d’Escobar, vous l’apprendront.
C’est pourquoi : l’édition primitive donne Et c’est pourquoi...
Il a été fort nécessaire... : l’éd. GEF V, p. 39, donne il est. Texte de 1659 : « C’est pourquoi il a été fort nécessaire ».
Valentia, jésuite, 1551-1603, longtemps professeur à Ingolstadt, où son enseignement sur la grâce avait provoqué de vifs incidents en 1584. L’ouvrage visé est son commentaire sur saint Thomas, 1591, 5 vol. Il ne figure pas dans la liste des casuistes de la Provinciale V.
HURTUBISE Pierre, La casuistique dans tous ses états. De Martin Azpilcueta à Alphonse de Liguori, Ottawa, Novalis, 2005.
L’un des quatre animaux d’Escobar : voir la Ve Provinciale, qui mentionne les quatre animaux : « C’est Escobar. Qui est Escobar, lui dis-je, mon Père ? Quoi ! vous ne savez pas qui est Escobar de notre Société, qui a compilé cette Théologie morale de vingt-quatre de nos Pères ; sur quoi il fait, dans la préface, une allégorie de ce livre à celui de l’Apocalypse qui était scellé de sept sceaux ? Et il dit que Jésus l’offre ainsi scellé aux quatre animaux, Suarez, Vasquez, Molina, Valentia, en présence de vingt-quatre Jésuites qui représentent les vingt-quatre vieillards ? »
Voir Apocalypse, IV, 6. “Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière. 7 Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d’un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.”
Le commentaire de la Bible de Port-Royal rappelle d’abord que le prophète Ézéchiel, X, 20, avait, avant saint Jean, décrit quatre animaux différents de ceux de l’Apocalypse, qu’il appelait des chérubins. Sur les quatre animaux de l’Apocalypse, le commentaire est le suivant : « Si nous voulons maintenant examiner ce que signifient ces quatre animaux, il faut remarquer que saint Jean les place dans le ciel, et qu’il en fait des natures intelligentes, favorisées de la connaissance des secrets de Dieu, et continuellement occupés à le louer, ce qui ne peut convenir qu’à des anges ou des âmes bienheureuses : ce qui exclut la plupart des interprétations qu’on en donne, et qui sont en grand nombre. Mais le sentiment le plus commun et le plus autorisé, c’est que ces quatre animaux mystérieux marquent les quatre évangélistes, dans lesquels comme dans les principaux écrivains du Nouveau Testament, sont compris tous les apôtres, et tous les saints docteurs qui ont éclairé l’Église par leurs écrits. Les Pères ont cru que le commencement de chaque Évangile était marqué par chaque animal, quoiqu’ils ne conviennent pas tous dans l’application qu’ils en font ; car bien que la plupart donnent la figure de l’homme à saint Matthieu, celle du lion à saint Marc, celle du veau à saint Luc, celle de l’aigle à saint Jean, néanmoins saint Augustin croit que l’Évangile de saint Matthieu est marqué par la ressemblance du lion, et celui de saint Marc par celle de l’homme ; sans parler des applications différentes que saint Irénée [Iren. l. 3. c. 11] et d’autres en ont faites. Ce sentiment qui applique aux quatre évangélistes la signification des quatre animaux de l’Apocalypse, n’est pas sans quelque difficulté ; car quoiqu’il se puisse soutenir dans la vision d’Ézéchiel, ce qui suffit pour maintenir l’autorité qu’il a dans la tradition, il paraît néanmoins insoutenable dans la révélation faite à saint Jean. En effet si l’on suppose que ces animaux mystérieux étaient dans le ciel occupés à louer Dieu, saint Jean qui est lui-même évangéliste, et qui était alors sur la terre ne pouvait être de ce nombre ; outre qu’il dit que ces quatre animaux lui ont parlé séparément [c. 6. v. 1. 3. 5. 7] : or comment se peut-il faire que le quatrième évangéliste qui est saint Jean lui-même, parlât à saint Jean et lui enseignât des mystères qu’il ignorait ? Pouvait-il être en même temps sur la terre et dans le ciel, s’enseigner lui-même et apprendre de lui-même ? C’est ce qui porte à croire plutôt que ce sont quatre esprits célestes représentés par les quatre chérubins du temple [Perer. c. 4. disput. 21], qui sont les quatre anges principaux dont Dieu se sert pour exécuter ses ordres dans le gouvernement du monde et sur toute l’Église : ce sont des lions par leur force et leur puissance ; des bœufs par leur soumission et leur attachement au service de Dieu ; des hommes par leur prudence et leur sagesse, et par leur affection pour les hommes ; des aigles par leur vitesse et leur promptitude à exécuter ce que Dieu leur commande. On peut voir néanmoins ce qui a été dit sur ce sujet dans l’explication du premier et dixième chapitre d’Ézéchiel ».
VI, 13. C’est la conclusion d’un long discours, où il en donne plusieurs expédients, dont voici le meilleur à mon avis. C’est en la page 2042 du tome 3. Si l’on donne un bien temporel pour un bien spirituel. C’est-à-dire de l’argent pour un Bénéfice ; Et qu’on donne l’argent comme le prix du Bénéfice, c’est une simonie visible. Mais si on le donne comme le motif qui porte la volonté du bénéficier à le résigner, non tanquem pretium beneficii, sed tanquam motivum ad resignandum, ce n’est point simonie, encore que celui qui résigne, considère et attende l’argent comme sa fin principale.
Texte de 1659 : « C’est en la page 2039 du tome III ».
Texte de 1659 : « si on le donne comme le motif qui porte la volonté du collateur à le conférer ».
Conférer : pourvoir à un bénéfice (Dictionnaire de l’académie).
Résigner : se démette d’un office, d’un bénéfice au profit de quelqu’un d’autre (Dictionnaire de l’académie).
Texte de 1659 : « Si l’on donne un bien temporel pour un bien spirituel, c’est-à-dire de l’argent pour un bénéfice, et qu’on donne l’argent comme le prix du bénéfice, c’est une simonie visible ; mais si on le donne comme le motif qui porte la volonté du collateur à le conférer, ce n’est point simonie, encore que celui qui le confère, considère et attende l’argent comme la fin principale » : ce texte est éloigné de l’original. L’édition Cognet, qui donne le texte de 1659, note que les citations latines qui sont dans les éditions de 1656 et 1657 ne correspondent pas au texte de Valentia, ce qui explique qu’elles aient ensuite été supprimées. Voir le texte original de Valentia, Commentariorum theologicorum libri quatuor, in GEF V, p. 24-25. Wendrock éviter de reprendre le texte de Pascal et a rétabli le texte de Valentia, avec quelques coupures seulement. L’édition Le Guern, Pléiade, t. 1, donne le motif qui porte la volonté du collateur à la conférer, tanquam motivum conferendi spirituale, ce n’est point simonie..., p. 641 ; c’est le texte de l’édition de 1657, que Le Guern pense avoir été corrigée par Pascal. Ce texte sera de nouveau utilisé par Pascal dans la Provinciale XII, 12 : « C’est ainsi que vous vous jouez de la religion pour suivre la passion des hommes ; et voyez néanmoins avec quelle gravité votre Père Valentia débite ses songes à l’endroit cité dans mes Lettres, t. 3, disp. 16, p. 3, p. 2044 : On peut, dit-il, donner un temporel pour un spirituel en deux manières : l’une en prisant davantage le temporel que le spirituel, et ce serait simonie : l’autre en prenant le temporel comme le motif et la fin qui porte à donner le spirituel, sans que néanmoins on prise le temporel plus que le spirituel ; et alors ce n’est point simonie. Et la raison en est, que la simonie consiste à recevoir un temporel comme le juste prix d’un spirituel. Donc, si on demande le temporel, si petatur temporale, non pas comme le prix, mais comme le motif qui détermine à le conférer, ce n’est point du tout simonie, encore qu’on ait pour fin et attente principale la possession du temporel : minime erit simonia, etiamsi temporale principaliter intendatur et expectetur. »
Valentia, jésuite, 1551-1603, longtemps professeur à Ingolstadt, où son enseignement sur la grâce avait provoqué de vifs incidents en 1584. L’ouvrage visé est son commentaire sur saint Thomas, 1591, 5 vol. Il ne figure pas dans la liste des casuistes de la Provinciale V.
Voir NOUËT, Imposture II, in Réponses..., p. 97 sq. ; texte in GEF V, p. 24 sq. Nouët compare cette critique à une attaque faite par Du Moulin dans ses Traditions, p. 312. Pascal répond à sa critique dan la Provinciale XII, éd. Cognet, p. 224 sq. Selon Nouët, il y a deux sortes de simonie, de droit divin et de droit positif : p. 98.
ARNAULD, Troisième écrit des Curés de Paris, in Divers écrits,..., p. 73. Saint Thomas faussement allégué touchant la simonie. Sur la distinction entre prix et motif. Le P. Pirot conscient du fait que la décision de Valentia est contraire à saint Thomas : p. 73. Falsification des textes de saint Thomas : p. 74 sq. Saint Thomas n’a jamais cru que pour être simoniaque en donnant de l’argent pour obtenir une dignité ecclésiastique, il fût nécessaire d’avoir la pensée que cet argent était un prix égal à cette dignité : p. 75. Cas des gens qui donnent des bénéfices à leurs parents : p. 78 sq.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 256 sq. Sur le texte de Valentia. Daniel remarque que les passages latins ne se trouvent pas chez Valentia : p. 257. Sur la suppression des passages en latin dans les dernières éditions : p. 267. Daniel expose ensuite la doctrine de Valentia sur la simonie : p. 258 sq. C’est un simple commentaire de saint Thomas : p. 259. Il ne traite la chose qu’en général : p. 359. La distinction du motif et de la compensation gratuite : p. 260. Justification par saint Thomas : p. 261. Autres falsifications sur le texte latin : p. 262 sq. Le nœud de l’imposture de Pascal, c’est qu’il confond deux situations, celle du pauvre à qui on donne de l’argent pour avoir des prières, et celle du bénéficier à qui on achète son bénéfice : p. 264 sq. Ce qu’il faudrait condamner si on suivait Pascal : p. 265.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 276 sq. Analyse de la citation de Valentia.
VI, 13. Tannerus, qui est encore de notre Société, dit la même chose dans son tome 3, p. 1519. quoiqu’il avoue que saint Thomas y est contraire, en ce qu’il enseigne absolument que c’est toujours simonie de donner un bien spirituel pour un temporel, si le temporel en est la fin.
GEF V, p. 40.
Adam Tanner : Jésuite. Né à Innsbrück en 1572, il fut admis dans la Compagnie de Jésus en 1590 et enseigna la théologie à Munich pendant 22 ans. Ferdinand II le nomma chancelier de l’Université de Prague ; mais l’air de cette ville étant contraire à sa santé, le P. Tanner fut envoyé dans son pays natal. Il mourut en chemin le 25 mai 1632. Voir RAPIN René, Mémoires..., II, éd. Aubineau, p. 373.
RAPIN , Mémoires..., II, éd. Aubineau, p. 373.
HURTUBISE Pierre, La casuistique dans tous ses états. De Martin Azpilcueta à Alphonse de Liguori, Ottawa, Novalis, 2005.
Le texte de Tanner, Theologia scholastica, speculative, practica, ad methodum S. Thomae ..., Disp. V, De relig. Quaest. VIII, Dub. III, tomus tertius, col. 1520, Ingolstadt, 1621-1627, 3 vol, se trouve dans GEF V, p. 23. Dans son tome III, p. 1519 : GEF V, p. 40, note qu’il faudrait lire 1520 (l’erreur de Pascal est due au fait que dans ce livre, ce sont les colonnes et non les pages qui sont numérotées). La clause « se trouve bien §. 66, p. 1520 (GEF V, p. 24).
« Respondetur II. Id etiam admodum explicatum procedere, tametsi temporale sit principale motivum dandi spirituale ; imo etiamsi sit finis ipsius rei spiritualis ; sic ut illud pluris aestimetur, quam res spiritualis. Ita docent Sotus l. 9. De Just. q. 6. art. 2. et Victoria in Relect. de sim. nu. 33. etsi contrarium dixisse videantur S. Thomas hic qu. 100. a. 5. ad. 3., Adrianus quodlib. 9., Gabriel in 4. d. 25. q. 2, Navarrus man. c. 23. n. 101. et Covarrurias l. 1. var. capite ult. num. 3. qui absolute asserunt, simoniam esse, conferre spirituale propter temporale, tanquam propter finem : quod limitate concedit Valentia cit. pun. 3. si temporale non solum sit finis applicationis animi ad actu conferendi spirituale, sed etiam ipsius rei spiritualis, ita ut temporale pluris faciat, quam rem spiritualem ».
Pascal revient sur cet extrait dans Provinciale XII, 12, éd. Cognet, p. 226. Il précise la référence en ajoutant le numéro de la Disputatio en question, mais il donne toujours comme numéro de page celui de la colonne 1519, alors qu’il faudrait 1520. « Et quant à Tannerus, voici sa doctrine, pareille à celle de Valentia, qui fera voir combien vous avez tort de vous plaindre de ce que j’ai dit qu’elle n’est pas conforme à celle de saint Thomas ; puisque lui-même l’avoue au lieu cité dans ma Lettre, t. 3, d. 5, p. 1519 : Il n’y a point, dit-il, proprement et véritablement de simonie, sinon à prendre un bien temporel comme le prix d’un spirituel : mais, quand on le prend comme un motif qui porte à donner le spirituel, ou comme en reconnaissance de ce qu’on l’a donné, ce n’est point simonie, au moins en conscience. Et un peu après : Il faut dire la même chose, encore qu’on regarde le temporel comme sa fin principale, et qu’on le préfère même au spirituel : quoique saint Thomas et d’autres semblent dire le contraire, en ce qu’ils assurent que c’est absolument simonie de donner un bien spirituel pour un temporel, lorsque le temporel en est la fin.»
NOUËT Jacques, Imposture II, in Réponses..., p. 97 sq.
VI, 13. Par ce moyen nous empêchons une infinité de simonies. Car qui serait assez méchant pour refuser en donnant de l’argent pour un bénéfice, de porter son intention à le donner comme un motif qui porte le Bénéficier à le résigner, au lieu de le donner comme le prix du Bénéfice : personne n’est assez abandonné de Dieu pour cela. Je demeure d’accord, lui dis-je, que tout le monde a des grâces suffisantes pour faire un tel marché. Cela est assuré, repartit le Père.
La formule relie la théologie de la grâce à la doctrine des opinions probables.
VI, 14. Voilà comment nous avons adouci les choses à l’égard des bénéficiers. Quant aux Prêtres, nous avons plusieurs maximes qui leur sont assez favorables. Par exemple celle-ci de nos 24, p. 143. Un prêtre qui a reçu de l’argent pour dire une Messe, peut-il recevoir de nouvel argent sur la même Messe ? Oui, dit Filiutius, en appliquant la partie du sacrifice qui lui appartient comme Prêtre à celui qui le paie de nouveau, pourvu qu’il n’en reçoive pas autant que pour une Messe entière ; mais seulement pour une partie, comme pour un tiers de Messe.
Texte de 1659 : tr. I, ex. 11, n. 96. La référence est à la p. 186 d’Escobar, et non 196, comme l’indique l’éd. Cognet, p. 105, n. 2. « Potestne sacerdos, dum accepto stipendio pro atero celebrat, partem sacrificii sibi convenientem alteri applicare, et pro ea stipendium accipere. Posse sentit Filliuc. Dum non tanquam pro integro sacrificio, sed pro parte, ut pro una tertia accipiat. » >La traduction est fidèle, sinon absolument exacte (Cognet). Proposition condamnée par Alexandre VII, Denzinger, 1108.
VI, 15. Certes, mon Père, voici une de ces rencontres où le pour et le contre sont bien probables. Car ce que vous dites ne peut manquer de l’être après l’autorité de Filiutius et d’Escobar. Mais en le laissant dans la sphère de probabilité, on pourrait bien, ce me semble dire aussi le contraire, et l’appuyer par ces raisons. Lorsque l’Église permet aux prêtres qui sont pauvres de recevoir de l’argent pour leurs Messes, parce qu’il est bien juste que ceux qui servent à l’autel vivent de l’autel ; elle n’entend pas pour cela qu’ils échangent le sacrifice pour de l’argent, et encore moins qu’ils se privent eux-mêmes de toutes les grâces qu’ils en doivent tirer les premiers. Et je dirais encore que les Prêtres, selon S. Paul, sont obligés d’offrir le sacrifice premièrement pour eux-mêmes, et puis pour le peuple ; et qu’ainsi il leur est bien permis d’en associer d’autres au fruit du sacrifice, mais non pas de renoncer eux-mêmes volontairement à tout le fruit du sacrifice, et de le donner à un autre pour un tiers de Messe ; c’est-à-dire pour 4. ou 5. sols. En vérité, mon Père, pour peu que je fusse grave, je rendrais cette opinion probable. Vous n’y auriez pas grand peine, me dit-il, Celle-là l’est visiblement.
Le texte de 1659 est : « Mais en le laissant dans sa sphère de probabilité ». Les recueils de pièces R 1035, R 5452 et R 5597 donnent tous la sphère.
Texte de 1659 : « Vous n’y auriez pas grand peine, me dit-il, elle l’est visiblement ».
Qu’il est bien juste que ceux qui servent à l’autel vivent de l’autel :> s. Paul, I Ep. Cor., IX, 13, « nescitis quoniam qui in sacrario operantur quae de sacrario sunt edunt qui altario deserviunt cum altario participantur » ; « ne savez-vous pas que les ministres du temple mangent de ce qui est offert dans le temple ; et que ceux qui servent à l’autel ont part aux oblations de l’autel ? »
Les prêtres, selon saint Paul, sont obligés d’offrir le sacrifice, premièrement pour eux-mêmes, et puis pour le peuple : voir Ep. Hébr. V, 3, « et propterea debet (pontifex) quemadmodum pro populo, ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis ».
Ces deux références scripturaires ne sont pas placées là par hasard : Pascal suggère que si l’opinion du jésuite est appuyée sur des casuistes douteux, la sienne est directement inspirée par l’Écriture.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 271 sq.
L’inspiration de ce passage réapparaît dans des textes modernes, portant sur des sujets éloignés. Voir LEYS Simon, Ombres chinoises, in Essais sur la Chine, p. 336. Résurgences maoïstes de ce type d’exercices de casuistique.
VI, 15. La difficulté était de trouver de la probabilité dans le contraire. Et c’est ce qui n’appartient qu’aux grands personnages. Le P. Bauny y excelle. Il y a du plaisir de voir ce savant Casuiste pénétrer dans le pour et le contre d’une même question qui regarde encore les Prêtres, et trouver raison partout, tant il est ingénieux et subtil.
Texte de 1659 : « La difficulté était de trouver de la probabilité dans le contraire des opinions qui sont manifestement bonnes ». L’addition ne se trouve pas dans Wendrock.
VI, 16. Il dit en un endroit, c’est dans le traité X, p. 474 : On ne peut pas faire une loi qui obligeât les curés à dire la messe tous les jours, parce qu’une telle loi les exposerait indubitablement, haud dubie, au péril de la dire quelquefois en péché mortel.
GEF. V, p. 16, texte de la Theologia moralis.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 271 sq.
Sur les curés et les charges qui leur incombent, voir dans BLUCHE François (dir.), Dictionnaire du grand siècle, article Curés, p. 440-441.
VI, 16. Et néanmoins dans le même traité 10, p. 441, il dit : Que les prêtres qui ont reçu de l’argent pour dire la Messe tous les jours, la doivent dire tous les jours, et qu’ils ne peuvent pas s’excuser sur ce qu’ils ne sont pas toujours assez bien préparés pour la dire, parce qu’on peut toujours faire l’acte de contrition ; et que s’ils y manquent, c’est leur faute, et non pas celle de celui qui leur fait dire la Messe.
Voir dans GEF V, p. 16, les textes de la Theologia moralis. Comme l’indique Cognet, p. 106, n. 4, ceci n’est qu’un résumé de Bauny et non une citation.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 271 sq.
VI, 16. Et pour lever les plus grandes difficultés qui pourraient les en empêcher, il résout ainsi cette question dans le même traité, qu. 32, page 457. Un Prêtre peut-il dire la Messe le même jour qu’il a commis un péché mortel, et des plus criminels en se confessant auparavant ? Non, dit Villalobos, à cause de son impureté ;
Lire q. 33 au lieu de q. 32.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 273 sq. Explication de la décision de Bauny.
Pascal remplace par un équivalent pudique le texte de Bauny, que Wendrock rétablit : habitam eo die copulam carnalem cum femina, aut pollutionem voluntariam...
VI, 16. mais Sancius dit qu’oui : et sans aucun péché, et je tiens son opinion sûre, et qu’elle doit être suivie dans la pratique : et tuta et sequenda in praxi.
On lit Sancius dit que ouy dans le R 5597, de même que le R 5452. Le R 1035 donne Sancius dit qu’ouy. L’édition Cognet, Garnier, p. 107, ne tient pas compte de cette variante, au reste insignifiante.
Sanctius : Thomas Sanchez, jésuite. Voir V, 15.
C’est un problème. Le quatrième Écrit des curés de Paris parle d’un Jean Sancius. Thomas ou Jean il faut choisir.
VI, 17. Quoi ! mon Père, lui dis-je, on doit suivre cette opinion dans la pratique ? Un prêtre qui serait tombé dans un tel désordre oserait-il s’approcher le même jour de l’autel, sur la parole du P. Bauny ? Et ne devrait-il pas déférer aux anciennes lois de l’Église, qui excluaient pour jamais du sacrifice, les prêtres qui avaient commis des péchés de cette sorte, plutôt que de s’arrêter aux nouvelles opinions des casuistes, qui les y admettent le jour même qu’ils y sont tombés ?
Texte de 1659 : « plutôt que de s’arrêter aux nouvelles opinions des casuistes... »
L’exemplaire R 1035 de la Bibliothèque de Clermont donne une précision à l’expression « pour jamais » : « Et ne devrait-il pas déférer aux anciennes lois de l’Église, qui excluaient pour jamais du sacrifice, ou au moins pour un long temps, les prêtres qui avaient commis des péchés de cette sorte, que les nouvelles opinions des casuistes qui les y admettent le même jour qu’ils y sont tombés ? »
VI, 17. Vous n’avez point de mémoire, dit le Père. Ne vous appris-je pas l’autre fois, Que l’on ne doit pas suivre dans la morale, les anciens Pères, mais les nouveaux casuistes ? selon nos Pères Cellot et Reginaldus. Je m’en souviens bien, lui réponds-je. Mais il y a plus ici. Car il y a des lois de l’Église. Vous avez raison, me dit-il ; mais c’est que vous ne savez pas encore cette belle maxime de nos Pères, Que les lois de l’Église perdent leur force, quand on ne les observe plus, cum jam desuetudine abierunt, comme dit Filiutius, to. 2, tr. 25, n. 33.
L’autrefois : il semble que Pascal ait entendu autrefois comme un seul mot. Dans le R 5452, le mot se trouve coupé en fin de ligne, avec un tiret après autre. A côté d’autrefois comme adverbe, Furetière indique aussi qu’autrefois « signifie aussi un autre temps. Je ne puis faire cela maintenant, ce sera pour une autrefois ». La même forme se trouve dans l’édition collective de 1657 (Cologne, P. de La Vallée). L’édition de 1659 (Cologne, Schoute) donne encore autrefois en un mot.
Le texte de 1659 : « ne vous appris-je pas l’autre fois que, selon nos Pères Cellot et Reginaldus, l’on ne doit pas suivre, dans la morale, les anciens Pères, mais les nouveaux casuistes ? »
Provinciale V, 21. « Vous l’entendez bien peu, me dit-il. Les Pères étaient bons pour la morale de leur temps ; mais ils sont trop éloignés pour celle du nôtre. Ce ne sont plus eux qui la règlent, ce sont les nouveaux casuistes. »
Texte de Filiutius : GEF V, p. 22. Voir NOUËT, Impostures, XXVI, in Réponses, p. 226. Voir p. 229 : Pascal tire le “desuetudine abierunt” d’une décision particulière touchant les blasphémateurs, sur les peines infligées par la Loi ancienne et par la Loi de grâce.
PIROT, Apologie pour les casuistes, p. 123 sq. “Il n’y a point d’avocat de village qui ne soit capable de vous apprendre que la coutume peut abroger une loi, et que la loi cesse quand on ne l’observe plus, pourvu que l’inobservance dure le temps que les canons ont déterminé pour ôter l’obligation de la loi”. Références à l’appui de cette thèse : p. 123-124.
WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 299 sq., Note I, Dissertation théologique sur l’autorité constante des canons... Contre l’idée des casuistes que les lois s’abrogent par le non-usage : p. 299. Certains canons regardent certaines pratiques ou certaines cérémonies : il y aurait de l’impiété à les mépriser, quand ils sont en usage, mais il y aurait du danger à les défendre ou à vouloir les rétablir trop opiniâtrement quand ils sont abolis ; c’est d’eux qu’il faut entendre la maxime que les lois s’abrogent par le non usage. Les autres ont pour but de régler les mœurs et de réprimer les vices ; ceux-là ne s’abolissent pas par la hardiesse qu’on met à les violer : p. 300-301. “Car il faut bien remarquer ici que quoique le changement des temps puisse faire changer la discipline extérieure de l’Église, son esprit néanmoins demeure toujours le même, et que les sentiments intérieurs qu’elle a sur les mœurs et sur la conduite que doivent garder ses enfants, sont immuables et invariables” : p. 301. L’Église demeurant elle-même, elle conserve intacts ses canons. Il y en a qui sont purement positifs, c’est-à-dire qu’ils imposent une obligation nouvelle ; et d’autres qui ne font que renouveler ou déterminer ce qui est déjà commandé par le droit divin ou naturel : p. 300. Les canons de l’Église conservent toujours leur autorité en ce qu’ils contiennent du droit divin : p. 304 sq. Un abus contraire aux lois de l’Église quoique déjà invétéré, ne les doit pas faire regarder comme abrogées : p. 312 sq. Si c’était vrai, les lois de l’Église dépendraient de la volonté des hommes : p. 314. Les nouveaux casuistes s’éloignent de ces règles : p. 319 sq.
DOMAT Jean, Traité des lois, ch. XII, p. XCI. “On a vu que l’autorité des coutumes et des usages est fondée sur cette raison qu’on doit présumer que ce qui a été longtemps observé est utile et juste ; d’où il s’ensuit que si quelque loi ou quelque coutume a cessé longtemps d’être en usage, elle est abolie. Et comme elle avait eu son autorité sur le long usage, cette même cause peut la lui ôter. Car elle fait voir que ce qu’on a cessé d’observer n’était plus utile.” Voir XI, p. LXXX sq.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 276.
FERREYROLLES Gérard, Pascal et la raison du politique, p. 66 sq. Le fait commande au droit.
NOUËT, Impostures, XXVI, in Réponses, p. 226 sq. Principe valable pour les lois : p. 227. “Les canons s’accordent avec les lois civiles” : p. 227. Références sur les rapports de la loi et de la coutume : p. 227 sq. La coutume, quand elle a cours depuis longtemps, déroge à la loi : p. 228. La loi peut céder à la coutume : p. 228.Les lois ecclésiastiques et canoniques changent et perdent leur force lorsque l’Église les change pour de justes causes : p. 229.
JOUSLIN Olivier, Pascal et le dialogue polémique, p. 701 sq. Discussion du P. Nouët dans la Seconde partie des Impostures sur ce sujet. Pour Nouët, il s’agit seulement d’une question d’opposition entre loi et coutume. Il répond en termes strictement juridiques en affirmant que la loi cède à la coutume selon le droit, lorsque celle-ci est raisonnable et confirmée par le temps. Il déduit que les lois ecclésiastiques sont susceptibles d’abrogation : p. 702.
Classification des préceptes ecclésiastiques
WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 299 sq., Note I, Dissertation théologique sur l’autorité constante des canons... Les uns regardent certaines pratiques ou certaines cérémonies : il y aurait de l’impiété à les mépriser, quand ils sont en usage, mais il y aurait du danger à les défendre ou à vouloir les rétablir trop opiniâtrement quand ils sont abolis ; c’est d’eux qu’il faut entendre la maxime que les lois s’abrogent par le non usage. Les autres ont pour but de régler les mœurs et de réprimer les vices ; ceux-là ne s’abolissent pas par la hardiesse qu’on met à les violer : p. 300-301.
VI, 17. Nous voyons mieux que les anciens les nécessités présentes de l’Église. Si on était si sévère à exclure les Prêtres de l’Autel, vous comprenez bien qu’il n’y aurait pas un si grand nombre de Messes. Or la pluralité des Messes apporte tant de gloire à Dieu, et tant d’utilité aux âmes, que j’oserais dire avec notre Père Cellot, dans son livre de la Hiérarch. p. 611. impression de Rouen, qu’il n’y aurait pas trop de prêtres. Quand non seulement tous les hommes et les femmes, si cela se pouvait, mais que les corps insensibles, et les bêtes brutes même, bruta animalia, seraient changés en Prêtres pour célébrer la Messe. Je fus si surpris de la bizarrerie de cette imagination que je ne pus rien dire, de sorte qu’il continua ainsi.
Le P. Cellot : Jésuite, recteur du collège de Rouen, il a publié en 1641 le De hierarchia et hierarchicis, contre Saint-Cyran. Il a été provincial de France.
Il est l’auteur du De Hierarchia et hierarchicis, libri IX in quibus pulcherrima dispositione omnes hierarchici gradus et ordines, episcopalis principatus, clericalis dignitas, religiosa sanctitas, secundam Patrum doctrinam, decreta conciliorum, Ecclesiae ritus et mores, sine justa cujusquam offensione explicantur, Rouen, 1641, 966 p. f°.
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 115 sq. Cellot a enseigné plusieurs années l’Écriture sainte au Collège de Clermont : p. 115. Il sera par la suite recteur du collège de Rouen et provincial de 1654 à 1657. Le De hierarchia est d’abord un livre de théologie : il expose les divisions de la hiérarchie ecclésiastique. Intention polémique : il est rédigé pour répondre au Petrus Aurelius de Saint-Cyran et à François Hallier. Il fait l’apologie des jésuites anglais Knott et Floyd. Il distingue trois classes : celle de la juridiction, celle de l’ordre et celle des charismes, qui regroupe ceux qui entrent dans une voie de perfection active, les canonistes, les docteurs et ceux qui font profession des œuvres de miséricorde : p. 115. La controverse porte sur l’ecclésiologie. Lors de la prima mensis de janvier 1641, l faculté de théologie décide d’examiner le De hierarchia ; le projet de censure est présenté début avril : p. 116. Cellot envoie une explication au mois de juin. Richelieu le fait comparaître, avec trois jésuites, devant une commission présidée par l’évêque de Rennes, La Mothe-Houdancourt. Le livre de Cellot contient une défense des casuistes dans un chapitre du livre 8, p. 410-422 p. 116. Cellot s’attache à démontrer la nécessité de la science casuistique en s’appuyant sur l’expérience pédagogique des jésuites : p. 116. Cellot affirme en passant qu’une des raisons du développement de la casuistique est que les auteurs récents sont plus propres à analyser les problèmes moraux contemporains pour lesquels les autorités anciennes sont insuffisantes. Il mentionne Valère Regnauld qui pense qu’en cas de multiplicité des opinions, il vaut mieux se fier à des auteurs récents ; il faut suivre les auteurs modernes pour ce qui est des mœurs dignes de l’homme chrétien.
Texte de 1659 : « son livre de la Hiérarchie, p. 611. de l’impression de Rouen ».
Le De hierarchia et hierarchicis est de 1641 ; le texte exact est brutae animantes ; voir GEF V, p. 18. Le texte mérite du reste d’être cité plus complètement : « « si omnes quotquot uspiam sunt homines, si mulieres ipsae, si brutae animantes, si corpora vita et sensu carentia, in sacerdotes mutari, et augustissimam eucharistiam facere possent, diceresne divino illi Dei colendi modo infinitos illos ministros esse superfluos ? »
GRES-GAYER Jacques M., En Sorbonne, Autour des Provinciales, Mémoires de Beaubrun, Paris, Klincksieck, 1997, p. 287-288. Discussion sur le cas du P. Cellot lors des débats sur la censure.
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 115 sq. Cellot a enseigné plusieurs années l’Écriture sainte au Collège de Clermont : p. 115. Il sera par la suite recteur du collège de Rouen et provincial de 1654 à 1657. Le De hierarchia est d’abord un livre de théologie : il expose les divisions de la hiérarchie ecclésiastique. Intention polémique : il est rédigé pour répondre au Petrus Aurelius de Saint-Cyran et à François Hallier. Il fait l’apologie des jésuites anglais Knott et Floyd. Il distingue trois classes : celle de la juridiction, celle de l’ordre et celle des charismes, qui regroupe ceux qui entrent dans une voie de perfection active, les canonistes, les docteurs et ceux qui font profession des œuvres de miséricorde : p. 115. La controverse porte sur l’ecclésiologie. Lors de la prima mensis de janvier 1641, l faculté de théologie décide d’examiner le De hierarchia ; le projet de censure est présenté début avril : p. 116. Cellot envoie une explication au mois de juin. Richelieu le fait comparaître, avec trois jésuites, devant une commission présidée par l’évêque de Rennes, La Mothe-Houdancourt. Le livre de Cellot contient une défense des casuistes dans un chapitre du livre 8, p. 410-422 p. 116. Cellot s’attache à démontrer la nécessité de la science casuistique en s’appuyant sur l’expérience pédagogique des jésuites : p. 116. Cellot affirme en passant qu’une des raisons du développement de la casuistique est que les auteurs récents sont plus propres à analyser les problèmes moraux contemporains pour lesquels les autorités anciennes sont insuffisantes. Il mentionne Valère Regnauld qui pense qu’en cas de multiplicité des opinions, il vaut mieux se fier à des auteurs récents ; il faut suivre les auteurs modernes pour ce qui est des mœurs dignes de l’homme chrétien.
Censuré par l’Assemblée du Clergé le 12 avril 1641 ; mis à l’Index le 20 novembre 1641. Voir ADAM, Du mysticisme à la révolte..., p.174 ; ARNAULD, Seconde Lettre, p.53 ; GEF IV, p.279 sq. et V, p.18.
PIROT Georges, Apologie pour les casuistes, p. 131 sq. Défense de la formule du P. Cellot, qui n’est pas, selon le P. Pirot, une fantaisie bizarre : le prophète Daniel invite bien les bêtes à louer Dieu.
VI, 18. Mais en voilà assez pour les Prêtres ; je serais trop long ; venons aux Religieux. Comme leur plus grande difficulté est en l’obéissance qu’ils doivent à leurs Supérieurs, écoutez l’adoucissement qu’y apportent nos Pères. C’est Castrus Palaüs, de notre Société op. mor., p. I, disp. 2, pag. 6. Il est hors de dispute. Non est controversia, que le religieux qui a pour soi une opinion probable, n’est point tenu d’obéir à son Supérieur, quoique l’opinion du Supérieur soit la plus probable. Car alors il est permis au Religieux d’embrasser celle qui lui est la plus agréable, quœ sibi gratior fuerit, comme le dit Sanchez. Et encore que le commandement du Supérieur soit juste ; cela ne vous oblige pas de lui obéir ; Car il n’est pas juste de tous points et en toute manière ; non undequaque juste praecipit, mais seulement probablement, et ainsi vous n’êtes engagé que probablement à lui obéir, et vous en êtes probablement dégagé, probabiliter obligatus, et probabiliter deobligatus. Certes, mon Père, lui dis-je, on ne saurait trop estimer un si beau fruit de la double probabilité ! Elle est de grand usage, me dit-il, mais abrégeons.
Religieux : se dit des personnes qui sont obligées par des vœux à suivre une certaine règle autorisée par l’Église (Dictionnaire de l’académie). Il s’agit donc des ecclésiastiques soumis à une règle. Pascal restreint le sens du texte en traduisant subditus par religieux. Ce sont les sujets en général qui sont visés.
Ferdinand de Castro Palao, jésuite, 1581-1633. Né en Léon, il est admis dans la Compagnie de Jésus en 1596, après avoir professé la philosophie à Valladolid et la théologie à Compostelle et Salamanque. Il meurt recteur du collège de Médina en 1633. Il est mis en cause ici pour son Opus morale de virtutibus et vitiis, Lyon, 1631-1647. Voir le texte dans GEF V, p. 25-26. Citation exacte.
Elle est de grand usage : il ne faut pas oublier que c’est un jésuite qui parle, et qu’il a des supérieurs.
VI, 18. Je ne vous dirai plus que ce trait de notre célèbre Molina, en faveur des Religieux qui sont chassés de leurs Convents pour leurs désordres. Notre Père Escobar le rapporte en la page 705. en ces termes : Molina assure qu’un Religieux chassé de son Monastère n’est point obligé de se corriger pour y retourner, et qu’il n’est plus lié par son vœu d’obéissance.
Chassés de leurs Convents : l’édition de 1659 donne couvents. Voir CAYROU Gaston, Dictionnaire du français classique. La langue du XVIIe siècle, Livre de poche, Klincksieck, 2000, p. 200 ; la forme convent est conforme à l’étymologie, mais Ménage et le P. Bouhours signalent déjà que couvent est seul en usage vers 1670.
Texte de 1659 : tr. 6, ex. 7, n. 111. Dans l’édition primitive en la page 705 ne doit pas être abrégé en la pag. 705, comme le fait GEF V, p. 45.
VI, 19. Voilà, mon Père, lui dis-je, les Ecclésiastiques bien à leur aise. Je vois bien que vos casuistes les ont traités favorablement. Ils y ont agi comme pour eux-mêmes. J’ai bien peur que les gens des autres conditions ne soient pas si bien traités. Il fallait que chacun fût pour soi. Ils n’auraient pas mieux fait eux-mêmes, me repartit le Père ; on a agi pour tous avec une pareille charité, depuis les plus grands, jusqu’aux moindres. Et vous m’engagez pour vous le montrer à vous dire nos maximes touchant les valets.
Texte de 1659 : « jusques aux moindres ».
VI, 20. Nous avons considéré à leur égard la peine qu’ils ont, quand ils sont gens de conscience à servir des maîtres débauchés. Car s’ils ne font tous les messages où ils les emploient, ils perdent leur fortune, et s’ils leur obéissent, ils ont du scrupule. Et c’est pour les en soulager que nos 24 Pères dans la pag. 770. ont marqué les services qu’ils peuvent rendre en sûreté de conscience. En voici quelques-uns. Porter des lettres et des présents ; ouvrir les portes et les fenêtres ; aider leur maître à monter à la fenêtre, tenir l’échelle pendant qu’il y monte : tout cela est permis et indifférent. Il est vrai que pour tenir l’échelle, il faut qu’ils soient menacés plus qu’à l’ordinaire s’ils y manquaient. Car c’est faire injure au maître d’une maison d’y entrer par la fenêtre.
Texte de 1659 : « s’ils leur obéissent, ils en ont du scrupule. C’est pour les en soulager... »
La référence aux 24 Pères, dans l’édition de 1659, «est tr. 7, ex. 4, n. 223 ».
Pascal abrège un peu Escobar, p. 802. Voir GEF V, p. 21. La référence tr. 7, ex. 4, n. 223, est dans l’imprimé original réduit à la référence dans la pag. 770.
Passage cité dans NOUËT Jacques, Lettre sur la conformité..., in Réponses, p. 73 sq. Rapproché, de façon peu convaincante, d’un texte de Du Moulin.
DUCHÊNE Roger, L’imposture littéraire..., 2, p. 152 sq. Comment Pascal présente le problème. Déplacement par rapport à Arnauld : p. 152 sq. Déformation par rapport à Bauny.
C’est la situation du valet de comédie, telle qu’on la trouvera dans Les fourberies de Scapin ou Le barbier de Séville. Quant au cas du valet qui a peur de son maître, Molière l’exploitera avec le Sganarelle de Dom Juan : « un grand seigneur méchant homme est une terrible chose ; il faut que je lui sois fidèle, dépit que j’en aie : la crainte en moi fait l’office du zèle, bride mes sentiments, et me réduit bien souvent d’applaudir à ce que mon âme déteste ».
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 212 sq. Le P. Pirot sur ce passage relatif aux valets.
VI, 21. Voyez-vous combien cela est judicieux ? Je n’attendais rien moins, lui dis-je, d’un livre tiré de 24 Jésuites. Mais, ajouta le Père, notre P. Bauny a encore bien appris aux valets à rendre tous ces devoirs-là innocemment à leurs Maîtres, en faisant qu’ils portent leur intention, non pas aux péchés dont ils sont les entremetteurs, mais seulement au gain qui leur en revient. C’est ce qu’il a bien expliqué dans sa Somme des péch., en la page 710 de la première impression : Que les confesseurs, dit-il, remarquent bien qu’on ne peut absoudre les valets, qui font des messages déshonnêtes, s’ils consentent aux péchés de leurs maîtres ; mais il faut dire le contraire s’ils le font pour leur commodité temporelle. Et cela est bien facile à faire ; car pourquoi s’obstineraient-ils à consentir à des péchés dont ils n’ont que la peine ?
Je n’attendais rien moins, lui dis-je, d’un livre tiré de vingt-quatre Jésuites : effet comique dû au fait que Pascal suggère que les 24 jésuites se sont concertés pour élaborer cette décision ; on imagine un véritable état-major de casuistes (on dirait un brain trust)...
Texte de Bauny, Somme des péchés, dans GEF V, p. 16 sq. Pascal abrège beaucoup. Wendrock rétablit intégralement la fin, sicut vero id fieret propter temporalem commoditatem, est modifiée dès la 2e éd. dans l’éd. de Lyon, 1646, p. 725, le passage est remis en français et adouci. Le passage avait déjà été attaqué par Arnauld dans La fréquente communion, l. 2, ch. 36.
DUCHÊNE Roger, L’imposture littéraire..., p. 152 sq. Comment la présentation de Pascal déforme l’idée de Bauny, qui ne donne ses préceptes qu’en langue non vulgaire pour éviter qu’on n’en profite en mal : p. 153 : Bauny le dit en effet expressément : « voilà les choses que j’ai jugé devoir être insérées en ce lieu, et ce en langue non vulgaire, crainte que sues et connues du menu peuple, elles ne lui baillassent sujet de quelque liberté non louable » (Il est évident qu’un mauvais conseil en latin est moins coupable qu’un mauvais conseil en français...). Problème du cuisinier qui prépare un festin : p. 154. Problème de la servante d’une prostituée : p. 154-155.
L’éd. Le Guern, Œuvres, I, p. 1180 propose plusieurs sources, d’une part Du Trouillas, Réponse à un sermon, citée assez longuement, mais aussi ARNAULD, Lettre d’un théologien à Polémarque.
Tout ce passage pourrait aussi être commenté à l’aide du cas du Sganarelle de Dom Juan.

VI, 22. Et le même P. Bauny a encore établi cette grande maxime en faveur de ceux qui ne sont pas contents de leurs gages. C’est dans sa Somme, pag. 213. et 214. de la sixième Édition : Les valets qui se plaignent de leurs gages, peuvent-ils d’eux-mêmes les croître en se garnissant les mains d’autant de bien appartenant à leurs maîtres, comme ils s’imaginent en être nécessaire pour égaler les dits gages à leur peine ? Ils le peuvent en quelques rencontres, comme lorsqu’ils sont si pauvres en cherchant condition, qu’ils ont été obligés d’accepter l’offre qu’on leur a faite, et que les autres valets de leur sorte gagnent davantage ailleurs.
Texte cité dans la Théologie morale des jésuites, p. 15 ; voir l’éd. Le Guern, I, p. 1182.
GEF V, p. 17 sq. Bauny défend la récupération populaire des gauchistes modernes. Une série de restrictions vient en fin de passage. La seconde partie du texte est résumée.
NOUËT, Impostures XII, in Réponses, p. 146 sq., montre que la doctrine de Bauny est conforme à celle des saints Pères et “des plus célèbres casuistes” : p. 147. Il insiste sur le fait que les serviteurs dont il est question ne doivent prendre que ce qui leur est dû : p. 149. Autorités citées : le cardinal de Lugo, SJ, Navarre, Corduba, mais aussi saint Antonin : p. 149-150. Divers précédents bibliques : p. 151 sq. Nouët indique enfin les trois cas exceptés par Bauny : p. 152 sq. Discussion résumée dans l’éd. Le Guern, p. 1181.
WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 361 sq. Note II, Sentiment de Bauni touchant les domestiques qui volent leurs maîtres sous prétexte d’une compensation secrète, condamné par les Facultés de Paris et de Louvain.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 294 sq. Conditions pour qu’un domestique puisse se faire une « compensation occulte » qui leur permette de récupérer de l’argent secrètement :
1. que la dette soit certaine,
2. qu’elle soit en matière de rigoureuse justice,
3. qu’on ne puisse la récupérer par voie de justice i par aucune voie,
4. qu’il n’y ait ni scandale ni dommage pour un tiers,
5. que le débiteur ne soit pas exposé à payer deux fois.
VI, 23. Voilà justement mon Père, lui dis-je, le passage de Jean d’Alba.
Le passage de Jean d’Alba : entendre le passage qui convient à Jean d’Alba.
VI, 24. Quel Jean d’Alba, dit le Père : Que voulez-vous dire ? Quoi, mon Père, ne vous souvenez-vous plus de ce qui se passa en cette ville l’année 1647. Et où étiez-vous donc alors ? J’enseignais, dit-il, les Cas de conscience dans un de nos Collèges assez éloigné de Paris. Je vois donc bien, mon Père, que vous ne savez pas cette histoire ; il faut que je vous la die. C’était une personne d’honneur qui la contait l’autre jour en un lieu où j’étais. Il nous disait, que ce Jean d’Alba, servant de Correcteur à vos Pères du Collège de Clermont de la rue S. Jacques, et n’étant pas satisfait de ses gages, déroba quelque chose pour se récompenser. Qu’ensuite vos Pères s’en étant aperçus le firent mettre en prison, l’accusant de vol domestique ; et que le procès en fut rapporté au Châtelet le sixième d’Avril 1647. si j’ai bonne mémoire. Car il nous marqua toutes ces particularités-là sans quoi à peine l’aurait-on cru. Ce malheureux étant interrogé, avoua qu’il avait pris quelques plats d’étain à vos Pères, mais qu’il ne les avait pas volés pour cela, rapportant pour sa justification cette doctrine du P. Bauny qu’il présenta aux Juges, avec un écrit d’un de vos Pères, sous lequel il avait étudié les cas de conscience, qui lui avait appris la même chose. Sur quoi M. de Montrouge qui était l’un des plus considérés de cette Compagnie, opina, et dit : Qu’il n’était pas d’avis que sur des écrits de ces Pères contenant une doctrine illicite, pernicieuse et contraire à toutes les lois naturelles, divines et humaines, capable de renverser toutes les familles, et d’autoriser tous les vols domestiques, on dût absoudre cet accusé. Mais qu’il était d’avis que ce trop fidèle disciple fût fouetté devant la porte du Collège par la main du Bourreau, lequel en même temps brûlerait les écrits de ces Pères traitant du larcin, et défense à eux de plus enseigner une telle doctrine, sur peine de la vie.
VI, 25. 25. On attendait la suite de cet avis qui fut fort approuvé, lorsqu’il arriva un incident qui fit remettre le jugement de ce procès. Mais cependant le prisonnier disparut, on ne sait comment, sans qu’on parlât plus de cette affaire-là : de sorte que Jean d’Alba sortit, et sans rendre sa vaisselle. Voilà ce qu’il nous dit, et il ajoutait à cela que l’avis de M. de Montrouge est aux Registres du Châtelet, où chacun le peut voir. Nous prîmes plaisir à ce compte.
Texte de 1659 : « Il nous disait, que ce Jean d’Alba, servant vos Pères du Collège de Clermont de la rue Saint-Jacques ».
Le texte original donne le mot compte, alors que nous disons aujourd’hui conte. Compte : le mot ne se distingue que mal de conte dans l’orthographe du temps. Voir CAYROU Gaston, Dictionnaire du français classique. La langue du XVIIe siècle, Livre de poche, Klincksieck, 2000, p. 196. On trouve l’orthographe conte dans Wendrock, t. 2, 1699, p. 18.
Texte de 1659 : « déroba quelque chose pour se récompenser ; que vos Pères s’en étant aperçus le firent mettre en prison ».
Texte de 1659 : « le procès en fut rapporté au Châtelet le sixième jour d’avril 1647 ».
Texte de 1659 : « mais il soutint qu’il ne les avait pas volés pour cela ».
Texte de 1659 : « Sur quoi M. de Montrouge, l’un des plus considérés de cette compagnie, dit en opinant qu’il n’était pas d’avis que... »
Texte de 1659 : « avec défense à eux de plus enseigner... »
Vous avez bien mis ceux qui suivent vos opinions probables… : le texte original de la sixième Provinciale que nous suivons (recueil R 5597 de la Bibliothèque patrimoniale de Clermont) répète le mot bien, à la fin d’une ligne et au début de la suivante. La même faute se trouve dans l’exemplaire du recueil R 5452 de cette Bibliothèque. Ces deux impressions semblent être identiques, à la frise initiale près, qui est différente.
Il est intéressant de constater que la même erreur se trouve dans l’exemplaire R 1035 de la même Bibliothèque, à ceci près que les deux mots bien se trouvent sur la même ligne, sans doute par la faute d’un prote qui a suivi aveuglément le texte d’une impression précédente.
GEF V, p. 26 sq. Extraits du registre.
CLÉMENCET, Histoire de Port-Royal, Livre IX, LXXXVI, p. 445 sq. Sur ce passage.
NOUËT, Impostures XII, in Réponses, p. 147 et 154 ; cité in GEF V, p. 228-229, accuse Pascal de fausser les registres en soutenant que les juges de Jean d’Alba ont approuvé M. de Montrouge.
RAPIN René, Mémoires..., II, éd. Aubineau, p. 374-375. Rapin évite de traiter la question en mettant en cause les historiens de Port-Royal.
Les Provinciales, éd. Havet, I, p. 138-139.
FERREYROLLES Gérard, Pascal et la raison du politique, p. 80. Ce que les jésuites permettent, ils le permettent contre eux-mêmes. Preuve de l’inconsistance de la politique jésuite par l’affaire Jean d’Alba.
Voir éd. Le Guern, Œuvres, I, p. 1182, qui donne la version des registres du greffe criminel du Châtelet de Paris : “Du 8 avril 1647. A été arrêté par jugement ordinaire Alba mandé et blâmé de la faute par lui commise, défense de récidiver, et enjoint de se retirer en son pays, et les coffres, hardes étant au Greffe, rendus audit d’Alba ; et le lendemain 9 dudit mois, Messieurs étant assemblés, Alba a été mandé en la Chambre, où la sentence a été prononcée, et ledit Alba blâmé au désir d’icelle, et mis hors des prisons par le contre-huis, après lui avoir rendu son coffre et hardes.”
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, p.207 sq. Défense du P. Nouët : si un valet est traité injustement par son maître, si ses gages sont injustes, en effet il ne pèche pas en se récompensant de ses propres mains, à condition qu’il ne prenne que ce qui est dû : p. 632.
SUSINI Laurent, « L’éloquence du « vrai combat » dans les Provinciales », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 122 sq. Étude de ce passage ironique avec un passage de la Provinciale XIII (et non XIV, comme indiqué dans le texte), éd. Cognet, p. 249-250, beaucoup plus fort. Analyse technique : p. 123. Tout repose sur un procédé de double énonciation, sur l’usage d’une raillerie transparente, mise en place par un jeu sur l’implicite prépositionnel.
VI, 26. A quoi vous amusez-vous, dit le Père ? Qu’est-ce que tout cela signifie ? Je vous parle des maximes de nos Casuistes : j’étais prêt à vous parler de celles qui regardent les Gentilshommes, et vous m’interrompez par des histoires hors de propos. Je ne vous le disais qu’en passant, lui dis-je, et aussi pour vous avertir d’une chose importante sur ce sujet, que je trouve que vous avez oubliée en établissant votre doctrine de la probabilité. Et quoi, dit le Père, que pourrait-il y avoir de manque après que tant d’habiles gens y ont passé ? C’est, lui répondis-je, que vous avez bien mis ceux qui suivent vos opinions probables en assurance à l’égard de Dieu et de la conscience. Car, à ce que vous dites, on est en sûreté de ce côté-là en suivant un Docteur grave. Vous les avez encore mis en assurance du côté des Confesseurs ; car vous avez obligé les Prêtres à les absoudre sur une opinion probable, à peine de péché mortel. Mais vous ne les avez point mis en assurance du côté des Juges ; de sorte qu’ils se trouvent exposés au fouet et à la potence en suivant vos probabilités. C’est un défaut capital que cela. Vous avez raison, dit le Père, vous me faites plaisir. Mais c’est que nous n’avons pas autant de pouvoir sur les Magistrats que sur les Confesseurs, qui sont obligés de se rapporter à nous pour les cas de conscience. Car c’est nous qui en jugeons souverainement. J’entends bien, lui dis-je, mais si d’une part vous êtes les juges des Confesseurs, n’êtes-vous pas, de l’autre les Confesseurs des Juges ? Votre pouvoir est de grande étendue : obligez-les d’absoudre les criminels qui ont une opinion probable, à peine d’être exclus des Sacrements ; afin qu’il n’arrive pas au grand mépris et scandale de la probabilité, que ceux que vous rendez innocents dans la théorie, soient fouettés ou pendus dans la pratique. Sans cela, comment trouveriez-vous des disciples ? Il y faudra songer, me dit-il ; cela n’est pas à négliger. Je le proposerai à notre Père Provincial. Vous pouvez néanmoins réserver cet avis à un autre temps, sans interrompre ce que j’ai à vous dire des maximes que nous avons établies en faveur des Gentilshommes, et je ne vous les apprendrai qu’à la charge que vous ne me ferez plus d’histoires. Voilà tout ce que vous aurez pour aujourd’hui ; car il faut plus d’une Lettre pour vous mander tout ce que j’ai appris en une seule conversation. Cependant je suis, etc.
Vous pouvez néanmoins réserver cet avis à un autre temps… : le recueil 5597 donne vous pouvez ; le R 5452 en revanche, donne vous pouviez. Ces deux exemplaires sont donc de tirages différents.
Le R 1035 porte pouviez. Il est donc proche, sur ce point, du R 5452.
La leçon pouviez s’est imposée dans l’édition de 1659. Mais il paraît clair que Pascal a écrit pouvez. Cette leçon paraît indiquer qu’il comptait revenir sur ce point par la suite.
Indication chronologique : le rythme des lettres n’est pas censé refléter exactement celui des entretiens.
Les juges s’opposent souvent aux casuistes
Voir Provinciale VIII, éd. Cognet, p. 135, § 3. Remarque incidente sur un ton ironique.
Après la sixième Provinciale
OC I, éd. J. Mesnard, p. 1024, Mémoires de Beaubrun.
