P 08 : Commentaires
La rédaction de la VIIIe Provinciale
GEF V, p. 111. Historique.
Un mois s’écoule entre la VIIe et la VIIIe lettre. WENDROCK, Lettres Provinciales, tr. Joncoux, I, p. VIII insiste sur le soin que Pascal apporte à la rédaction; « Il ne composa plus ses lettres avec la même vitesse qu’auparavant, mais avec une contention d’esprit, un soin et un travail incroyables. Il était souvent vingt jours entiers sur une seule lettre. Il en recommençait même quelques-unes jusqu’à 7 ou 8 fois ».
D’après le catalogue Fouillou, Nicole aurait revu cette lettre à l’hôtel des Ursins.
SAINTE-BEUVE, Port-Royal, éd. Leroy, Pléiade, t. 2, p. 130. Sainnt-Beuve insiste sur l’alacrité dont Pascal fait preuve dans le style de cette Provinciale.
RAPIN René, Mémoires, II, p. 379 sq.; voir OC I, éd. J. Mesnard, p. 852-853. Le retard de la VIIe à la VIIIe lettre est destiné, selon le P. Rapin, à faire désirer davantage la parution.
CLÉMENCET Charles, Histoire de Port-Royal, Ie part., Liv. IX, tome III, Amsterdam, Van Duren, 1756, p. 449. « Dans la huitième lettre, M. Pascal fait parcourir à son jésuite toutes les conditions, et lui fait débiter les maximes corrompues que les casuistes enseignent; par exemple, ils permettent à un juge de recevoir des présents : Castro Palao lui permet de juge selon une opinion probable, même contre son propre sentiment. Il rapporte ensuite les différents moyens dont les casuistes se sont servis pour pallier l’usure, entre autres le contrat Mohatra, qui consiste à vendre des marchandises au prix le plus haut et à crédit, et les racheter sur le champ, argent comptant à plus bas prix. »
L’impression de la VIIIe Provinciale
Provinciales, éd. Cognet, p. 133.
OC I, éd. J. Mesnard, p. 479, Journal de Saint-Gilles, qui assure l’impression.
GEF V, p. 163-164. Quatre jésuites, après la VIIIe Provinciale, vont voir Ballard, syndic des libraires et imprimeurs de Paris, mais ils n’obtiennent pas qu’il s’oppose à la parution des Provinciales.
Sur le même événement., voir HERMANT Godfroy, Mémoires, éd. A. Gazier, t. III, Paris, Plon, 1906, p. 72.
OC I, p. 488, Journal de Taignier, 15 juin 1656, annonce la publication de la Provinciale VIII malgré les démarches des jésuites auprès de Balard, syndic des libraires. Sur la conduite de Balard, voir p. 488, vendredi 16 juin 1656. « Au milieu de ces invectives si séditieuses et si sanglantes, leur plus grand soin était d’empêcher l’impression des Lettres provinciales qui allaient fouiller jusqu’au fond des entrailles de leur société pour en faire sortir le pus et l’ordure. Ils allèrent quatre, vers ce temps-là, chez le sieur Ballard, syndic des libraires et des imprimeurs de la ville de Paris, pour lui faire des reproches de ce qu’il n’empêchait pas que ces Lettres s’imprimassent. Ils le menacèrent de le faire maltraiter par des personnes d’autorité s’il n’y donnait ordre. Ils lui dirent que c’étaient des pièces que le diable avait inventées par un horrible stratagème, pour persécuter leur compagnie. Ils usèrent même de menaces contre lui, l’assurant que leur société étant intéressée dans cette affaire au point où elle l’était, il ne manquerait pas de s’en ressentir dans toutes les occasions. »
Frises de la Provinciale VIII
La frise du recueil 1035 de Clermont
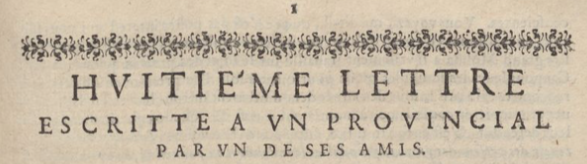
Elle est identique à celle que la BNF a mis en ligne.
Toutes deux sont aussi identiques à celle du recueil R 5597 de Clermont (ci-dessous).
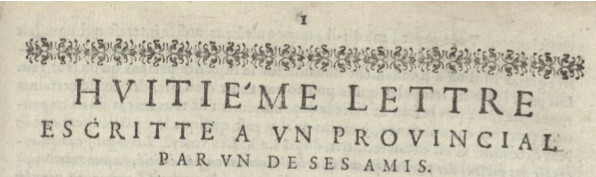
Frise du recueil R 5452 de Clermont
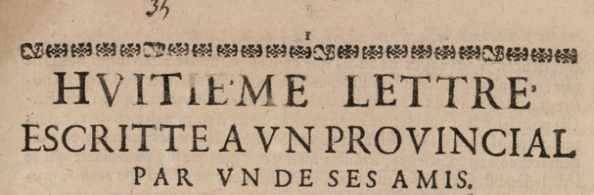
De Paris, ce 28 mai 1656
Provinciales, éd. Cognet, p. 133.
Sujet de la VIIIe Provinciale
Titre de Wendrock : Maximes corrompues des casuistes touchant les juges, les usuriers, le contrat Mohatra, les banqueroutiers, les restitutions, etc. Diverses extravagances des mêmes casuistes.
VIII, 1. Vous ne pensiez pas que personne eût la curiosité de savoir qui nous sommes : cependant il y a des gens qui essayent de le deviner : mais ils rencontrent mal.
Les recherches sur l’identité de l’auteur des Provinciales
RAPIN René, Mémoires, II, éd. Aubineau, p. 379-380. Le bruit produit par les premières Provinciales donne de la curiosité de savoir qui en est l’auteur. Comme on n’a guère vu un pareil style auparavant, « on ne pouvait faire de conjectures assez certaines pour tomber sûrement sur personne, parce qu’on n’avait encore rien vu en notre langue de ce caractère ».
Le secret est bien gardé. Voir OC I, éd. J. Mesnard, p. 470, le Journal de Saint-Gilles; p. 495. D’après le Journal de Deslyons; le 27 mars 1659, le P. Desmares, qui est pourtant lié au groupe janséniste, ignore encore qui est l’auteur des Provinciales.
Lettre de Saint-Amour à Arnauld du 31 janvier 1656, où il dit : “j’ai dit à ceux à qui j’en ai parlé qu’elle (la deuxième Provinciale) était d’un laïque”; voir GEF IV, p. 151 : qui renvoie aux Mémoires de Beaubrun, II, p. 420 : voir l’édition de ces Mémoires procurée par Jacques M. GRES-GAYER, En Sorbonne, Autour des Provinciales, Édition critique des Mémoires de Beaubrun (1655-1656), Paris, Klincksieck, 1997, p. 636. Voir SAINTE-BEUVE, Port-Royal, III, VII, éd. Leroy, Pléiade, t. 2, p. 85.
Les Provinciales, éd. Cognet, p. 133 et p. XLVIII-XLIX.
Pascal figure pourtant assez tôt parmi ceux qui sont considérés comme susceptibles d’être l’auteur des Provinciales; voir JOVY Ernest, Études pascaliennes, IX, Le Journal de M. de Saint-Gilles, p. 110. Certains les attribuent à Arnauld, “mais la plupart, et plus vraisemblablement, à M. Pascal qui est son ami, et a demeuré avec lui tous les jours passés”. Voir OC III, p. 469.
Gilberte indique dans sa vie que les soupçons ont tôt porté sur son frère. La supposition est fondée, selon elle, sur la manière d’écrire qui lui était propre. Voir dans OC I, éd. J. Mesnard, p. 583, Vie de Pascal, 1e version, § 37; « Il avait une éloquence naturelle qui lui donnait une facilité merveilleuse à dire ce qu’il voulait : mais il avait ajouté à cela des règles dont on ne s’était point encore avisé, et dont il se servait si avantageusement qu’il était maître de son style : en sorte que non seulement il disait tout ce qu’il voulait, mais il le disait en la manière qu’il voulait, et son discours faisait l’effet qu’il s’était proposé. Et cette manière d’écrire naturelle, naïve et forte en même temps, lui était si propre et si particulière qu’aussitôt qu’on vit paraître les Lettres au Provincial, on vit bien qu’elles étaient de lui, quelque soin qu’il ait toujours pris de la cacher, même à ses proches ».
Le premier à avoir positivement identifié Pascal et Montalte est le jésuite Honoré Fabri, in Notae in notas Wendrockii, Cologne, apud J. Busaum, 1659, p. 256, en 1659, c’est-à-dire plusieurs années après la fin de la polémique. Voir GEF VII, p. 78, n. 1. « His miraculis, ut fidem facias, testem adducis Dominum Paschal, tibi, ut ais, magna necessitudine conjunctum. Montaltium, vel Altimontium, vel Clamarmontium, aut Claramontanum, addere debueras. Nihil enim his tribus conjunctius. Nisi verba sacra profanare vererer, dicerem; et hi tres unum sunt ».
Pascal a été aussi visité par le jésuite de Frétat, venu lui faire savoir que les jésuites de Paris lui attribuaient les Provinciales, et qu’il devait faire attention à ne pas donner prise à de graves soupçons. Le jésuite ne s’est pas aperçu que sur le lit de la chambre où Pascal le recevait étaient en train de sécher des feuilles de la dernière Provinciale imprimée. Voir Provinciale II, Pascal dans la clandestinité.
Voir dans OC I, éd. J. Mesnard, Marguerite Périer, Additions au Nécrologe, p. 1126-1127.
POUZET Régine, Chronique des Pascal, Paris, Champion, 2001, p. 178 sq. Les activités de Florin Périer pour soutenir Pascal dans la clandestinité. L’affaire du p. de Frétat; p. 179. Les origines du p. de Frétat; p. 179, n. 182. En fait, quoi qu’en disent les Additions au nécrologe, le P. de Frétat n’est pas un proche parent; il est allié de la famille Pascal parce qu’un de ses frères, André, a épousé une cousine germaine de Blaise, Françoise Pascal. Il est allié des Périer parce qu’une de ses sœurs, Antoinette, a épousé Antoine Laville, cousin par alliance des Florin.
Recueil de plusieurs pièces pour servir à l’histoire de Port-Royal ou Suppllément aux Mémoires de Messieurs Fontaine, Lancelot et Du Fossé (Recueil d’Utrecht), Utrecht, Aux dépens de la Compagnie, 1740, p. 278 sq. Affaire du p. de Frétat. Les Jésuites croient Pascal auteur des Provinciales. Voir ce texte dans OC I, éd. J. Mesnard, p. 1022.
CLÉMENCET, Histoire de Port-Royal, Livre IX, LXXXVI, p. 447 sq. Sur le p. de Frétat.
OC I, éd. J. Mesnard, p. 1022, Mémoires de Beaubrun. Dans la marge; « Il [Pascal] logeait près du Luxembourg, à une maison qui faisait face à la porte de Saint-Michel. Il y avait une porte de derrière qui entrait dans le jardin du Luxembourg. C’était un nommé Patris, officier de ce duc, qui lui avait prêté sa maison. Il fut obligé quelques temps après d’en sortir de crainte d’être connu, et il alla loger derrière la Sorbonne, dans la rue nommée [lacune], au Roi David, avec M. Périer, son beau-frère, où les jésuites mêmes allaient quelquefois en visite, et où ils allèrent un jour lorsqu’on lui venait d’apporter des feuilles encore toutes mouillées et sortantes de l’impression, et qu’il cacha sous les couvertures de son lit ».
DUCHÊNE Roger, L’imposture littéraire dans les Provinciales de Pascal, p. 12 ; voir p. 113 sq. L’avertissement de Nicole, 1657 : p. 113.
VIII, 1. Les uns me prennent pour un docteur de Sorbonne :
GEF V, p. 111. Les soupçons portent sur Arnauld, Gomberville, Le Roy de Hautefontaine, Antoine Lemaître, Pascal.
Le docteur de Sorbonne est évidemment Arnauld. Voir GEF V, p. 111. Le soupçon pouvait se fonder sur les écrits en français qu’Arnauld avait publiés avant les Provinciales, comme la Lettre à une personne de condition et la Seconde lettre à un duc et pair. Mais l’attribution devait paraître sujette à caution, car le style d’Arnauld est très différent de celui des Provinciales. Certains polémistes comme le p. Nouët, devaient bien s’en rendre compte
RAPIN René, Mémoires, II, éd. Aubineau, p. 379. Voir SAINTE-BEUVE, Port-Royal, éd. Leroy, Pléiade, t. 2, p. 958-959 sq., les hypothèses de Rapin; OC I, p. 847. Le p. Rapin considère les trois premières Provinciales comme l’œuvre exclusive d’Arnauld. Pourtant il note paradoxalement que le “docteur” n’est pas, sur certains points, qualifié en théologie : p. 357.
Voir OC I, éd. J. Mesnard, p. 847.
MARANDÉ Léonard de, Considérations sur un libelle de Port-Royal. Sur la retraite des docteurs jansénistes. Sur la protestation de M. Arnauld. Et sur les lettres qu’il a fait courir dans Paris, depuis la censure de Sorbonne, Paris, Cramoisy, 20 mars 1656, 121 p. in-4° (BN : 4° Ld4 228). Voir Les Provinciales, éd. Cognet, p. XLVIII. Marandé accuse Arnauld d’être l’auteur des Provinciales. Voir GEF V, p. 71 sq., avec extraits du texte. L’erreur d’attribution est significative : Marandé ne répond qu’aux premières lettres de Pascal ; il n’a pas encore compris qu’avec les Provinciales, c’est un tout nouveau type de bataille qui commence.
VIII, 1. Les autres attribuent mes lettres à quatre ou cinq personnes, qui comme moi ne sont ni prêtres ni ecclésiastiques.
GEF V, p. 111. En dehors d’Arnauld et de Pascal, les soupçons ont porté sur Gomberville, Le Roy de Hautefontaine, Antoine Lemaître. Voir p. 192.
On pense à Antoine Lemaître : Provinciales, éd. Cognet, p. 133-134. Sur Antoine Lemaître, voir la notice du Dictionnaire de Port-Royal : et celle de LESAULNIER Jean, Port-Royal insolite. Édition critique du Recueil de choses diverses, Klincsieck, Paris, 1992, p. 785. Il est l’auteur de la Lettre d’un avocat au Parlement à un de ses amis touchant l’Inquisition qu’on veut établir en France à l’occasion de la nouvelle Bulle du Pape Alexandre VII, 1er juin 1657, souvent publiée avec les Provinciales, en raison de la probable coopération qu’elle a occasionnée avec Pascal. Sur l’éloquence de Lemaître durant sa carrière d’avocat, voir le chapitre qui lui est consacrée dans FUMAROLI Marc, L’Age de l’éloquence. Rhétorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Droz, Genève, 1980. On peut aussi se faire une idée de ses dons oratoires en lisant ses Plaidoyers et harangues de M. Le Maistre, donnés au public par M. Jean Issali, avocat au Parlement, 7e édition, Hortemels, 1688, mais ils sont un peu décevants par rapport à ce qu’on en dit. Pascal avait une opinion modérément favorable des dons en question; voir dans OC I, éd. J. Mesnard, p. 892; « M. Pascal s’en raillait et disait à M. Le Maistre qu’il avait pourtant bien écrit pour les bonnets du palais qui n’y entendaient rien ».
SAINTE-BEUVE, Port-Royal, éd. Leroy, Pléiade, t. 2, p. 85 sq. et 129, sur Le Roy de Hautefontaine. Le Roy de Haute-Fontaine a été aussi soupçonné; voir la notice du Dictionnaire de Port-Royal, et LESAULNIER Jean, Port-Royal insolite, p. 786. Voir aussi SAINTE-BEUVE, Port-Royal, éd. Pléiade, II, p. 86 et 129. Voir dans OC I, éd. J. Mesnard, p. 1023, le passage des Mémoires de Beaubrun qui conte la réaction de Le Roy, abbé de Hautefontaine, lorsqu’on lui a appris qu’on lui attribuait les Provinciales.
RAPIN René, Mémoires, X, éd. Aubineau, II, p. 356. Voir SAINTE-BEUVE, Port-Royal, éd. Leroy, Pléiade, t. 2, p. 958-959 sq., les hypothèses de Rapin ; OC I, p. 847.
GEF V, p. 111. Les soupçons ont aussi porté sur Gomberville. Voir RAPIN René, Mémoires, II, éd. Aubineau, p. 379-380. Voir OC I, p. 853 : on soupçonne Gomberville, “parce qu’il s’était signalé par ses romans et qu’il écrivait bien”. Comme on n’a guère vu un pareil style auparavant, “on ne pouvait faire de conjectures assez certaines pour tomber sûrement sur personne, parce qu’on n’avait encore rien vu en notre langue de ce caractère”. Gomberville s’est défendu d’être l’auteur des Provinciales dans une lettre au P. Ducastillon : voir RAPIN, Mémoires, II, éd. Aubineau, p. 379. Voir Provinciale III, la Réponse aux premières lettres.
Dictionnaire de Port-Royal, p. 461 sq. Gomberville est soupçonné d’avoir fait la VIIIe Provinciale. Arrestation et interrogatoire. Gomberville écrit une lettre au p. Castillon pour notifier son innocence.
Voir SAINTE-BEUVE, Port-Royal, éd. Leroy, Pléiade, t. 2, p. 958-959 sq.
VIII, 1. Tous ces faux soupçons me font connaître que je n’ai pas mal réussi dans le dessein que j’ai eu de n’être connu que de vous, et du bon père qui souffre toujours mes visites, et dont je souffre toujours les discours quoique avec bien de la peine. Mais je suis obligé à me contraindre : car il ne les continuerait pas s’il s’apercevait que j’en fusse si choqué; et ainsi je ne pourrais m’acquitter de la parole que je vous ai donnée de vous faire savoir leur morale. Je vous assure que vous devez compter pour quelque chose la violence que je me fais. Il est bien pénible de voir renverser toute la morale chrétienne par des égarements si étranges, sans oser y contredire ouvertement. Mais après avoir tant enduré pour votre satisfaction, je pense qu’à la fin j’éclaterai pour la mienne, quand il n’aura plus rien à me dire. Cependant je me retiendrai autant qu’il me sera possible; car plus je me tais, plus il me dit de choses.
Ce paragraphe donne toutefois une idée de ce que Pascal entend par l’effacement du moi dans le discours. Il annonce aussi la fin de la Xe Provinciale, où l’épistolier déclare nettement son indignation au bon père jésuite. Pascal a donc dès cette époque l’idée directrice de la progression dramatique des lettres VIII à X.
Souffre; admet, supporte.
CANTILLON Alain, « Énonciation individuelle et énonciation collective (I) – la position auctoriale dans les Provinciales », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 165-176. Voir p. 170 sq., sur ce passage.
VIII, 1. Il m’en apprit tant la dernière fois, que j’aurai bien de la peine à tout dire. Vous verrez que la bourse y a été aussi malmenée, que la vie le fut l’autre fois. Car de quelque manière qu’il pallie ses maximes, celles que j’ai à vous dire ne vont en effet qu’à favoriser les juges corrompus, les usuriers, les banqueroutiers, les larrons, les femmes perdues et les sorciers qui sont tous dispensés assez largement de restituer ce qu’ils gagnent chacun dans leur métier. C’est ce que le bon père m’apprit par ce discours.
Texte de 1659 : « Il m’en apprit tant la dernière fois, que j’aurai bien de la peine à tout dire. Vous verrez des principes bien commodes pour ne point restituer. »
Restitution
Sur la restitution, et les causes pour lesquelles l’obligation qu’on avait de restituer cesse, voir le casuiste BAUNY Étienne, Somme des péchés, ch. XI, p. 224 sq. L’extrême nécessité, pour soi ou pour les siens, excuse de rendre ce qu’on a d’autrui : p. 224. Ce n’est pas péché de prendre en ce temps-là ce qui nous fait besoin pour y subvenir. Mais “telle nécessité toutefois n’étant plus, on serait tenu de rendre ce qui aurait servi durant icelle, s’il est encore en être...”, mais “non toutefois ce qui aurait été consommé pour se retirer de ladite nécessité”. L’opinion contraire est toutefois plus probable : personne n’est obligé à secourir quelqu’un gratis : suffit qu’en effet il le fasse. Donc quand l’autre l’a pris, même à son insu, “il l’a fait tacitement avec cette obligation”, c’est-à-dire avec l’obligation de rendre. D’autre part, la privation ne prive pas le possesseur de son bien, mais me donne seulement l’avantage de l’en servir, pour me tirer hors de peine; mais à condition de ne pas nuire, donc de rendre sa véritable valeur : p. 224-225. C’est encore plus vrai quand la nécessité n’est pas tout à fait si pressante : p. 225. Les pauvres ne pèchent pas, pour se soulager, en prenant à autrui, car « ils s’usurpent le leur, prennent ce qui est à eux, conséquemment ne sont tenus à restitution » : p. 226 sq. Car des gens des champs qui glanent du bois ne sont pas coupables de péché mortel ni tenus de rendre : p. 226-227. On peut ne pas restituer promptement quand cela entraîne un notable préjudice au débiteur : p. 227. On est quitte de restitution quand le créditeur met volontairement la chose restituable au débiteur. De même quand il n’a pas de quoi le faire sans diminution de son état, comme l’entretien de sa famille pour un juge, pour un gentilhomme « de n’avoir le moyen de paraître en public selon son état, n’avoir point de chevaux, point d’armes, point d’habits, ni de valets sortables à sa condition ». « Etre en danger de perdre sa renommée, ou de bailler en restituant l’occasion de croire qu’on aurait autrefois péché, c’est une juste cause d’en délayer la restitution : car l’axiome porte qu’il n’y a point d’obligation de restituer. Bonum inferioris ordine, cum detrimento superioris in suo genere aeque gravis” : p. 230. Le confesseur se contentera donc que le pénitent lui promette de faire ce qu’il pourra pour s’acquitter de son devoir, et ce aussitôt que les moyens le lui permettront. Cas des officiers publics enrichis par le vol d’autrui, mais tenus pour gens d’honneur et de vertu, ou gentilshommes embarrassés dans leurs affaires : « je crois que l’on pourrait ne les point précipiter en leur devoir, mais bien se contenter de la promesse, qu’ils feraient en la confession, de s’acquitter, envers leurs créanciers, quand Dieu et la fortune leur en auront fourni les moyens » : p. 232. Cinquième cause qui rend quitte, la cession des biens : p. 232 sq. La cession n’empêche pas l’obligation, mais seulement son effet : p. 235. « Ce qui n’empêche toutefois pas que le débiteur en conscience ne se les puisse garder, au cas qu’elles lui fussent nécessaires pour l’entretien modéré de sa famille et conservation de l’état qu’il s’est acquis justement, ou bien se les soustraire à même fin, avant ladite cession ». Cas où les femmes sont contraintes d’abandonner leurs biens aux créanciers, à cause du mauvais ménage de leurs maris : p. 236. Dernière cause : l’ignorance du droit ou du fait : p. 240. Sauf ignorance crasse.
PONTAS Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 475 sq. Restitution.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 274 sq., sur le point particulier de la restitution : il est utile de lire entièrement le chapitre consacré à la VIIIe Provinciale, qui résume le contexte de ces problèmes économiques et financiers.
VIII, 2. Dès le commencement de nos entretiens, me dit-il, je me suis engagé à vous expliquer les maximes de nos auteurs pour toutes sortes de conditions. Vous avez déjà vu celles qui touchent les bénéficiers, les prêtres, les religieux, les valets et les gentilshommes : parcourons maintenant les autres, et commençons par les juges.
Texte de 1659; « celles qui touchent les bénéficiers, les prêtres, les religieux, les domestiques et les gentilshommes ».
Juges
Ce passage fait contrepoint à VI, 26, où il était question des juges qui ne se laissent pas corrompre par les opinions probables...
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Etude d’un dialogue polémique, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol. Pascal insiste sur l’opposition entre les casuistes corrompus qui acceptent la probabilité et les juges probes qui la refusent. Tournure politico-juridique de la controverse. Accusation de mauvaise foi contre Pascal. L’argumentation du p. Nouët sur la question des malversations financières que les jésuites cautionnent; il répond que la loi naturelle n’interdit pas aux juges de recevoir des présents, mais c’est pour affirmer plus fortement que la défense émane des lois civiles; p. 552.
PONTAS Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 1237 sq. Juge.
VIII, 3. Je vous dirai d’abord une des plus importantes et des plus avantageuses maximes que nos pères aient enseignées en leur faveur. Elle est de notre savant Castro Palao, l’un de nos 24. vieillards. Voici ses mots. Un juge peut-il dans une question de droit juger selon une opinion probable, en quittant l’opinion la plus probable? Oui, et même contre son propre sentiment : imo contra propriam opinionem.
Castro Palao; voir VI, 18.
GEF V, p. 127. Texte de Castro Palao cité par Escobar. « Potestne judex in sententiis ferendis opinionem probabilem relicta probabiliori sequi ? Castro Palaus posse docet, imo contra propriam opinionem, dummodo probabilitas sit circa jus, non vero circa factum : nam circa factum tenentur probabiliorem sequi. » La citation d’Escobar est abrégée à la fin, où Escobar note que cette opinion n’est pas admissible dans les questions de fait.
RAPIN René, Mémoires, II, éd. Aubineau, p. 380.
VIII, 3. Et c’est ce que notre père Escobar rapporte aussi au tr. 6. ex. 6. nu. 45.
Provinciales, éd. Cognet, p. 135 indique que Pascal n’a pas connu directement le texte de Castro Palao.
VIII, 3. O mon père, lui dis-je, voilà un beau commencement, les juges vous sont bien obligés : et je trouve bien étrange qu’ils s’opposent à vos probabilités, comme nous l’avons remarqué quelquefois, puisqu’elles leur sont si favorables. Car vous leur donnez par là le même pouvoir sur la fortune des hommes, que vous vous êtes donné sur les consciences.
Texte de 1659 : « Car vous donnez par là le même pouvoir sur la fortune des hommes que vous vous êtes donné sur les consciences. »
Voir Provinciale VI, 26. La remarque que les juges s’opposent aux probabilités est à la fois en faveur des juges (Pascal connaît bien les magistrats), et en défaveur des opinions probables.
VIII, 3. Vous voyez, me dit-il, que ce n’est pas notre intérêt qui nous fait agir, nous n’avons eu égard qu’au repos de leurs consciences
Noter que c’est précisément ce que Pascal reproche aux casuistes; mettre les consciences en repos de façon abusive, c’est-à-dire dans un faux repos. Pour le jésuite, repos de conscience signifie absence de scrupules, comme le montrent les lignes suivantes. Pour Pascal, le mot repos a un sens tout différent. Voir le fragment Laf. 599, Sel. 496 qui résume le problème : « Mais est-il probable que la probabilité assure ? Différence entre repos et sûreté de conscience. Rien ne donne l’assurance que la vérité ; rien ne donne le repos que la recherche sincère de la vérité. »
VIII, 3. Et c’est à quoi notre grand Molina a si utilement travaillé sur le sujet des présents qu’on leur fait. Car pour lever les scrupules qu’ils pourraient avoir d’en prendre en de certaines rencontres, il a pris le soin de faire le dénombrement de tous les cas où ils en peuvent recevoir en conscience, à moins qu’il y eût quelque loi particulière qui le leur défendît.
Rencontre : occasion.
VIII, 3. C’est en son to. I. tr. 2. disp. 88. n. 6. Les voici : Les juges peuvent recevoir des présents des parties, quand ils les leur donnent ou par amitié, ou par reconnaissance de la justice qu’ils ont rendue, ou pour les porter à la rendre à l’avenir, ou pour les obliger à prendre un soin particulier de leur affaire, ou pour les engager à les expédier promptement.
La référence renvoie au De justitia et jure de Molina, T. I, Tr. II, disp. 88, Quae contra leges a ministris publicis accipiuntur, quousque et cui in conscientiae foro sint restituenda, col. 357 sq., qui est cité dans GEF V, p. 133. Voir Provinciales, éd. Cognet, p. 136. La citation est résumée, mais exacte pour le sens. « Quando ea, quae ministri publici contra legis praescriptum accipiunt, ea liberalitate ac libertate eis dantur, quae intra limites donationis sit satis ad transferendum dominium, ut quia ex amicitia perinde cuique illorum dantur ac si non esset minister publicus, vel quia ex gratitudine beneficii accepti dum bene est usus suo munere, et ex gaudio rei justae obtentae illi dantur, vel etiam ut in posterum talem se gerat, qualem se gessit, diligenterque expediat negotium ejus, qui munus mittit, vel denique antequam negotium expediat, munus ad eum mittatur, ut afficiatur ad diligenter atque in favorem ejus, qui munus mittit negotium intra justitiae limites expediendum; in his, inquam, et in aliis similibus eventibus dicenda sunt nonnulla... Secundum est, licet donationes, de quibus loquimur, seclusa lege positiva, quae eas prohibeat, saepe fiant et accipiantur cum peccato... interdum tamen posse fieri et accipi sine ullo peccato, ut quando ex amicitia datur aliquid ministro publico, etiamsi amicitia habuerit ortum ex eo quod sit minister publicus, aut quando ex gratitudine et gaudio rei juste obtentae aliquid ex mera liberalitate illi datur; in ejusmodi namque donationibus nihil vitii ex
Wendrock donne une version plus longue, faite de lambeaux empruntés au texte original.
VIII, 3. Notre savant Escobar en parle encore au tr. 6. ex. 6. n. 43. en cette sorte. S’il y a plusieurs personnes qui n’aient pas plus de droit d’être expédiées l’un que l’autre, le juge qui prendra quelque chose de l’un, à condition, ex pacto, de l’expédier le premier, péchera-t-il ? Non, certainement, selon Layman; Car il ne fait aucune injure aux autres selon le droit naturel, lorsqu’il accorde à l’un, par la considération de son présent, ce qu’il pouvait accorder à celui qu’il lui eût plu; Et même, étant également obligé envers tous par l’égalité de leur droit, il le devient davantage envers celui qui lui fait ce don, qui l’engage à le préférer aux autres : et cette préférence semble pouvoir être estimée pour de l’argent : quae obligatio videtur pretio aestimabilis.
Texte de 1659; « S’il y a plusieurs personnes qui n’aient pas plus de droit d’être expédiées l’une que l’autre... »
GEF V, p. 126 sq., qui donne n. 43 et non 48 (comme dans éd. L’Intégrale), ce qui est exact : voir ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tr. VI, Ex. VI, cap. VI, n. 43, p. 713. « Plures litigantes litis expeditionem exspectant, Petrus munus offert judici ex pacto brevioris expeditionis; rogo, an delinquat judex, si quando litigantes aequali jure temporis gandent, Petri causam ante alios expediat ? Laymannus non peccare asserit : quia spectato naturali jure aliis nbon irrogat injuriam. In gratiam vero Petri remunerationis suscipit novam obligationem excipiendi causam ipsius ante alios, quae obligatio videtur praetio aestimabilis. Igitur quod ex naturali jure cuilibet litigantium poterat exhibere, Petro muneris gratia voluit exhibere. Addo ex Molina judicem secluso scandalo, et periculo injustitiae posse accipere, nec teneri restituere, id quod a litigantibus accipit, si datum sit instar muneris liberalis, ut majorem solito diligentiam in causa adhibeat ». Citation exacte mais légèrement abrégée et où deux phrases ont été interverties. La référence à Molina n’est pas donnée. Wendrock rétablit le texte intégral.
Cela s’appelle un passe-droit.
La question se discute, car la décision est équivoque. Le raisonnement est valable si réellement le juge est maître du choix de l’ordre dans lequel il fait passer les plaideurs, c’est-à-dire si vraiment cela répond à son bon plaisir. Admettons que le juge décide de travailler un dimanche, il est libre de choisir de traiter l’affaire qui lui plaira. En revanche, cela cesse d’être vrai si le droit des plaideurs est effectivement égal, et que le juge n’a pas à faire dépendre de son bon plaisir l’ordre de passage.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 351 sq. Longue note sur cette maxime, mais en s’appuyant sur Molina, et non sur Escobar ni sur Layman.
VIII, 4. Mon révérend père, lui dis-je : je suis surpris de cette permission, que les premiers magistrats du royaume ne savent pas encore. Car Monsieur le premier président a apporté un ordre dans le parlement pour empêcher que certains greffiers ne prissent de l’argent pour cette sorte de préférence ; ce qui témoigne qu’il est bien éloigné de croire que cela soit permis à des juges, et tout le monde a loué une réformation si utile à toutes les parties.
Pomponne II de Bellièvre, 1606-1657. Sur Bellièvre et les Provinciales, voir SAINTE-BEUVE, Port-Royal, III, VII, t. 2, éd. Leroy, Pléiade, p. 81. Voir Provinciales, éd. Cognet, p. 136, note biographique. Il mourut en mars 1657.
VIII, 4. Le bon père surpris de ce discours, me répondit : Dites-vous vrai ? Je ne savais rien de cela. Notre opinion n’est que probable. Le contraire est probable aussi. En vérité, mon père, lui dis-je, on trouve que M. le premier président a plus que probablement bien fait, et qu’il a arrêté par là le cours d’une corruption publique, et soufferte durant trop longtemps. J’en juge de la même sorte, dit le père : mais passons cela, laissons cela. Vous avez raison, lui dis-je : aussi bien ne reconnaissent-ils pas assez ce que vous faites pour eux. Ce n’est pas cela, dit le père : mais c’est qu’il y a tant de choses à dire sur tous, qu’il faut être court sur chacun.
Texte de 1659; « mais passons cela, laissons les juges. »
Il y a tant de choses à dire sur tous, qu’il faut être court sur chacun; formule toute dorée qui devrait être la maxima sententia de tout agrégatif.
VIII, 5. Parlons maintenant des gens d’affaires.
BLUCHE François (dir.), Dictionnaire du grand siècle, p. 46, art. Gens d’affaires. Au XVIIe siècle, il ne s’agit pas de gestionnaires au travail dans une économie privée concurrentielle. Les affaires en question sont celles du Roi, affaires d’économie mixte, tenant au service public par leur finalité, et tenant à un secteur libre en fonction du profit escompté. Selon Furetière, « gens d’affaires sont les financiers, les traitants et les partisans, qui prennent les fermes du roi, ou le soin du recouvrement des impositions qu’il fait sur les peuples, ou qui ont droit de vendre certaines charges dont ils ont traité avec le roi, moyennant certaines sommes qu’ils se sont chargés de lui payer ». C’est, comme partisan, un « faux ami ».
VIII, 5. Vous savez que la plus grande peine qu’on ait avec eux, est de les détourner de l’usure :
Usure
Usure; c’est un faux ami. Voir Provinciales, éd. Cognet, p. 137. Par usure, il faut entendre le simple prêt à intérêt, même à un taux modéré. En majorité, les moralistes catholiques le condamnent, mais il s’introduit progressivement sous la contrainte des nécessités commerciales et économiques. Voir BLUCHE François (dir.), Dictionnaire du grand siècle, p. 766, art. Prêt à intérêt.
PONTAS Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 129-130. Anatocisme. Espèce d’usure qui consiste à faire payer des intérêts. Les anciens canonistes défendaient un tel contrat comme funeste aux familles.
PONTAS Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 153-154. Antichrèse. C’est une convention par laquelle le débiteur consent que son créancier jouisse d’un héritage qu’il lui hypothèque pour et au lieu de l’intérêt de l’argent qu’il lui prête jusqu’à ce qu’il en soit payé. Autrefois ce contrat était prohibé en France, à l’exception des pays de droit écrit.
Pascal a écrit un petit ouvrage perdu sur l’usure : voir OC I, éd. J. Mesnard, extrait du Recueil de choses diverses, f°110 r°-v°, p. 892 et 256. Le recueil de choses diverses indique que « on a brûlé un petit traité de l’usure de M. Pascal où il semble la permettre en de certaines rencontres. M. Dirois était de son avis ». Il est possible que cette concession faite par Pascal sur l’interdiction soit inspirée par ses réflexions sur les partis et le calcul des chances (voir l’Usage du Triangle arithmétique pour faire les partis et la correspondance de Pascal avec Fermat). Voir sur ce point l’article d’Ernest COUMET, « La théorie du hasard est-elle née par hasard ? », in Œuvres d’Ernest Coumet, éd. T. Martin et S. Roux, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2016, p. 185-213.
Voir la note de LESAULNIER Jean, Port-Royal insolite, Paris, Klincksieck, 1992, p. 348.
THOMASSIN Louis, Traité du négoce et de l’usure, Roulland, Paris, 1697, in-4°.
PIROT Georges, Apologie pour les Casuistes, p. 207.
DANIEL Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 336-337.
QUERAS, Lettre à Périer, in PASCAL, Œuvres complètes, éd. Mesnard, II, p. 904 sq.
SAUMAISE, Lettre à Descartes du 22 nov. 1639, DESCARTES, Œuvres, A.T. X, p.557.
HIRSCHMAN Albert O., Les passions et les intérêts. Justifications politiques du capitalisme avant son apogée, Paris, P. U. F., 1977.
CARIOU Pierre, Pascal et la casuistique, PUF, Paris, 1993, p. 125 sq.
LE GUERN Michel, “Sur la bataille des Provinciales”, p. 293. Mentionne le Ms. BN n. a. fr. 1525, onzième pièce du recueil, f° 161-171.
NOONAN John, The scolastic analysis of usury, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1957.
Deutéronome, XXIII, 19-20, tr. Lemaistre de Sacy, p. 322-324. Explication. Permission de l’usure aux Juifs, mais envers les étrangers et non entre eux. Pour les chrétiens, il y a une usure sainte : “pour un peu d’or et un peu d’argent qu’il donne à son frère, il acquiert et devant Dieu, et devant les hommes, le mérite d’une douceur, d’une bonté et d’une générosité vraiment chrétienne. C’est là l’usure permise aux enfants de Dieu, qui se procurent des biens éternels par le commerce passager d’un bien périssable, et qui en donnant un peu de terre, se rendent dignes du ciel; d’après Clément d’Alexandrie, Strom., lib. 2, p. 397. Selon saint Jean Chrysostome, « l’usure qui est criminelle ruine le débiteur et perd devant Dieu le créancier ».
LE GOFF Jacques, Un autre Moyen Age, p. 1265 sq. L’usure à la période médiévale.
TAVENEAUX René, Jansénisme et politique, p. 164. Dans le prêt, selon LE GROS Nicolas, Lettres théologiques contre le traité des prêts de commerce et en général contre toute usure, 1739-1740, p. 94, il faut distinguer le bienfait du prêt, « par où il est différent d’une vente ou d’un échange, où chacun des contractants cherche son avantage, l’autre est la convention qui le distingue du pur don, convention qui appartient à la justice, et par où l’emprunteur s’engage à rendre ce qu’il doit, pour ne pas faire de tort au prêteur. Mais toutes deux répugnent à l’usure, et si je l’exige, je fais un prêt monstrueux. Par rapport au bienfait, le prêt est par sa nature un contrat qui est pour l’utilité de l’emprunteur, et non du prêteur. C’est celui qui emprunte qui a ou qui croit avoir besoin (…). Et si on prête à usure, il est encore plus clair que l’emprunteur cherche son intérêt. Sans cela s’engagerait-il, outre la restitution du fonds, à payer l’usure qui est le prix de l’usage qu’il espère de faire de ce qu’on lui prête ? (...) De mon côté quand je prête, ce n’est pas un dépôt que je confie, afin qu’on le garde pour me faire plaisir. C’est un prêt qui tend à obliger l’emprunteur et à lui procurer quelque avantage par l’usage qu’il fera de ce que je lui mets en main ».
Dictionnaire de théologie catholique, article Usure. Dans l’antiquité biblique, le prêt est un service que l’on rend à ses voisins, et qui doit être gratuit : col. 2316. Ne pas exiger d’intérêt : col. 2317. Le prêt à intérêt est permis vis à vis des gens des autres nations : col. 2317. Moyen Age : nummus non parit nummos : col. 2319. Doctrine évangélique : col. 2323. Les Pères de l’Église; dénonciation par Clément d’Alexandrie et d’autres des pratiques du prêt à intérêt : col. 2324. L’usure résultat d’une union contre nature qui fait naître des produits de choses qui sont stériles; col. 2325. Celui qui prête augmente l’indigence de son emprunteur au lieu de la diminuer : col. 2325. Danger social de l’usure. Saint Jean Chrysostome dénonce ses dangers pour le salut éternel : col. 2326. Les Pères latins : col. 2327. Interdiction de l’usure aux clercs au IVe siècle : col. 2329. Interdiction de l’usure aux laïques : col. 2331. La prohibition de l’usure s’étend à tous les chrétiens par le Concile de Clichy en 626; col. 2332. Rapport avec la fermeture de la Méditerranée par les Arabes, qui crée un monde commercial fermé où le prêt à intérêt n’a pas de raison d’être. Haut Moyen Age, interdiction de l’usure aux laïques par Charlemagne : col. 2333. A la fin de l’âge carolingien, l’Église a en main les armes nécessaires pour lutter contre l’usure : col. 2335. La doctrine de l’usure du XIIe au XVe siècles : col. 2336. Fondement de l’interdiction de l’usure sur la glose des Écritures : col. 2336. Pierre Lombard : col. 2339. Transformations économiques : col. 2339. Elles ouvrent à tous (et non seulement aux usuriers professionnels) de vastes perspectives de spéculation et de gain. Naissance du crédit public; col. 2340. Fréquence des prêts à des taux très lourds (40 % parfois) : col. 2340. Rénovation intellectuelle : col. 2341. Le droit canon légifère sur l’usure à partir de l’avènement d’Alexandre III, 1159 : col. 2342. Théologiens : col. 2343. Théorie générale : col. 2347. Il y a usure simple si l’on rend 110 après avoir emprunté 100; il y a usura usurarum si la base est 110 : col. 2347. Objet de l’usure : peu importent la nature du supplément, argent, blé, huile, et sa quotité, toute superabundantia est usuraire. Usure mentale : col. 2348. La condamnation de l’usure s’appuie sur l’autorité sacrée, la morale naturelle, l’ordre social et les droits positifs : col. 2349. Comment l’argent, qui est non frugifère, peut-il engendrer un gain ?, col. 2350. Nature du péché : col. 2351. Dans la catégorie des délits contre les biens, l’usure est fille de l’avarice. Gravité, aggravée par la continuité : col. 2351-2352. La fortune de l’usurier, résultant du crime, ne peut être convertie en bonnes œuvres : col. 2353. Difficultés de cette doctrine : problème de l’universalité de la loi : col. 2354. Extension du domaine de l’usure avec mort-gage, vente à crédit, vente simulée, prêt maritime, vente simulée, Mohatra, change) : col. 2356 sq. La doctrine à partir du XVIe siècle : col. 2372. Accord sur le principe de la stérilité de l’argent. Nouvelles formes de contrats et d’associations : col. 2373. Triple contrat, rentes rachetables, etc. Le damnum emergens est depuis longtemps reconnu valable et justifie la stipulation d’un bénéfice compensatoire : col. 2347. Contre le lucrum cessans, manque à gagner, les préventions tombent peu à peu. Mais sur le periculum sortis, les résistances sont plus fermes, mais il a été admis tout de même : col. 2374-2375. Théorie de Calvin : il nie le principe de stérilité de l’argent ; l’intérêt du prêt n’est interdit en morale que s’il excède un tarif modéré ou s’il est exigé des pauvres : col. 2375. Au Pays-Bas : cas des rentes rachetables : col. 2375. Casuistes et jansénistes : col. 2376. En France se pose le problème des prêts de commerce : col. 2376. La doctrine catholique a refusé d’entrer dans la perspective du prêt comme service rendu à l’emprunteur ; la justification doit être établie du côté du prêteur, qui doit montrer qu’il subit une gêne en prêtant pour justifier l’intérêt : col. 2377.
Idée qu’il est de la nature du prêt d’être gratuit : GROTIUS Hugo, dans le De Veritate religionis christianae, envisage l’usure considérée comme une procédure judaïque. DOMAT Jean, Les lois civiles, I, p. 241, Note a. On appelle usure tout ce que le créancier qui a prêté de l’argent ou des denrées peut recevoir de plus que la valeur de ce qu’il a prêté. L’usure est naturellement illicite ; c’est un crime : p. 243. Les seuls fondements de l’usure sont la cupidité du prêteur et l’indigence de l’emprunteur. Ordonnance pour le châtiment de l’usure : p. 251. TAVENEAUX, Jansénisme et politique, p. 164. Le Gros sur l’usure : p. 165 sq. Contre l’expérience de Law : p. 168 sq. Soanen contre Law : p. 169 sq. Petitpied contre les rentes rachetables des deux côtés : p. 175 sq.
FRANKLIN James, The science of conjecture. Evidence and probability before Pascal, Baltimore and London, The John Hopkins Press, 2001, p. 262 sq. Olivi sur l’usure et les profits à venir. L’usure est entendue comme une prise d’intérêt sur de l’argent ; c’est une manière de gagner de l’argent sans rien faire, et de profiter du travail que fait un autre : p. 263. Mais on ne voit pas d’inconvénient à une association dans laquelle l’un met de l’argent dans un voyage qu’un autre entreprendra, en vue de partager les bénéfices. Les juristes condamnent une association où l’investisseur ne prend aucun risque et n’assume pas le risque de la perte dans l’aventure. Le risque, selon Thomas d’Aquin, est une part importante de ce qui rend une association licite. Un traité sur l’usure d’un associé de Pierre le Chantre semble reconnaître une proportion entre le risque et le profit permis : p. 264. La bulle Naviganti de 1234 est très sévère à l’encontre de celui qui prête de l’argent à un navigateur en vue de gagner de l’argent parce qu’il a pris sur lui le risque, qui est considéré comme un usurier ; mais elle va contre la tendance générale, à tel point qu’on a suggéré qu’il manquait un ne pas dans la formule doit être considéré comme un usurier. L’analyse de l’usure culmine dans le livre de Pierre Jean Olivi sur la vente, l’achat, l’usure et la restitution, vers 1280-1290 : p. 265.
DOMAT Jean, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, Titre VI, Du prêt et de l’usure, I, Seconde édition, Paris, Coignard, 1700, p. 239 sq. Définition du prêt : p. 261, § I. La chose prêtée est aliénée : celui qui emprunte en devient le propriétaire, car autrement il n’aurait pas le droit de la consumer : p. 261, § II. Définition du créancier et du débiteur : p. 261 sq., § III. Celui qui prête doit être le maître de la chose, pour en rendre maître celui qui emprunte : p. 265, § I. Engagement de l’emprunteur : rendre la même somme, ou la même quantité qu’il a empruntée, et au terme convenu : p. 267, § I. Fondements du commerce par le prêt :
1. on ne peut user de l’argent, des grains, des liqueurs, qu’en cessant de les avoir;
2. on peut aisément dans ce domaine trouver des choses qui aient entièrement la même valeur : p. 240.
L’obligation du prêt ne peut excéder la chose prêtée : le créancier peut stipuler moins qu’il n’a prêté, mais non davantage : p. 263, § VII ; p. 266, § IV.
Définition de l’usure : p. 242. La loi divine condamne l’intérêt du prêt : p. 243. Problème de savoir si comme il est naturel que celui qui donne son cheval ait le choix de dire qu’il le prête ou qu’il le loue, il en va de même de l’argent, du blé, du vin, en disant qu’on le prête à intérêt ou sans intérêt : p. 244-245. Ce qui rend certains engagements commerciaux permis, c’est que le bailleur stipule justement un prix pour le droit qu’il donne de jouir du service rendu par ce qu’il prête (cheval ou autre) : p. 245. Mais louage et prêt diffèrent : dans le prêt l’emprunteur reste obligé, qu’il use ou non de la chose empruntée ; d’autre part, alors que dans le louage, le preneur n’est obligé de rendre que la même chose qu’il a louée, et s’il la perd, il n’y est pas tenu, dans le prêt il faut rendre de toute façon : p. 246. Dans le prêt, contrairement au louage, le prêt ne souffre aucune diminution, et le prêteur aucune perte : p. 246. Dans le louage, le preneur use de ce qui est à un autre, qui en demeure le maître ; mais dans le prêt, celui qui emprunte devient le maître de ce qui lui est prêté, car s’il ne l’était pas, il n’en saurait user; s’il s’en sert, c’est comme sien, et le prêteur n’y a pas droit : p. 246-247. Dans le prêt à intérêt, celui qui prête ne répond d’aucun profit à celui qui emprunte, et ne laisse pas de s’assurer un profit certain : p. 247. Il prend un profit sûr, d’une chose qui n’est pas à lui, qui par nature ne produit pas de fruit, mais peut seulement être mise en usage par l’industrie de l’emprunteur, quand l’autre ne peut avoir que de la perte : p. 247. Les usuriers soutiennent qu’ils font plaisir, et se privent du gain qu’ils pourraient tirer de leur argent ; c’est vrai, mais c’est le caractère naturel du prêt; “il serait bien étrange que par un contrat dont l’usage essentiel est de faire un bienfait, on pût mettre en commerce ce bienfait même” : p. 248. Cela contredirait la loi de bienfaisance qui est le fondement des lois. “Le prêt n’est pas inventé pour le profit de ceux qui prêtent, mais pour l’usage de ceux qui empruntent” : p. 250. Le seul titre de l’usure est la cupidité de celui qui prête et l’indigence de celui qui emprunte, combinaison qui a donné lieu au commerce des usuriers : p. 251. L’usure est un piège tendu par l’usurier “pour faire sa proie de ceux qui y tombent”, voir Psaumes, 9, 30. Sur la fainéantise où l’usure entraîne l’usurier : p. 252. Facilité d’un “profit sans industrie, sans risque et sans peine”. Esclavage où l’usurier réduit le débiteur, réduit à payer toujours inutilement : p. 252. Les Prophètes contre l’usure : p. 252-253. Usure défendue à Rome dans les premiers siècles de la république : p. 253. Défense de l’usure chez les Juifs entre eux ; mais permission envers les étrangers : p. 254. La loi ancienne était donnée à un peuple grossier ; ce n’est pas une raison pour l’appliquer aujourd’hui : p. 256. Objection que l’usure n’est pas défendue par l’Évangile : p. 257. Réponse. La licence de l’usure dans le droit romain ne peut contrebalancer la loi divine, d’autant plus que c’est un relâchement injuste de la sévérité initiale : p. 258. L’intérêt est légitime dans le cas où celui qui a emprunté ne payant pas au terme, le créancier demande son paiement en justice, avec les intérêts pour le retardement : p. 259; voir p. 267, § III.. Les contrats de rentes sont aussi exceptés : p. 260.
WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 433 sq. Références des canons contre l’usure depuis le premier concile de Carthage (348) : p. 435.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Etude d’un dialogue polémique, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol. La question du prêt à intérêt. Racine polémique sur le prêt à intérêt : p. 443. Le pragmatisme jésuite : p. 451. Les choix de Pascal : p. 455 sq.
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 300 sq. Le P. Emmanuel Maignan sur la théorie de l’usure. Il considère l’argent non pas seulement comme instrument d’échange, mais comme bien productif. Le créditeur loue la productivité de son capital à son bailleur.
Le P. Bauny sur l’usure
BAUNY, Somme des péchés, ch. XIV, sur l’usure, p. 309 sq. Définition de l’usure : “quand en vertu du prêt, l’on reçoit plus que l’on a baillé, non en argent tant seulement, mais en toute autre chose qui l’équipolle, et le vaut”. Quand la somme qu’on reçoit sur le sort principal est notable, quand l’excès est considérable en quantité, l’usure est infailliblement mortelle, “car c’est contre justice d’exiger du légitime possesseur quelque chose, afin qu’il ait l’usage libre de ce qui est à lui (...). Or par le prêt se fait un si parfait transport de la chose prêtée en celui qui la reçoit, qu’il en devient le maître (...); c’est donc lui faire tort que de l’astreindre à quelque chose, distincte et différente dudit fort” : p. 309-310.
Première cause permettant de recevoir plus qu’on n’a prêté : p. 310 sq. Le dam émargeant, damnum emergens, un dommage évident qui résulte du prêt, comme si pour secourir un homme on devait recourir à un prêt, avec obligation de payer l’intérêt : p. 310-311. La raison, c’est “qu’il n’y a loi qui oblige personne d’assister son prochain, avec quelque dommage notable de soi” : p. 311. De même si l’emprunteur rendant avec retard, le prêteur pâtit de quelque incommodité.
Ce serait tromper l’emprunteur de lui imposer des intérêts sans le prévenir : p. 312-313. Exception pour les marchands, qui s’obligent tacitement à tous les intérêts : p. 313.
Autre cause de permission : le lucrum cessans, lorsque “à raison du prêt, le créditeur ne peut point employer ses deniers en quelque honnête trafic, duquel il eût reçu quelque sorte de gain”, dans la mesure où il est légitime de préférer l’avancement de ses propres affaires à celles du prochain : p. 312.
Autre cause : ratione periculi : p. 315. A cause du danger de la personne qui risque de perdre son argent en le remettant aux mains d’un inconnu qui dissipe et mange tout.
“Il n’est point toutefois défendu au créancier de recevoir tout ce que le débiteur ou mutuataire lui offre en reconnaissance de la grâce qu’il a reçue de lui, quand il l’a secouru d’argent, l’écrivent P. de Navar. Li. 3. de restitutione. C. 2. Lopez. 2. part. de son instruc. Chap. 55. qu. I. car pour avoir bien fait, il ne doit, ni peut être injustement privé de son pouvoir, que tous ont, d’accepter les bonnes volontés des autres envers eux. Jusques-là qu’il s’en trouve qui avancent, qu’il est licite autant que de prêter, d’accorder, et pactiser avec son débiteur, ou mutuataire, qu’il reconnaîtra le bienfait de quelque gratification (...) pour ce qu’il semble n’y avoir point de mal à pactiser tout ce qu’il est permis d’espérer, de donner, d’accepter. Or n’y a-t-il eu la nature, en la grâce, ni en l’écriture, aucune loi, qui nous empêche de reconnaître le bienfait, ou d’agréer, qu’on le fasse à notre utilité : le pacte donc qu’on en ferait n’est prohibé”. “Non plus, que de recevoir parole de celui qui emprunte, qu’en cas qu’il ne satisfasse au créancier” en lui rendant à temps prévu, « il augmentera de certaine somme d’argent le capital (...), car toutes fautes, notamment celles qui tournent à dommage d’un tiers, peuvent être punies (...) ». Condition : il faut que le débiteur ait de quoi satisfaire le créancier, car « l’impuissance les excusant de péché, elle les exempte aussi de la peine y adjointe » : p. 319. Il faut un rapport entre la peine et la coulpe : p. 319. Il faut que les coupables soient « semonds et requis » : p. 320. Autres causes selon les juristes (feuda, fideiussor, pro dotte, stipendia cleri, venditio, etc.). Mais cela se confond avec les précédents : p. 323.
« Les confesseurs, ou autres, pour déterminer ce qu’on peut prendre, auront égard aux personnes, à la somme qu’on prête, et au danger : car plus icelui danger sera grand, plus la somme notable ; les personnes moins solvables, plus sujettes à fausser leur foi, violer leur promesse, tromper le monde, et plus pourra-t-on exiger d’elles. Resterait à présent de parler des usures palliées (...) » : p. 325.
Les peines canoniques et civiles : p. 326. La restitution : “cette peine est raisonnable, car l’usurier n’acquiert pas le domaine du plus, qu’il exige avec injustice par-dessus le principal”, selon saint Thomas. Car toute acquisition nouvelle doit être fondée sur juste titre, “la seule tradition, n’étant de soi bastante, à faire le transport irrévocable d’une chose, des mains et du pouvoir d’une personne, en celui de quelque autre (...)” : p. 327. Le prêt doit être gratuit. Puisque seul le capital est dû, tout surcroît doit être rendu au propriétaire et non aux pauvres “qui en ceci ne sont considérables qu’au défaut de celui qui a été lésé, ou de ses héritiers”.
Si les usuriers mêmes sont pauvres, quid juris? : p. 328. “S’ils sont banqueroutiers, s’ils ont fait faillite par leurs mauvais ménages, suffit qu’ils soient marris de leurs péchés passés, car qui n’a rien cogi non potest ad solutionem, dit Grégoire IX”, à moins qu’ils ne deviennent de nouveau riches.
Seconde peine des usuriers : être tenus pour infâmes ; p. 329. Ils ne peuvent devenir ecclésiastiques.
Troisième peine des usuriers : ne pouvoir être reçus aux sacrements de pénitence et de communion : p. 330.
Quatrième peine des usuriers : être privés de sépulture ecclésiastique.
En France, la prescription, le consentement ni le paiement ne peuvent empêcher l’usure (jugement du 5 décembre 1602) : p. 331.
“L’on n’obligerait donc pas peu le monde, si le garantissant de ces mauvais effets, et tout ensemble du péché qui en est causé, l’on lui donnait le moyen de tirer autant, et à l’aventure plus de profit de son argent, par quelque bon et légitime emploi que l’on ne fait des usures. C’est cela même avec quoi nous mettons fin à ce chapitre, la forme avec laquelle l’estime, que tous le peuvent faire sans péché...” : p. 331-332 : “que l’on ne donne son argent qu’à ceux qui ont un fonds” dont ils tirent une rente; que ceux qui donnent, requis par ceux qui prennent, de leur prêter leur argent, fassent trois contrats, “l’un de compagnie, l’autre d’assurance du principal, et du profit qu’on s’en promet, et le troisième, d’achat d’un gain certain, pour un incertain et indéterminé”; suivent des citations de casuistes qui approuvent cette méthode (Valentia, Bonacina, Molina). Molina, De justit. Tr. 3. disp. 417 : on peut, traduit Bauny, “donner son argent pour être employé à quelque trafic honnête et juste pour en tirer profit, et puis transiger à certain prix avec celui qui le reçoit, ou autre, qu’ils l’assureront de sondit principal, sans qu’il en courre risque, auquel contrat on peut en ajouter un autre, qui est d’achat d’un gain certain, à prix non certain, et déterminé” : p. 332-333. “Celui qui a donc besoin d’argent, venant à expliquer le désir qu’il a d’en recouvrer en telle ou telle quantité, le créancier futur lui pourra répondre, je n’ai point d’argent à prêter, si bien à mettre à profit honnête, et licite, si vous désirez la somme que demandez, pour la faire valoir par votre industrie, à moitié perte, moitié gain peut-être m’y résoudrai-je : bien est vrai qu’à cause qu’il y a trop de peine à s’accorder pour le profit, si vous m’en voulez assurer un certain, et quant et quant aussi mon fort principal, qu’il ne courre fortune, nous tomberons bientôt d’accord, et vous ferai toucher argent dès cette heure” : p. 333-334.
“Il ne faudra prendre le gain convenu entre les parties contractantes au commencement dudit contrat : car lors il n’est pas encore dû, ainsi au bout de l’an, ou demi-an, ou de quartier en quartier, ne fût que le créancier craignit probablement, qu’il ne pût recouvrer ce qui lui serait dû, que l’on appelle communément intérêt, au bout de l’an sans procès, ou que celui qui se constitue son débiteur, ne le lui baillât par après franchement, de bonne volonté, et sans en être importuné.”
Le mot prêt s’entend de tout contrat qui peut se faire selon Dieu, et conscience : p. 335.
Toute la somme dite au contrat doit être donnée réellement, “si que le créancier n’en retienne rien”, sauf exception dites au n°3.
Il ne faut pas que ce qu’on demande soit excessif. Se contenter du prix fixé par le roi : au denier 12 pour les marchands, au denier 18 pour les autres, sauf accroissement ou diminution, dont l’appréciation est laissée aux Sages.
Il est bon que le créancier dise au débiteur que son intention n’est pas usuraire : par cela il se déclare porté au bien : p. 335-336.
Bauny donne ensuite la forme du contrat : p. 336 sq. Une dernière clause, que les intérêts courront après le terme jusqu’au paiement, se met expressément pour éviter les commandements, qu’il serait besoin de faire, à cause que la Justice n’adjuge les intérêts que du jour des sommations, et commandements : p. 337. Comment sauver des procédures que Dieu condamne : p. 338. Procédés des casuistes : p. 332 sq.
“Voilà à mon avis, le moyen par lequel dans le monde, quantité de personnes qui par leurs usures, extorsions, et contrats illicites, se provoquent la juste indignation de Dieu, se peuvent sauver, si, au lieu de prêter le leur, ils le baillent en la façon dessus dite, qui n’est de mon invention, mais de quantité de grands hommes”, dont il cite les paroles : p. 338. Voir par exemple p. 341, Diana. Et p. 342 : “notre opinion n’est donc pas si nouvelle, ni si peu vraisemblable, qu’on la crie, puisqu’elle est défendue par tant de Personnages, dont le moindre est capables de lui donner créance, et nous tirer de blâme, d’autoriser ce, dont tous ces auteurs nous ont baillé l’exemple, et que la Cour confirme par ses arrêts”. Bauny cite un jugement de 1593 à Tours : p. 343.
Diverses questions qui se posent : p. 345 sq. Par exemple, p. 346, si l’emprunteur peut faite trafic de l’argent qu’on lui prête. Quel est le prix à donner à ceux qui se chargent des périls ?, p; 347. Peut-on blâmer ceux qui se servent de ces contrats?, p. 348 sq. Réponses : la coutume les excuse; il n’est pas raisonnable de croire le contrat injuste; “l’action est sans faute, quand elle a pour appui l’autorité d’un homme aussi pieux que docte, qui nous assure que Dieu et le prochain n’y sont point offensés, car un homme de mérite, et de considération pour sa doctrine rend ce qu’il dit probable, selon Vasquez (...), Salas (...), Filliucci (...), Sanchez (...), et leurs raison est que l’opinion est lors probable cum nititur fundamento non levi, quand elle a pour fondement quelque chose à quoi raisonnablement on acquiesce et peut-on prudemment ne faire aucun état de ce qu’un homme sage dit donc à agir probablement, il n’y a point de faute. Or la coutume écrit Navarr. (...) ne justifie pas moins l’action, que l’autorité d’un seul homme” : p. 350-351.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 356 sq.
VIII, 5. Et c’est aussi à quoi nos pères ont pris un soin particulier : car ils détestent si fort ce vice, qu’Escobar dit au tr. 3. ex. 5. n. 1. que de dire que l’usure n’est pas péché, ce serait une hérésie.
GEF V, p. 140 et p. 125 pour le texte, Liber theologiae moralis, Tract. III, Examen V, Cap. I, p. 387 : « Porro haeresis esset dicere usuram non esse peccatum ».
VIII, 5. Et notre père Bauny, dans sa Somme des péchés, ch. 14. remplit plusieurs pages des peines dues aux usuriers. Il les déclare infâmes durant leur vie, et indignes de sépulture après leur mort. O mon père, je ne le croyais pas si sévère ! Il l’est quand il le faut, me dit-il :
GEF V, p. 140 et p. 120 sq. Pour les “titres” successifs, voir p. 120. Voir plus haut, la note sur le p. Bauny sur l’usure.
VIII, 5. Mais aussi ce savant casuiste ayant remarqué qu’on n’est attiré à l’usure que par le désir du gain, il dit au même lieu. L’on n’obligerait donc pas peu le monde, si le garantissant des mauvais effets de l’usure, et tout ensemble du péché qui en est la cause, l’on lui donnait le moyen de tirer autant et plus de profit de son argent par quelque bon et légitime emploi, que l’on n’en tire des usures.
BAUNY, Somme des péchés, Ch. XIV, p. 331 sq. « L’on n’obligerait donc pas peu le monde si le garantissant de ces mauvais effets, et tout ensemble du péché qui en est cause, l’on lui donnait le moyen de tirer autant, et à l’aventure plus de profit de son argent, par quelque bon et légitime emploi, que l’on ne fait des usures. C’est cela même avec quoi nous mettrons fin à ce chapitre, la forme avec laquelle l’on estime que tous le peuvent faire sans péché, en clorra le discours et pour être telle, il faut qu’elle ait les conditions qui s’ensuivent. » Texte cité dans GEF V, p. 120 sq.
VIII, 5. Sans doute, mon Père, il n’y aurait plus d’usuriers après cela. Et c’est pourquoi, dit-il, il en a fourni une méthode générale pour toutes sortes de personnes : gentils-hommes, présidents, conseillers, etc. et si facile, qu’elle ne consiste qu’en l’usage de certaines paroles qu’il faut prononcer en prêtant son argent ; ensuite desquelles on peut en prendre du profit, sans craindre qu’il soit usuraire, comme il est sans doute qu’il l’aurait été autrement. Et quels sont donc ces termes mystérieux, mon père ? Les voici, me dit-il, et en mots propres :
Méthode générale : Cognet remarque que l’expression n’est pas de Bauny ; en revanche, elle est bien dans le style de Pascal. Dans les Lettres de A. Dettonville sur la cycloïde, Pascal parle d’une méthode universelle qui « sert également à trouver les centres de gravité des plans, des solides, des surfaces courbes, etc. », OC IV, p. 413.
REGUIG-NAYA Delphine, Le corps des idées : pensées et poétiques du langage dans l’augustinisme du second Port-Royal, p. 126 sq. Usage magique de la parole chez les casuistes.
VIII, 5. Car vous savez qu’il a fait son livre de la Somme des péchés en français, pour être entendu de tout le monde, comme il le dit dans la préface. Celui à qui on demande de l’argent répondra donc en cette sorte : Je n’ai point d’argent à prêter : si ai bien à mettre à profit honnête et licite. Si désirez la somme que demandez pour la faire valoir par votre industrie à moitié gain, moitié perte, peut-être m’y résoudrai-je. Bien est vrai qu’à cause qu’il y a trop de peine à s’accommoder pour le profit, si vous m’en voulez assurer un certain, et quant et quant aussi mon sort principal, qu’il ne coure fortune, nous tomberions bien plus tôt d’accord : et vous ferai toucher argent dans cette heure.
Noter le caractère parodique que revêt le passage de Bauny tel qu’il est cité par Pascal.
Préface changée après la première édition.
BAUNY, Somme des péchés, Ch. XIV, p. 334. « Celui qui a donc besoin d’argent, venant à expliquer le désir qu’il a d’en recouvrer, en telle ou telle quantité. Le créancier futur, lui pourra répondre, je n’ai point d’argent à prêter, si bien à mettre à profit honnête, et licite, si vous désirez la somme que demandez, pour la faire valoir par votre industrie, à moitié perte, moitié gain, peut-être m’y résoudrai-je; bien est vrai, qu’à cause qu’il y a trop de peine à s’accorder pour le profit, si vous m’en voulez assurer un certain, et quant et quant aussi mon sort principal, qu’il ne courre fortune, nous tomberons bientôt d’accord, et vous ferai toucher argent dès cette heure ». Bauny poursuit : « Ainsi l’accord fait de paroles, entre les parties, le contrat se passera selon la forme ci-dessous ». Suivent des clauses juridiques ; « il ne faudra prendre le gain convenu entre les parties contractantes au commencement dudit contrat : car lors il n’est pas encore dû, ainsi au bout de l’an, ou demain, ou de quartier en quartier... », p. 334 : « le mot de prêt, duquel communément se servent ceux qui donnent leur argent au marchand pour en profiter ne se doit restreindre à ce contrat spécifique qui en porte le nom, mais s’étendre à tout autre, qui se peut faire selon Dieu, et sa conscience », p. 335; « toute la somme mentionnée audit contrat se doit délivrer réellement, et de fait, si que le créancier n’en retienne rien; p. 335 : « il ne faut pas que ce qu’on demande soit excessif, communément il se faudra tenir dans l’ordonnance, et se contenter du prix que le roi permet par icelle, qui est au denier 12 pour les marchands, et au denier 18 pour les autres, ne fût que pour certaines considérations, dont le jugement est réservé aux sages, il fallût l’accroître, ou le diminuer », p. 335 : « pour plus grande assurance, il est bon que le créancier dise à celui qui se constitue débiteur, que son intention en ce contrat n’est vulgaire, bien en l’obligeant de ses deniers, de les faire profiter, avec protestation de sa part de ne vouloir rien faite contre Dieu et sa conscience, car par cela il se déclare porté au bien, éloigné du péché, dans les dispositions de ne contracter point, si sciret titulum hujus contractus non esse justum, bien ne rechercher les moyens d’employer bien son argent et d’en tirer gain qui soit licite... », p. 335-336. Le libellé du contrat est fourni p. 336-337. Voir GEF V, p. 141 et p. 120 pour le texte.
CARIOU Pierre, Pascal et la casuistique, p. 126 sq. Sur ce passage.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 356 sq. Doctrine des trois contrats ou des prêts de négoce, qui n’a pas été condamnée par l’Église.
VIII, 5. N’est-ce pas là un moyen bien aisé de gagner de l’argent sans pécher ? Et le p. Bauny n’a-t-il pas raison de dire ces paroles, par lesquelles il conclut cette méthode. Voilà à mon avis, le moyen par lequel quantité de personnes dans le monde, qui, par leurs usures, extorsions, et contrats illicites, se provoquent la juste indignation de Dieu, se peuvent sauver en faisant de beaux, honnêtes et licites profits.
GEF V, p. 121. La cinquième édition de Bauny et les suivantes, p. 338, donnent un texte un différent ; « Voilà à mon avis, le moyen par lequel dans le monde, quantité de personnes, qui par leurs usures, extorsions, et contrats illicites, se provoquent la juste indignation de Dieu, se peuvent sauver, si au lieu de prêter le leur, ils le baillent en la façon dessus dite, qui n’est de mon invention, mais de quantité de grands hommes, dont je juge à propos d’insérer ici les paroles, pour parer aux reproches de ceux à qui cette opinion pourrait sembler improbable et nouvelle ». L’éd. Cognet, p. 139, note que le texte modifié est augmenté de pièces justificatives.
CARIOU Pierre, Pascal et la casuistique, p. 126 sq. Sur ce passage.
VIII, 6. O mon père, lui dis-je, voilà des paroles bien puissantes ! Je vous proteste que si je ne savais qu’elles viennent de bonne part, je les prendrais pour quelques-uns de ces mots enchantés qui ont le pouvoir de rompe un charme. Sans doute elles ont quelque vertu occulte pour chasser l’usure, que je n’entends pas :
Dans l’édition de 1659, la phrase Je vous proteste que si je ne savais qu’elles viennent de bonne part, je les prendrais pour quelques-uns de ces mots enchantés qui ont le pouvoir de rompe un charme A été supprimée.
Les vertus occultes sont les qualités cachées par lesquelles les scolastiques expliquaient certains phénomènes physiques, comme les sympathies et les antipathies entre les corps, censées rendre compte de la chute des corps, de la résistance de la nature à produire le vide, etc. Sur les vertus occultes, voir SHIOKAWA Tetsuya, Pascal et les miracles, Paris, Nizet, p. 1977, p. 16 sq. Voir aussi ARNAULD Antoine et NICOLE Pierre, La logique, III, XVIII (éd. de 1664), III, Prendre pour cause ce qui n’est point cause, éd. D. Descotes, Paris, Champion, 2014, p. 429 sq. ; MERSENNE, Questions théologiques, physiques…, Fayard, éd . Pessel, Question XXII, Quelles sont les vertus occultes, et la sympathie, et l’antipathie, et d’où elles viennent, p. 299. On invoque par l’exemple une qualité occulte attractive pour expliquer les effets de l’aimant. Les esprits forts invoquaient aussi ce genre de qualités occultes pour expliquer certains phénomènes extraordinaires ou apparemment miraculeux. Pascal s’est moqué de ce genre d’imaginations dans ses écrits de physique : on en trouve un écho dans le fragment Laf. 907, Sel. 421 des Pensées : “Vertu apéritive d’une clé, attractive d’un croc.” Dans le cas présent, il s’agit naturellement d’une allusion ironique à des paroles magiques.
Voir sur les vertus occultes l’étude de LENOBLE Robert, Mersenne ou la naissance du mécanisme, Paris, Vrin, 2e éd., 1971, p. 83 sq.
VIII, 6. Car j’ai toujours pensé que ce péché consistait à retirer plus d’argent qu’on n’en a prêté. Vous l’entendez bien peu, me dit-il; L’usure ne consiste presque selon nos pères qu’en l’intention de prendre ce profit comme usuraire.
VIII, 6. Et c’est pourquoi notre père Escobar fait éviter l’usure par un simple détour d’intention. C’est au tr. 3. ex. 5. n. 4. 33. 44. Ce serait usure, dit-il, de prendre du profit de ceux à qui on prête, si on l’exigeait comme dû par justice : mais, si on l’exige comme dû par reconnaissance, ce n’est point usure.
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tract. III, Ex. V, cap. IV, n. 33, p. 393. « Est ne usura aliquid sperare ex mutuo, non ex justitia, sed ex amicitia, aut gratitudine ? Dixi non esse usuram, nisi expectetur aliquid ex mutuo vi mutui, et cum civili obligatione. Unde sperare per mutuum, amicitiam, vel aliquod donum ex gratitudine mutuatarii, non est usura mentalis; nec tale donum ex tali obligatione exigere, est usura realis quia actus internus et externus sunt ejusdem bonitatis, aut malitiae. Molina tom. 2. d. 305. n. 6. » Citation abrégée, mais le sens est exact.
VIII, 6. Et n. 3. Il n’est pas permis d’avoir l’intention de profiter de l’argent prêté immédiatement, mais de le prétendre par l’entremise de la bienveillance, mediâ benevolentiâ, ce n’est point usure.
Texte de 1659 : « mais de le prétendre par l’entremise de la bienveillance de celui à qui on l’a prêté, mediâ benevolentiâ, ce n’est point usure. »
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tract. III, Ex. V, cap. I, n. 3, p. 338. « Intenditur (ut de usura mentali ordiamur) lucrum ex mutuo tanquam debitum ex justitia; est ne usura ? Ita plane : at si tanquam ex benevolentia, seu gratitudine, nequaquam. Porro ex mutuo immediate lucrum intendere non licet nec principaliter, nec minus principaliter; at vero lucrum intentum media benevolentia, non est usura. » Citation exacte ; Wendrock cite intégralement et dans l’ordre les trois textes.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 357 sq. Note en faveur d’Escobar.
VIII, 7. Voilà de subtiles méthodes : mais une des meilleurs à mon sens, car nous en avons à choisir, c’est celle du contrat Mohatra. Le contrat Mohatra, mon père ! Je vois bien, dit-il, que vous ne savez ce que c’est. Il n’y a que le nom d’étrange. Escobar vous l’expliquera au tr. 3. ex. 3. n. 36. Le contrat Mohatra est celui par lequel on achète des étoffes chèrement et à crédit, pour les revendre au même instant à la même personne argent comptant et à bon marché. Voilà ce que c’est que le contrat Mohatra, par où vous voyez qu’on reçoit une certaine somme comptant, en demeurant obligé pour davantage.
Contrat usuraire : voir FRANKLIN James, The science of conjecture, p. 258 sq.
Contrat Mohatra
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tract. III, Ex. V, cap. III, n. 36, p. 367 sq. Texte cité dans GEF V, p. 124-125. « Rogo, an contractus ille vulgariter Mohatra, quando quis egens pecunia, emit pecunia credita a mercatore merces pretio summo, et statim ei pecunia numerata pretio infimo revendit : licitus sit ? Notat Rebellus p. 2. lib. 9 : q. 7. num. 7 in legibus Castellae gravissimis poenis prohiberi. Attamen justus est, hisce servatis; nullum pactum explicitum nec implicitum adhibendum. Pretium, quo venduntur merces, non sit majus summo : nec cum revenduntur, non sit minus infimo, quia tunc justum pretium tam in venditore, quam in revenditore servatur. At Molina tom. 2. d. 310. requirit ulterius, quod merces non vendantur ex intentione, infimo pretio reemendi. Porro Salas tract. De empt. Et vend. Dub. 37. n. 4. id non obstare asseruit : quia ubi nihil ultra sortem in pactum deducitur, nec speratur in pretium, aut debitum de justitia, pro mutuo, nulla est usura, etiam si auctarium principaliter intendatur. »
GEF V, p. 124 sq. La traduction est correcte, mais l’ordre des conditions est inversé. La falsification alléguée par Nouët est un pur à-côté du texte; c’est une formule qui suit le texte de Pascal dans Escobar : “At Molina tom. 2. d. 310. requirit ulterius, quod merces non vendantur ex intentione, infimo pretio reemendi. Porro Salas tract. de empt. et vend. dub. 37. n. 4 id non obstare asseruit”. Le texte d’Escobar se poursuit par une explication de cette opinion que Nouët n’indique pas : GEF V, p. 125.
Provinciales, éd. Cognet, p. 139. Sur l’origine du terme Mohatra ou Moatra. Il semble apparaître chez les casuistes dans la deuxième moitié du XVIe siècle; Wendrock note qu’on parle aussi du contrat Barata. Le contrat Mohatra a été condamné par Innocent XI, voir Denzinger, 1190.
WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 430 sq.; Litterae Provinciales, p. 199; voir p. 180 : contractum quemdam Mohatra vel Barata dictum...
Dictionnaire de théologie catholique, article Usure, col. 2358, Mohatra. Au XIVe siècle apparaît en Italie la pratique de la vente à terme avec revente immédiate pour un prix moindre : la différence constitue l’usure. C’est le contractus mohatrae, d’origine arabe, que l’on appelle aussi serocco, barocco, retrangolo, ciavanza, rompicollo. Voir E. BUSSI, “Contractus Mohatrae” Rivista dei storia del diritto italiano, t. V, 1932, p. 492-519. Ce contrat donne lieu à critique, mais la condamnation pontificale est tardive.
NOUËT Jacques, Impostures VII, in Réponses, p. 177 sq. En s’attaquant à Escobar, Pascal s’en prend aussi à Navarre et bien d’autres. Présentation des citations : p. 120 sq.
PIROT Georges, Apologie..., p. 117 sq. (éd. de 1657), et p. 207 sq. (contrefaçon). « C’est ce contrat dont parle le 202e article de l’ordonnance de Blois, quand elle défend de vendre des marchandises à perte de finances, et dont la nature se connaît mieux par les cas particuliers que par les spéculations générales ». Explication du contrat sur un exemple particulier : “un marchand par exemple vend du drap vingt-cinq francs l’aune à crédit et terme d’un an. Le même qui achète prie le marchand de reprendre sa marchandise à vingt francs l’aune argent comptant, en sorte toutefois que la première vente et le premier contrat subsiste, par lequel celui qui a acheté cette étoffe est obligé de payer le prix convenu, le terme d’un an étant expiré.” Les théologiens « demandent si ce contrat est usuraire, ou injuste. Et quelques-uns répondent que si la bonne foi s’y rencontre, et que le marchand qui a vendu au plus haut prix sa marchandise en la rachète qu’au plus bas, qui soit dans la justice et dans l’équité, il n’y a point de mal en ce contrat, d’autant que dans la vente de toute marchandise, il y a trois prix, le haut, le médiocre et le bas : et que dans toute cette étendue de prix, on peut acheter ou vendre une même marchandise, sans injustice. Ces théologiens disent de plus que le marchand donnant son étoffe à crédit, pour le terme d’un an, peut prendre l’intérêt du prix qu’il eût dû recevoir argent comptant, propter lucrum cessans et damnum emergens. Je crois que cette opinion est très probable, si toutes ces circonstances se trouvaient dans ce contrat : mais parce que souvent il peut servir de couverture à l’usure et d’occasion de débauche aux enfants de famille, qui par cet achat d’étoffes trouveront de l’argent pour fournir à leurs folles dépenses, les Ordonnances ont grande raison de le défendre : et je crois que le marchand pèche pour l’ordinaire quand il se sert de ce contrat, parce que ceux à qui il baille cet argent l’emploient en de mauvais usages. De toute cette réponse le secrétaire apprendra qu’il y a beaucoup de différence entre donner des inventions pour pallier l’usure, et entre suggérer des moyens de faire de légitimes contrats : car la palliation se rencontre quand on feint quelque contrat légitime, pour en couvrir l’usure : mais jamais il n’y a de palliation d’usure quand on fait un vrai contrat de vente » ; p. 207-208.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 359 sq. Note sur le contrat Mohatra.
CARIOU Pierre, Pascal et la casuistique, p. 128 sq.
RAPIN René, Mémoires, II, éd. Aubineau, p. 381.
MAYNARD Ulysse, éd des Provinciales I, p. 36.
FRANKLIN James, The science of conjecture, p. 285 sq.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Etude d’un dialogue polémique, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 266.
VIII, 7. Mais, mon père, je crois qu’il n’y a jamais eu qu’Escobar qui se soit servi de ce mot-là; y a-t-il d’autres livres qui en parlent ? Que vous savez peu les choses, me dit le Père. Le dernier livre de théologie morale, qui a été imprimé cette année même à Paris, parle du Mohatra, et doctement. Il est intitulé Epilogus Summarum. C’est un abrégé de toutes les Sommes de Théologie, pris de nos Pères Suarez, Sanchez, Lessius, Fagundez, Hurtado, et d’autres casuistes célèbres, comme le titre le dit. Vous y verrez donc en la page 54. Le Mohatra est quand un homme qui a affaire de vingt pistoles, achète d’un marchand des étoffes pour trente pistoles, payables dans un an, et les lui revend à l’heure même pour vingt pistoles comptant. Vous voyez bien par là que le Mohatra n’est pas un mot inouï.
Texte de Soria-Butron; « Mohatra. Est quando, qui habet necessitatem, verbi gratia, viginti de nariorum accomodatorum ei, et non invenit simile pretium, tunc petit a mercatore mercem, ut triginta solvendam intra annum, et statim illam vendit ipso mercatori pro pretio, ut viginti ».
Voir p. 777 du même ouvrage : De moatra. Vide definitione, I, p. fol. 54. Qui vendit moatram fideijussionem faciendo, non peccat, licet sit in pretio rigoroso : secus si pretium justum excedit. Idem de emptore. Ministet, (proxeneta) ad hoc deputatus, nihil ex venditis potest sibi appropriare, nisi de licentia, etc. tacita vel expressa : sed si utilitate carent, possunt pro labore aliquid accipere. Possunt de licentia Domini pactum facere, ut reddant, etc.
GEF p. 134 et 143, indique que selon l’abbé Maynard, Provinciales, t. 1, p. 361, il s’agit d’un livre composé par Soria-Butron, franciscain, et compilé en grande partie dans le franciscain Villalobos : quelques décisions de Suarez et d’autres jésuites y ont été jointes.
Provinciales, éd. Cognet, p. 140. Ouvrage de Jean Soria-Butron, Concha, 1650. Pascal fait allusion à l’édition de Paris, 1656, qui, selon Cognet, n’est pas connue par ailleurs. C’est pourtant celle dont je me sers.
Inouï : au sens propre, dont on n’a jamais entendu parler.
VIII, 7. Et bien, mon Père, ce contrat-là est-il permis ? Escobar, répondit le père, dit au même lieu, qu’il y a des lois qui le défendent sous des peines très rigoureuses. Il est donc inutile, mon Père ?
Provinciales, éd. Cognet, p. 140. Escobar précise qu’il s’agit des lois de Castille (voir le passage plus haut).
GEF V, p. 144. Wendrock ne met pas en italique.
VIII, 7. Point du tout, dit-il; car Escobar en ce même endroit donne des expédients de le rendre permis, encore même, dit-il, que celui qui vend et rachète ait pour intention principale le dessein de profiter, pourvu seulement qu’en vendant il n’excède pas le plus haut prix des étoffes de cette sorte, et qu’en rachetant, il n’en passe pas le moindre : et qu’on n’en convienne pas auparavant en termes exprès ni autrement.
Texte de 1659 : « des expédients pour le rendre permis ».
Texte de 1659 : « celui qui vend et achète ».
Voir le passage plus haut.
Des expédients pour le rendre permis : l’impression originale donne des expédients de le rendre permis.
VIII, 7. Mais Lessius, de just. l. 2. c. 21. d. 16. dit qu’encore même qu’on en fût convenu, on n’est jamais obligé à rendre ce profit, si ce n’est peut-être par charité, au cas que celui de qui on l’exige fût dans l’indigence : et encore pourvu qu’on le pût rendre sans s’incommoder; si commode potest. Voilà tout ce qui se peut dire.
Texte de 1659 : « Mais Lessius, de just. l. 2. c. 21. d. 16. dit qu’encore même qu’on eût vendu dans l’intention de racheter à moindre prix, on n’est jamais obligé à rendre ce profit... »
GEF V, p. 130. « Non tamen tenetur ad restitutionem (ut inquit Navarrus) quod intellige non teneri ex justitia, sed fieri potest ut teneatur ex charitate : ut si alter sit pauper, et grave sit illi tale detrimentum, cum enim ipse sit causa illius gravis incommodi, tenetur illud amovere ex charitate, si commode potest. Cessante tamen paupertate alterius, non tenetur : quia nec charitas, nec justitia illum obligat. »
D’après Provinciales, éd. Cognet, p. 141, la citation est peu exacte ; la condition initiale n’est pas dans Lessius aussi nette et la traduction est intentionnellement appuyée. Ce n’est pas évident.
VIII, 7. En effet, mon père, je crois qu’une plus grande indulgence serait vicieuse. Nos pères, dit-il, savent si bien s’arrêter où il faut. Vous voyez assez par là l’utilité du Mohatra.
VIII, 8. J’aurais bien encore d’autres méthodes à vous enseigner : mais celles-là suffisent : et j’ai à vous entretenir de ceux qui sont mal dans leurs affaires. Nos pères ont pensé à les soulager selon l’état où ils sont. Car s’ils n’ont pas assez de bien pour subsister honnêtement, et pour payer leurs dettes tout ensemble, on leur permet d’en mettre une partie à couvert, en faisant banqueroute à leurs créanciers. C’est ce que notre père Lessius a décidé, et qu’Escobar confirme au tr. 3. ex. 2. n. 163. Celui qui fait banqueroute, peut-il en sûreté de conscience, retenir de ses biens autant qu’il est nécessaire pour faire subsister sa famille avec honneur, ne indecore vivat? Je soutiens que oui avec Lessius; et même encore qu’il les eût gagnés par des injustices et des crimes connus de tout le monde, ex injustitia, et notorio delicto : quoiqu’en ce cas il n’en puisse pas retenir en une aussi grande quantité qu’autrement.
Texte de 1659; « et tout ensemble pour payer leurs dettes ».
Ex injustitia : l’édition de 1659 porte par erreur justitia.
Texte de Lessius cité par Escobar, Liber theologiae moralis, tr. III, Ex. II, n. 163, p. 359 : « Qui cessit bonis, tenetur, si postea ad pinguiorem fortunam accedat, restituere. Hoc certum; rogo ulterius, an cedens bonis tuta consicentia possit sibi, et familia sua, ne indecore vivat necessaria retinere ? Cum Lessio assero posse : quod quidem est verum, licet debita, pro quibus cedit, sint ex injustitia, et notorio delicto contra, quamvis tunc, non possit tantum quantum alias sibi retinere. » Voir ce passage dans GEF V, p. 124. Citation exacte : voir Provinciales, éd. Cognet, p. 231 sq.
Réponse de Nouët, Impostures III, in Réponses, p. 100 sq. Il renvoie, comme d’habitude, à Du Moulin, Traditions..., p. 334. Il revient là-dessus in Réponse à la XIIe lettre, in Réponses, p. 316 sq. La doctrine de Lessius est “excellente” : p. 101. Un homme ruiné n’est pas obligé de restituer s’il ne peut y parvenir que par sa mort ou celle de ses enfants ; il n’est pas obligé de rendre pendant que sa nécessité dure, mais après. Celui qui s’est ruiné par ses débauches ne peut y trouver d’excuses pour ne pas restituer, puisque c’est de sa faute. Dernier point : ceux qui se sont enrichis injustement doivent restituer même “avec la perte de leur fortune”, “lors principalement que leurs voleries sont connues de tout le monde” : p. 102.
Voir la réponse de Pascal sur la banqueroute dans Provinciale XII, 18, éd. Cognet, p. 231 sq., et sur le ne indecore vivat. « XII, 18. Pour celle-ci, mes pères, il n’y a rien de plus grossier. Vous me traitez d’imposteur sur le sujet d’un sentiment de Lessius, que je n’ai point cité de moi-même, mais qui se trouve allégué par Escobar, dans un passage que j’en rapporte : et ainsi, quand il serait vrai que Lessius ne serait pas de l’avis qu’Escobar lui attribue, qu’y a-t-il de plus injuste que de s’en prendre à moi ? Quand je cite Lessius et vos autres auteurs de moi-même, je consens d’en répondre. Mais comme Escobar a ramassé les opinions des 24 de vos Pères, je vous demande si je dois être garant d’autre chose que de ce que je cite de lui : et s’il faut, outre cela, que je réponde des citations qu’il fait lui-même dans les passages que j’en ai pris. Cela ne serait pas raisonnable. Or, c’est de quoi il s’agit en cet endroit. J’ai rapporté dans ma Lettre ce passage d’Escobar, traduit fort fidèlement, et sur lequel aussi vous ne dites rien; Celui qui fait banqueroute peut-il en sûreté de conscience retenir de ses biens autant qu’il est nécessaire pour vivre avec honneur, ne indecore vivat ? JE REPONDS QUE OUI AVEC LESSIUS, CUM LESSIO ASSERO POSSE etc. Sur cela vous me dites que Lessius n’est pas de ce sentiment. Mais pensez un peu où vous vous engagez. Car, s’il est vrai qu’il en est, on vous appellera imposteurs, d’avoir assuré le contraire : et s’il n’en est pas, Escobar sera l’imposteur; de sorte qu’il faut maintenant, par nécessité, que quelqu’un de la Société soit convaincu d’imposture. Voyez un peu quel scandale ! Aussi vous ne savez prévoir la suite des choses. Il vous semble qu’il n’y a qu’à dire des injures aux personnes, sans penser sur qui elles retombent. Que ne faisiez-vous savoir votre difficulté à Escobar, avant que de la publier ? Il vous eût satisfait. »
PIROT Georges, Apologie pour les casuistes, p. 210 sq. : le ne indecore vivat ne doit pas être traduit par pour vivre avec honneur, mais par afin qu’il ne vive pas dans la honte ou dans le déshonneur. « Je n’examine pas le fond de la question, et dis seulement que les auteurs que j’ai lus sur cette difficulté enseignent qu’un homme de basse condition, qui par des voies injuste est monté à une haute fortune, ne peut faisant banqueroute, retenir de quoi se maintenir petitement en ce second état : mais qu’il doit rendre tout à ses créanciers (...). Ce peu que je viens de dire suffit pour faire voir que les casuistes ne favorisent pas ceux qui par injustice s’élèvent à de prodigieuses fortunes aux dépens des particuliers des provinces entières et du royaume : et que si les casuistes ont des sentiments plus doux, c’est pour les bons marchands, qui ont reçu de leurs pères un état et une condition honnête, ou bien qui sont parvenus par des voies bonnes et légitimes, à une meilleure condition que leur naissance ne portait.
PONTAS, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 203-204. Banqueroute. La loi donne le nom de banqueroute à tous les torts par lesquels un commerçant se met dans l’impuissance de faire honneur à ses engagement. Elle distingue la banqueroute simple de la banqueroute frauduleuse. La première est un délit, la seconde est un crime.
Voir sur les banqueroutiers JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 271 sq.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 363 sq. Note sur ce passage. Ne indecore vivat ne signifie pas vivre avec honneur, mais ne pas être réduit à la mendicité, sous la plume de Lessius. Il borne la tolérance aux aliments nécessaires pour n’être pas réduit à la mendicité.
VIII, 8. Comment, mon Père, par quelle étrange charité voulez-vous que ces biens demeurent plutôt à celui qui les a gagnés par ses concussions, pour le faire subsister avec honneur, qu’à ses créanciers à qui ils appartiennent légitimement, et que vous réduisez par là à la pauvreté ? On ne peut pas, dit le Père, contenter tout le monde, et nos Pères ont pensé particulièrement à soulager ces misérables.
L’apostrophe “Comment, mon père...” est citée aussi, en XII, 19, éd. Cognet, p. 233.
Texte de 1659 : « Comment, mon père, par quelle étrange charité voulez-vous que ces biens demeurent plutôt à celui qui les a gagnés par ses voleries, pour le faire subsister avec honneur, qu’à ses créanciers, à qui ils appartiennent légitimement ? ».
VIII, 8. Et c’est encore en faveur des indigents que notre grand Vasquez cité par Castro Palao, to. I. tr. 6. d. 6. p. 6. n. 12. dit que quand on voit un voleur résolu et prêt à voler une personne pauvre, on peut pour l’en détourner lui assigner quelque personne riche en particulier pour le voler au lieu de l’autre.
Ni GEF, ni Cognet, ni Le Guern ne donnent de référence pour ce texte. On ne connaît donc que le résumé d’Escobar donné plus bas.
Sur le vol, voir JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 365 sq. Note sur la doctrine de Castro Palao, avec une défense de la maxime de Vasquez, particulièrement subtile, reposant sur la distinction de conseiller et de proposer (qui est employée par le jésuite ci-après).
VIII, 8. Si vous n’avez pas Vasquez, ni Castro Palao, vous trouverez la même chose dans votre Escobar. Car, comme vous le savez, il n’a presque rien dit qui ne soit pris de 24. des plus célèbres de nos pères. C’est au tr. 5. ex. 5. n. 120. la pratique de notre société pour la charité envers le prochain.
C’est au tr. 5. ex. 5. n. 120. la pratique de notre Société; certaines impressions ajoutent le mot dans avant la pratique.
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tr. V, Ex. V, cap. VI, p. 621. « Rogo, an liceat paratum furari a paupere persuadere, ut furetur a divite ? Licere asserimus ex mente Lessii consequenter. At stando sententiae Hurtado de Mendoza § 156. proponi solummodo ei potest furtum de rebus divitis minus grave peccatum, etc. Asserit tandem sic hortantem, ad restitutionem teneri. Quod quidem abnego cum Sanch. De Matrim. Tom. 2. lib. 7. d. 11. num. 24. & 25. affirmante, talem suaderi posse ut ab aliquo divite indeterminate furetur. At Vasquez apud Palaum tom. 1. tract. 6. d. 6. p. 6. n. 12. etiam ait, posse determinate a tali divite furari persuaderi : qui non esset rationabiliter invitus respectu suadentis, posito quod fur a furto pauperis aliter non posset absterreri ».
VIII, 9. Cette charité est véritablement grande, mon père, de sauver la perte de l’un par le dommage de l’autre. Mais je crois qu’il faudrait la faire entière : et qu’on serait ensuite obligé en conscience de rendre à ce riche le bien qu’il lui aurait fait perdre. Point du tout, me dit-il : car on ne l’a pas volé soi-même : on n’a fait que le conseiller à un autre.
Texte de 1659 : « Cette charité est véritablement extraordinaire ».
Texte de 1659 : « et que celui qui a donné ce conseil serait ensuite obligé en conscience de rendre à ce riche le bien qu’il lui aurait fait perdre ».
Texte de 1659 : « car il ne l’a pas volé lui-même, il n’a fait que le conseiller à un autre ».
Préparation du passage sur la restitution : voir Laf. 956, Sel. 791. “C’est ce qu’il a prévu aussi en ce lieu me répondit-il, ou après avoir dit - 22 - si cela était vrai les plus riches seraient damnés. Il ajoute : à cela Arragonius répond qu’ils le sont aussi et Bauny, jésuite ajoute, de plus, que leurs confesseurs le sont de même mais je réponds avec Valentia, autre jésuite, et d’autres auteurs qu’il y a plusieurs raisons pour excuser ces riches et leurs confesseurs.
J’étais ravi de ce raisonnement quand il me finit par celui-ci :
Si cette opinion était vraie pour la restitution, O qu’il y aurait de restitutions à faire !
O mon père, lui dis-je, la bonne raison. - O, me dit le père, que voilà un homme comme. - O, mon père, répondis-je, sans vos casuistes qu’il y aurait de monde damné. (O répliqua-t-il qu’on a tort de ne nous pas laisser en parler) - O mon père, que vous rendez large la voie qui mène au ciel ! O qu’il y a de gens qui la trouvent ! Voilà un...”
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 365 sq. Note sur la doctrine de Castro Palao, avec une défense de la maxime de Vasquez, particulièrement subtile, reposant sur la distinction de conseiller et de proposer (qui est employée par le jésuite ici).
PONTAS, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 475 sq. Restitution.
VIII, 9. Or écoutez cette sage résolution de notre p. Bauny sur un cas qui vous étonnera donc bien davantage, et où vous croiriez qu’on serait bien plus obligé de restituer. C’est au ch. 13. de sa Somme. Voici ses propres termes français. Quelqu’un prie un soldat de battre son voisin, ou de brûler la grange d’un homme qui l’a offensé : on demande si, au défaut du soldat, l’autre qui l’a prié de faire tous ces outrages, doit réparer du sien le mal qui en sera issu. Mon sentiment est que non. Car à restitution nul n’est tenu, s’il n’a violé la justice. La viole-t-on quand on prie autrui d’une faveur ? Quelque demande qu’on lui en fasse, il demeure toujours libre de l’octroyer ou de la nier. De quelque côté qu’il encline, c’est sa volonté qui l’y porte : rien ne l’y oblige que la bonté : que la douceur, et la facilité de son esprit. Si donc ce soldat ne répare le mal qu’il aura fait, il n’y faudra astreindre celui à la prière duquel il aura offensé l’innocent.
Texte de 1659 : « un cas qui vous étonnera donc encore bien davantage, et où vous croiriez qu’on serait beaucoup plus obligé de restituer ».
Laf. 969, Sel. 801. « Bauny brûleur de granges. »
Voir BAUNY Étienne, Somme des péchés, ch. XIII, 6e éd., p. 307-308, Question 10. Texte cité dans GEF V, p. 119. Provinciales, éd. Cognet, p. 142. Citation abrégée.
BAUNY Étienne, Somme des péchés, XI, p. 224 sq. L’extrême nécessité excuse de rendre ce qu’on a d’autrui. On peut ne pas restituer promptement quand cela entraîne un notable dommage au débiteur : p. 227. Être en danger de perdre sa renommée, juste cause pour délayer la restitution : p. 230. Cas des officiers publics enrichis par vol d’autrui mais tenus pour gens de vertu : p. 232. On se contentera de la promesse de s’acquitter quand Dieu leur aura donné la fortune nécessaire. Cession des biens, cause qui rend quitte : p. 232 sq.
PIROT Georges, Apologie pour les casuistes, p. 210 sq. Voir p. 211-212, sur le cas du soldat qui aurait brûlé une grange. Le P. Pirot rejette la faute sur le p. Bauny; « Le père Bauny cite quelques auteurs pour cette opinion qu’il suit [sc. « les casuistes déchargent de l’obligation de restituer un soldat qui à la prière de quelqu’un aurait battu un autre, ou bien qui aurait brûlé sa grange »] lesquels à son avis ne parlent pas de l’obligation qu’aurait ce soldat de restituer à celui qui a souffert le dommage, mais de l’obligation de restituer au soldat même qui aurait été condamné à payer le dommage et l’aurait effectivement payé. Or en ce dernier cas celui qui a conseillé à un soldat de brûler n’est pas obligé de réparer le dommage qu’encourt ce soldat. C’est donc une méprise du père Bauny, à laquelle les autres casuistes ne prennent point de part ».
Cela dit, si le gangster que vous avez stipendié pour brûler la maison de votre voisin en a pris pour 20 ans, il viendra sans doute vous demander lui-même à la sortie de prison la compensation à laquelle il estime avoir droit., sans aller la réclamer à la justice...
VIII, 9. Ce passage pensa rompre notre entretien, car je fus sur le point d’éclater de rire de la bonté et douceur d’un brûleur de grange, et de ces étranges raisonnements qui exemptent de restitution le premier et véritable auteur d’un incendie, que les juges n’exempteraient pas de la corde : mais si je ne me fusse retenu le bon Père s’en fût offensé : car il parlait sérieusement, et me dit ensuite du même air :
Texte de 1659 : « que les juges n’exempteraient pas de la mort ».
Penser : faillir, être sur le point de. Voir MOLIÈRE, Les fourberies de Scapin, II, 3, « Vous vous souvenez de ce loup-garou... qui vous pensa faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant... »
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 187.
VIII, 10. Vous devriez reconnaître par tant d’épreuves, combien vos objections sont vaines : cependant vous nous faites sortir par là de notre sujet.
VIII, 10. Revenons donc aux personnes incommodées, pour le soulagement desquelles nos pères, comme entre autres Lessius l. 2. c. 12. n. 12. assurent qu’il est permis de dérober non seulement dans une extrême nécessité, mais encore dans une nécessité grave, quoique non pas extrême. Escobar le rapporte aussi au tr. I, ex. 9. n. 29.
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, tr. I, ex. 9, n. 29, p. 158. « Dixisti in gravi necessitate non licere aliena occulte furari. Num probabilis conscientia ? Ex doctrina Lessii probabilem existimo; quia sicut dives in gravi necessitate tenetur dare ita pauper petest accipere absque injuria; neque dives in hoc casu potest esse rationabiliter invitus circa substantiam rei acceptae; sed tantum potest ei modus displicere. » Voir le texte d’Escobar en question dans GEF V, p. 123.
L’original de Lessius, De justitia et jure, L. II, ch. XII, De injuriis fortunarum, dub. 12, Utrum in extrema, vel etiam in gravi necessitate, licitum sit aliena surripere, 71, est cité p. 127 : « dico secundum probabile est, non solum in extrema, sed etiam in gravi necessitate morbi, famis, nuditatis, posse clanculum surripere ab opulentis, si aliter grave illud malum avertere nequeas » (suivent des noms de casuistes qui tiennent cette opinion). Voir Provinciale VII, 15, éd. Cognet, p. 127. Citation légèrement abrégée, exacte pour le sens.
PIROT Georges, Apologie pour les casuistes, p. 212 sq. Contre Pascal, qui d’un côté dit que les riches sont obligés de faire l’aumône aux pauvres, mais qui dans ce passage prend « les pauvres à la gorge » et les « réduit « à souffrir la faim, la soif, la nudité et toutes sortes de maux; pourvu qu’ils n’expirent et ne rendent pas l’âme dans ces misères ». Mais « plusieurs théologiens » enseignent ce que Pascal condamne, notamment Lessius qui « dit seulement que l’opinion que vous condamnez est probable : mais il suppose que la nécessité doit être grande à l’égard de la vie, non de l’état. Il suppose aussi que le pauvre n’ait aucun moyen en demandant même de subvenir à sa nécessité : et il parle avec une si grande retenue, que tout homme de bon sens jugera que les raisons dont il se sert sont probables » : p. 213.
VIII, 10. Cela est surprenant, mon père ; Il n’y a guère de gens dans le monde, qui ne trouvent leur nécessité grave, et à qui vous ne donniez par là le pouvoir de dérober en sûreté de conscience. Et quand vous en réduiriez la permission aux seules personnes qui sont effectivement en cet état, c’est ouvrir la porte à une infinité de larcins, que les juges puniraient nonobstant cette nécessité grave : et que vous devriez réprimer à bien plus forte raison, vous qui devez maintenir parmi les hommes non seulement la justice, mais encore la charité qui est détruite par ce principe. Car enfin n’est-ce pas la violer, et faire tort à son prochain que de lui faire perdre son bien pour en profiter soi-même ? C’est ce qu’on m’a appris jusqu’ici.
FERREYROLLES Gérard, Pascal et la raison du politique, p. 62 sq. Sur le rapport de la question du vol avec les lois naturelles. Seul un minimum de solidarité entre les membres de la société peut éviter à celle-ci la destruction. Donner à qui n’a rien et ne pas prendre ce qui appartient à autrui sont des règles élémentaires en dehors desquelles il n’y a plus de vie sociale. Les casuistes compromettent la vie sociale par deux permissions : ne pas donner, permission qui est faite par Vasquez en définissant à sa façon le superflu : et prendre aux autres ce qui leur appartient : ne pas restituer permet d’achever le système.
VIII, 10. Cela n’est pas toujours véritable, dit le père : car notre grand Molina nous a appris, t. 2. tr. 2. dis. 328. n. 8. Que l’ordre de la charité n’exige pas qu’on se prive d’un profit, pour sauver par là son prochain d’une perte pareille. C’est ce qu’il dit pour montrer ce qu’il avait entrepris de prouver en cet endroit-là ; Qu’on n’est pas obligé en conscience, de rendre les biens qu’un autre nous aurait donnés pour en frustrer ses créanciers.
MOLINA, De justitia et jure, t. II, Tract. II, disp. 328, col. 321, n. 16, « Eo quod charitatis ordo non postulet, ut posponat tantum suum commodum, ut creditores ab aequali damno servet immunes ». Passage cité in GEF V, p. 133-134.
Les biens qu’un autre nous aurait donnés pour en frustrer ses créanciers : l’éd. Cognet porte les biens qu’un autre nous aurait donnés, pour en frustrer ses créanciers, mais cette ponctuation change le sens. Il faut bien entendre que l’autre a donné ses biens dans l’intention expresse de frustrer ses créanciers, et non pas que celui qui les a reçus cherche à spolier ces créanciers en ne restituant pas le dépôt. NB : l’idée que le débiteur malhonnête soit victime de sa propre malhonnêteté est au moins comique.
VIII, 10. Et Lessius qui soutient la même opinion, la confirme par ce même principe au l. 2. c. 20. d. 19. n. 168.
La référence de Pascal est exacte, dans Leonardi LESSII, e soc. Iesu, De justita et jure ceterisque virtutibus cardinalibus Libri quatuor, Paris, 1628 ; le passage auquel il fait allusion se trouve p. 266, col. 2. « Si res alienetur in fraudem creditorum. Petes, Quid si per eam donationem vel alienationem stat impotens ad solvendum.
Resp. Multi DD. In hoc casu docent, eum, qui aliud accepit, teneri ad restitutionem, quia accepit, teneri restitutionem, quia accepit in fraudem creditorum, ac proinde injuste.
Si non induxisti ad donanduum potes accipere.
Sed utendum est distinctione. Primo, Si non inducis illum ad donandum vel ad alienandum, sed ipse sponte tibi donat, vel vendit, aut emit, non teneris ad restitutionem in foro conscientiae, etiamsi scias ipsum per hoc fieri impotentem ad solvendum. Ita Petrus Navarr. Lib. 3 cap. 4, num. 218, et Molina disput. 327 colligitur aperte ex L. ultima, § 4p. Quae in fraudem creditorum. Et patet ex ratione allata ; quia illae res nemini sunt obstrictae, et ipse est earum dominus, et nulla lege inhabilis ad transferendum earum dominium : ergo transfert reipsa. Nec obstat, quod ille peccet donando, quatenus per hoc reddit se impotentem ad solvendum creditoribus : quia tu non es causa cur velit donare ; sed supposito quod ipse sponte velit, tu acceptas, utens jure tuo. Nec enim vel justitia vel charitas postulat, ut negligas tuum incommodum, etiamis inde per accidens sequatur alteri tantumdem damni ».
Le texte est reproduit dans GEF V, p. 129-130, avec coupure des références aux autres casuistes.
VIII, 11. Vous n’avez pas assez de compassion pour ceux qui sont mal à leur aise : nos pères ont eu plus de charité que cela. Ils rendent justice aux pauvres aussi bien qu’aux riches. Je dis bien davantage ; Ils la rendent même aux pécheurs. Car encore qu’ils soient fort opposés à ceux qui commettent des crimes : néanmoins ils ne laissent pas d’enseigner que les biens gagnés par des crimes peuvent être légitimement retenus.
M. Le Guern pense que cette partie sur la restitution a été composée à l’aide d’un mémoire inédit d’Arnauld conservé à la BNF dans un recueil de pièces coté n. a : fr. 1525, f° 161-171, composé de deux parties, Que les juges ne sont pas moins obligés de restituer ce qu’on leur aurait donné pour une sentence injuste que pour une juste, et Des femmes perdues. Voir LE GUERN Michel, « Sur la bataille des Provinciales. Documents inédits », Revue d’histoire littéraire de la France, avril-juin 1966, p. 293-296.
VIII, 11. C’est ce que dit Lessius l. 2, c. 10. d. 6. num. 46. Les biens acquis par l’adultère sont véritablement gagnés par une voie illégitime : mais néanmoins la possession en est légitime ; quamvis mulier illicite acquirat, licite retinet acquisita.
Texte de 1659 : « C’est ce que Lessius enseigne généralement, l. 2. c. 14, d. 8. On n’est point, dit-il, obligé, ni par la loi de nature, ni par les lois positives, c’est-à-dire par aucune loi de rendre ce qu’on a reçu pour avoir commis une action criminelle, comme pour un adultère, encore même que cette action soit contraire à la justice. Car, comme dit encore Escobar en citant Lessius, tr. I, ex. 8, n. 59 : Les biens qu’une femme acquiert par l’adultère sont véritablement gagnés par une voie illégitime, mais néanmoins la possession en est légitime; Quamvis mulier illicite acquirat, licite tamen retinet acquisita.».
A la question d’Escobar “si une femme est tenue de restituer à son mari le gain qu’elle a reçu de l’adultère” Molina répond par l’affirmative parce que le mari “est le maître des actes conjugaux de sa femme”. Lessius considérait à l’inverse que “l’injustice ou l’adultère ne peut être compensée avec de l’argent.”.
Le texte de Lessius se trouve selon Escobar dans le De justitia et jure, Livre II, ch. 10, Dubitatio 6, n. 46. Mais on peut se demander si la référence d’Escobar n’est pas partiellement erronée. L’idée semble plus conforme au titre de la Dubitatio 5 que 6, intitulée Utrum adulter teneat aliquid restituere marito adulterae pro injuria, si partus non sit secutus. « Respondeo et dico Primo, Si nullum aliud damnum secutum est, non teneri quidquam pro haec injuria marito illata rependere. Ratio est; quia injuriae ab omni damno separatae, non debetur ex justitia, nisi satisfactio, per signa doloris : veniae petitionem, etc. quae tamen locum non habet, quando injuria ignoratur : unde nisi maritus resciscat, non tenetur adulter ad talem satisfactionem. Haec enim satisfactio non fit, nisi sententi se injuria affectum, cum consistat in placatione animi exacerbati. Quod si resciscat, et putetur cupere, tenetur; alias minime.
Dico secundum, Si maritus exigat satisfactionem pecuniariam, alter non tenetur eam praestare. Ratio est; tum quia tale damnum non est illatum : tum quia haec conventio seu transactio pro injuria adulterii, Jure est interdicta, L. Transigere 18, C : de transactionibus, ubi dicitur; Transigere vel pacisci de crimine capitali, excepto adulterio, prohibitum non est. Idem vetatur L. Miles, II, p ad legem Juliam, de adulteriis. Quod idcirco Jus vetuit, ne maritus videatur suae uxoris lenocinium facere, ejusque corpus ad quaestum tamquam leno prostituere. Si tamen maritus occulte transigeret cum adultero sine scandalo, non videtur peccare, nec ad ad restitutionem teneri : quia leges illae magis pertinent ad Judices, ne concedatur actio, nimirum in poenam, ob praesumptionem lenocinii, quam ad mores privatos ».
Pascal attribuait donc à Lessius les conclusions qu’en tirait Escobar. L’édition Le Guern, qui donne le texte de 1657, n’apporte pas de modification. La correction a donc été effectuée en 1659, de manière à éviter les objections des polémistes jésuites.
Voir le texte de Lessius, De justitia et jure, L. II, cap. XIV, De restitutione ratione rei acceptae, et cui facienda restitutio, dub. 8. Utrum acceptum ob turpem causam sir necessario restituendum, et cui. n. 52-53. Non jure naturae restituendum est. Dico primo, si solum jus naturae spectetur, acceptum ob turpem causam, seu propter opus, quod est peccatum, opere impleto non necessario est restituendum, sive illud opus sit contra justitiam, sive non... » Wendrock, qui cite ces lignes, est obligé d’ajouter entre parenthèse ; « imo, ut infra decernit, si jus, etiam positivum attendatur ». Ce n’est en fait pas évident par le texte de Lessius. Voir dans GEF V, p. 127.
Voir le texte d’Escobar, Liber theologiae moralis, Tr. I, Ex. VIII, De luxuria, cap. III, n. 59, p. 142. « Accipit uxor lucrum ex adulterio, teneturne marito restituere ? Affirmat Molina de just. Tom. I. tract. 2. d. 94. quia ipse est dominus actuum conjugalium uxoris. Nisi accepisset ab eo, qui alienare non posset, ut Religioso, aut filiofamilias. Id autem uxor secreto gerere tenetur, ne suae famae deroget. At Lessius lib. 2. cap. 10. dub. 6. num. 46. contrarium probabilus docuit : quia injuria adulterii non est pecunia compensabilis, et mulier quamvis ex fornicatione illicite acquirat, licite retinet acquisita ». Texte cité dans GEF V, p. 122 sq.
Dans la présente Provinciale, Pascal ne retient pas la décision de Molina.
Allusion à un passage d’Escobar, Théologie morale, Tract. I, Examen VIII, n. 59, p. 100 de l’édition de Paris, 1656, ou p. 142 de l’édition de Lyon, 1659, signalé par GEF XIV, p. 351, et cité p. 361, qui oppose sur ce point Molina et Lessius. « Accipit uxor lucrum ex adulterio, tenetur ne marito restituere ? Affirmat Molina, de Just., tom. I, tract. II, d. 94, quia ipse est dominus actuum conjugalium uxoris; nisi accepisset ab eo qui alienare non posset, ut religioso, aut filiofamilias. Id autem uxor secreto gerere tenetur, ne suae famae deroget. At Lessius, lib. II, cap. X, dubit. 6, n. 46, contrarium probabilius docuit : quia injuria adulterii non est pecunia compensabilis, et mulier quamvis ex fornicatione illicite acquirat : licite retinet acquisita ».
La référence à Molina, répond à une question large : « Consequenter dicendum est de iis, quae ob turpem causam acciuntur ». On lit; « De occulta fornicaria est dubium, an quod pro fornicatione accipit in pretium restituendum sit in foro conscientiae, aut saltem id ab ea in foro exteriori pepeti possit. [...] Utrum vero conjugata teneatur reddere tale pretium marito, filiafamilias patri, ac monialis monasterio; cum Dominico a Soto et aliis est dicendum non secus teneri illud reddere, quam si labore manuum suarum id comparassent. Debet tamen illud eis reddere occulte, ut propriae consulant famae, vitenturque alia mala. Quin siquid illis esset promissum ac debitum ob fornicationem, necdumque esset solutum restitution est facienda non foeminis ipsis, sed marito, patri aut monasterio, quando periculum non esse illis pretium tradituras ».
Les Pensées conservent des brouillons préparatoires.
Pensées, Laf. 969, Sel. 801. « Probable.
Ils raisonnent comme ceux qui montrent qu’il est nuit à midi.
Si d’aussi méchantes raisons que celles-ci sont probables, tout le sera.
1. raison. Dominus actuum conjugalium. Molin.
2. raison. Non potest compensari. Less. »
On trouve ce passage sur la page ci-dessous, dans le dernier tiers de la feuille.
Pensées, Laf. 722, Sel. 600. « Probable.
Qu’on voie si on recherche sincèrement Dieu par la comparaison des choses qu’on affectionne.
Il est probable que cette viande ne m’empoisonnera pas.
Il est probable que je ne perdrai pas mon procès en ne sollicitant pas.
Probable.
Quand il serait vrai que les auteurs graves et les raisons suffiraient je dis qu’ils ne sont ni graves, ni raisonnables.
Quoi ! un mari peut profiter de sa femme, selon Molina! La raison qu’il en donne est-elle raisonnable et la contraire de Lessius l’est-elle encore?
Oserez-vous ainsi, vous, vous jouer des édits du roi? ainsi en disant que ce n’est pas se battre en duel que d’aller dans un champ en attendant un homme.
Que l’Église a bien défendu le duel, mais non pas de se promener.
et aussi l’usure, mais non...
Et la simonie mais non...
Et la vengeance mais non...
Et les sodomites mais non...
Et le quam primum mais non... »
Sur ces fragments, voir le site consacré aux Pensées de Pascal.
VIII, 11. Et c’est pourquoi les plus célèbres de nos pères décident formellement que ce qu’un juge prend d’une des parties qui a mauvais droit, pour rendre en sa faveur un arrêt injuste, et ce qu’un soldat reçoit pour avoir tué un homme, et ce qu’on gagne par les crimes infâmes, peut être légitimement retenu.
PIROT Georges, Apologie pour les casuistes, XXVIIe objection, éd. de 1658, p. 213 sq.
RAPIN René, Mémoires, II, éd. Aubineau, p. 380.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 274 sq.
VIII, 11. C’est ce qu’Escobar ramasse de nos auteurs, et qu’il assemble au tr. 3. ex. I. num. 23. où il fait cette règle générale. Les biens acquis par des voies honteuses, comme par un meurtre, une sentence injuste : une action déshonnête, etc., sont légitimement possédés, et on n’est point obligé à les restituer.
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tr. III, Ex. I, n. 23, p. 335. « Quid de pretio pro re turpi accepto ? Accepta ob turpem causam solo jure naturali spectato, illicita non sunt, nec restituenda. Pactio pretii ob rem turpem illicita est, nec obligat : portquam facta est, obligationem inducit; sic accipi pretium potest ob injustam sententiam datam, ob homicidium factum, ob meretricium, ob occultam etiam fornicationem. In quibusdam vero casibus tenetur restituere, v. gr. si acceperit meretrix a non potentibus alienare, vel fraude ac dolo quis extorsit : quando item occulta fornicatio puniretur in judicio, actio illi in foro externo non conceditur ». Texte cité dans GEF V, p. 123. Traduction abrégée, mais exacte ; Wendrock rétablit le texte complet.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol., p. 275 sq.
VIII, 11. Et encore au tr. 5. ex. 5. n. 53. On peut disposer de ce qu’on reçoit pour des homicides, des arrêts injustes, des péchés infâmes, etc., parce que la possession en est juste, et qu’on acquiert le domaine et la propriété des choses que l’on y gagne.
Texte de 1659; « pour des homicides, des sentences injustes, des péchés infâmes ».
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tr. V, Ex. V, n. 53, p. 609. « Possum exhibere eleemosynam de propriis bonis turpiter acquisitis ? Si ipsa acquisitio injusta est, v. gr. Furtum, aut usura, ludus fallax, simonia, etc., non potes. Si non est injusta ipsa acquisitio, licet adfuerit luxuries, homicidium, sententia injusta, etc. potes plane : quia hoc in casu dominium acquiritur, secus in illo. »
Domaine : bien, fonds, héritage (Dictionnaire de l’Académie).
VIII, 11. O mon père, lui dis-je, je n’avais jamais ouï parler de cette voie d’acquérir, et je doute que la justice l’autorise et qu’elle prenne pour un juste titre l’assassinat, l’injustice et l’adultère. Je ne sais, dit le père, ce que les livres du droit en disent ; mais je sais bien que les nôtres qui sont les véritables règles des consciences en parlent comme moi.
VIII, 11. Il est vrai qu’ils en exceptent un cas auquel ils obligent à restituer. C’est quand on a reçu de l’argent de ceux qui n’ont pas le pouvoir de disposer de leur bien, tels que sont les enfants de famille et les Religieux. Car notre grand Molina les en excepte au t. I. de just. tr. 2. disp. 94. nisi mulier accepisset ab eo qui alienare non potest, ut a Religioso et filiofamilias. Car alors il faut leur rendre leur argent.
Les enfants de famille : nous dirions les mineurs, comme il est dit plus bas.
Citation littérale.
VIII, 11. Escobar cite ce passage au tr. I. ex. 8. n. 59.
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tr. I, Ex. VIII, n. 59, p. 142.
VIII, 11. Et il confirme la même chose au tr. 3. ex. I. n. 23.
ESCOBAR, Liber theologiae moralis, Tr. III, Ex. 1, n. 23, p. 335. Voir plus haut.
VIII, 12. Mon révérend père, lui dis-je, je vois les religieux mieux traités en cela que les autres. Point du tout, dit le père, n’en fait-on pas autant pour tous les mineurs généralement, au nombre desquels les religieux sont toute leur vie ? Il est juste de les excepter. Mais à l’égard de tous les autres, on n’est point obligé de leur rendre ce qu’on reçoit d’eux pour une mauvaise action.
PONTAS, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 427 sq. Religieux.
VIII, 12. Et Lessius le prouve amplement au l. 2. de just., c. 14. d. 8. n. 52. Ce qu’on reçoit, dit-il, pour une action criminelle, n’est point sujet à restitution par aucune justice naturelle, parce qu’une méchante action peut être estimée pour de l’argent, en considérant l’avantage qu’en reçoit celui qui la fait faire : et la peine qu’y prend celui qui l’exécute; Et c’est pourquoi on n’est point obligé à restituer ce qu’on reçoit pour la faire, de quelque nature qu’elle soit, homicide, arrêt injuste, action sale, si ce n’est qu’on eût reçu de ceux qui n’ont pas le pouvoir de disposer de leur bien. Vous direz peut-être que celui qui reçoit de l’argent pour un méchant coup, pèche, et qu’ainsi il ne peut ni le prendre ni le retenir : mais je réponds qu’après que la chose est exécutée, il n’y a plus aucun péché ni à payer, ni à en recevoir le payement.
Texte de 1659; « Et Lessius le prouve amplement au l. 2, De Just., c. 14, d. 8, n. 52. Car, dit-il, une méchante action peut être estimée pour de l’argent, en considérant l’avantage qu’en reçoit celui qui la fait faire, et la peine qu’y prend celui qui l’exécute; et c’est pourquoi on n’est point obligé à restituer ce qu’on reçoit pour la faire, de quelque nature qu’elle soit, homicide, sentence injuste, action sale (car ce sont les exemples dont il se sert dans toute cette matière), si ce n’est qu’on eût reçu de ceux qui n’ont pas le pouvoir de disposer de leur bien. »
Le texte de Lessius, De justitia et jure dont Pascal s’inspire est donné dans GEF V, p. 127 sq. La partie centrale du texte est un résumé, le reste est exactement cité. Wendrock est plus explicite et plus précis.
VIII, 12. Notre grand Filiutius entre plus encore dans le détail de la pratique. Car il marque qu’on est obligé en conscience de payer différemment les actions de cette sorte, selon les différentes conditions des personnes qui les commettent : et que les unes valent plus que les autres.
GEF V, p. 152 et p. 131 pour l’original. Résumé du texte, que Wendrock ne met pas en italique.
Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 423 sq. Réponse à la VIe Imposture. “De l’impudence des jésuites, qui étendent aux honnêtes femmes, aux filles et aux religieuses ce que les lois n’accordent qu’aux prostituées”.
VIII, 12. C’est ce qu’il établit sur des solides raisons, au tr. 31. c. 9. n. 231. Occultae fornicariae debetur pretium in conscientia, et multo majore ratione, quam publicae. Copia enim quam occulta facit mulier sui corporis, multo plus valet quam ea quam publica facit meretrix : nec ulla est lex positiva quæ reddat eam incapacem pretii. Idem dicendum de pretio promisso Virgini, conjugatµ, Moniali, et cuicunque alii. Est enim omnium eadem ratio.
FILLIUCCI, Morales quaestiones, tome II, Tr. XXXI, De justitia et jure, et dominio rerum, cap. IX, 231. Pro occulta fornicaria. Voir GEF V, p. 152 et 131 pour l’original.
WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, I, p. 423 sq. Réponse à la VIe Imposture. “De l’impudence des Jésuites, qui étendent aux honnêtes femmes, aux filles et aux religieuses ce que les lois n’accordent qu’aux prostituées”. Voir ce que Nicole pense de la prostitution, p. 426 : “on a jugé à propos dans quelques villes d’y souffrir des femmes publiques pour éviter de plus grands désordres. Ainsi quelque infâme que soit cette profession, elle a néanmoins trouvé sa place dans les républiques, à cause de son utilité. On l’a tolérée parce qu’on l’a jugée nécessaire en certains lieux, pour empêcher les hommes de se porter à de plus grands crimes. Ce qui a fait dire à saint Augustin que si l’on faisait mourir les femmes publiques, on donnerait lieu à de plus grands désordres. Il était donc juste qu’en laissant la vie à ces sortes de personnes, on leur laissât aussi le moyen de subsister. Le gain qu’elles font n’est donc pas tant une récompense de leur crime qu’un présent que les lois leur accordent, à cause de cette utilité qu’on prétend qu’elles apportent au public. C’est une amende à laquelle la république condamne les méchants, et qu’elle adjuge à ces malheureuses, et non le salaire de leur commerce criminel, qui par lui-même ne mérite que le châtiment.”
FERREYROLLES Gérard, Pascal et la raison du politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1984, p. 223 sq. Cas de chose qui est permise par les lois humaines, mais qui ne le sont pas selon la justice éternelle.
PIROT Georges, Apologie pour les casuistes, éd. de 1658, p. 213 sq.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 379. « Oui, une femme jusqu’alors honnête peut se vendre plus qu’une courtisane, parce que son honneur n’a d’autre prix que celui qu’elle veut y mettre. Parlons crûment ; elle n’est pas une marchandise de commerce comme la prostituée, mais de caprice et de passion : il n’y a donc pas de prix courant établi pour elle ».
VIII, 13. Il me fit voir ensuite dans ses auteurs des choses de cette nature si infâmes, que je n’oserais les rapporter, et dont il aurait eu horreur lui-même (car il est bon homme) sans le respect qu’il a pour ses pères, qui lui fait recevoir avec vénération tout ce qui vient de leur part. Je me taisais cependant, moins par le dessein de l’engager à continuer cette matière, que par la surprise de voir des livres de religieux pleins de décisions si horribles, si injustes et si extravagantes tout ensemble. Il poursuivit donc en liberté son discours, dont la conclusion fut ainsi. C’est pour cela, dit-il, que notre illustre Molina (je crois qu’après cela vous serez content) décide ainsi cette question : Quand on a reçu de l’argent pour faire une méchante action, est-on obligé à le rendre ? Il faut distinguer, dit ce grand homme, si on n’a pas fait l’action pour laquelle on a été payé, il faut rendre l’argent : mais si on l’a faite, on n’y est point obligé ; si non fecit hoc malum, tenetur restituere, secus, si fecit. C’est ce qu’Escobar rapporte au tr. 3. ex. 2. n. 138.
JOUSLIN Olivier, Pascal et le dialogue polémique, p. 463 sq.
Dont il aurait eu horreur lui-même (car il est bon homme), sans le respect qu’il a pour ses Pères, qui lui fait recevoir avec vénération tout ce qui vient de leur part ; c’est une bonne définition du sectarisme. On peut être un homme agréable, et même honnête, et, parce qu’on est d’un parti, en adopter les positions les plus absurdes ou les plus infâmes.
Citation exacte.
NOUËT, VIe Imposture.
VIII, 14. Voilà quelques-uns de nos principes touchant la restitution. Vous en avez bien appris aujourd’hui : Je veux voir maintenant comment vous en aurez profité. Répondez-moi donc. Un juge qui a reçu de l’argent d’une des parties pour faire un arrêt en sa faveur est-il obligé à le rendre? Vous venez de me dire que non, mon père. Je m’en doutais bien, dit-il : Vous l’ai-je dit généralement? Je vous ai dit qu’il n’est pas obligé de rendre, s’il a fait gagner le procès à celui qui n’a pas bon droit. Mais quand on a bon droit, voulez-vous qu’on achète encore le gain de sa cause qui est dû légitimement ? Vous n’avez pas de raison. Ne comprenez-vous pas que le Juge doit la justice, et qu’ainsi il ne la peut pas vendre : mais qu’il ne doit pas l’injustice : et qu’ainsi il peut en recevoir de l’argent. Aussi tous nos principaux auteurs, comme Molina disp. 94. et 99. Reginaldus l. 10. n. 184, I85 et 178. Filiutius tr. 31, n. 220. et 228. Escobar tr. 3. ex. I. n. 21. et 23. Lessius, l. 2, c. 14, d. 8. n. 52. enseignent tous uniformément, Qu’un juge est bien obligé de rendre ce qu’il a reçu pour faire justice : si ce n’est qu’on le lui eût donné par libéralité : mais qu’il n’est jamais obligé à rendre ce qu’il a reçu d’un homme en faveur duquel il a rendu un arrêt injuste.
Texte de 1659 : « Un juge qui a reçu de l’argent d’une des parties pour rendre un jugement en sa faveur est-il obligé à le rendre? ».
Noter le style pédagogique du passage. La leçon est finie, on passe à l’interrogation orale.
Noter que la mise en forme du raisonnement, qui est impeccable, est due à Pascal : on ne la trouve pas ni le Liber theologiae moralis d’Escobar, ni chez les autres casuistes. Pascal aurait fait un excellent casuiste. Ce que cela suggère, c’est que la casuistique est une forme déréglée de l’esprit géométrique : quand on part de principes aberrants, on peut en tirer des conséquences délirantes par un raisonnement rigoureux. Pascal ne dira pas autre chose dans les Pensées à propos des philosophes.
LE GUERN Michel, “Sur la bataille des Provinciales”, p. 294. Le Ms. BN n. a. fr. 1525, f° 165 r°, donne un passage d’Arnauld (?), que Pascal aurait utilisé. “Or c’est un renversement de la raison manifeste qu’un juge ne me puisse pas vendre une sentence juste, parce qu’il me la doit, et qu’il n’en puisse vendre une injuste, parce qu’il ne me la doit pas : au lieu que le sens commun nous apprend que comme il n’en peut vendre une juste, parce qu’il est obligé de la rendre, il en peut encore moins vendre une injuste, parce qu’il est encore plus obligé de n’en point rendre de telle” (f° 165 r°).
Référence de Molina : Molina, disp. 94 et 99. Les références que Pascal donne pour Molina sont inexactes : voir éd. Cognet, p. 147, n. 3. Ni Cognet ni GEF V, p. 154 ne donnent les bonnes références. Celle que Pascal donne, disp. 94 et 99, est la même que celle du manuscrit en question, qui porte selon Le Guern :
« Molina. Disp. 94 et 99.
Lessius. lib. 2. c. 14 dub. 8 et 9.
Reginald. Lib. 10. n. 184, 185 et 178.
Filiuc. Tr. 31. n. 228 et 220. »
Référence à Reginaldus : Reginaldus, l. 10, n. 184, 185 et I78. Les éditions de 1657 donnent par erreur 187 pour dernière référence. Les passages de Regnault auxquels renvoie Pascal sont donnés dans GEF V, p. 130-131.
Référence de Filiutius : voir GEF V, p. 131 sq.
Référence d’Escobar : voir GEF V, p. 123 sq.
Citation de Lessius : GEF V, p. 154, et p. 128 sq. La bonne référence est n. 55, et non n. 52; voir aussi n. 64. NOUËT, Impostures V, in Réponses, p. 108 sq., cite des auteurs qui décident en sens contraire de Lessius (Molina, Filiutius, Reginaldus); mais il ne dit pas que Lessius n’enseigne pas ce que Pascal lui reproche; il déplace la question, en le taxant d’ignorance en matière juridique : p. 111-112. Voir le commentaire de WENDROCK, Provinciales, tr. Joncoux, p. 407 sq., où Pascal est défendu contre les attaques des jésuites sur sa bonne foi (Imposture V). Pour la discussion de l’opinion de Lessius, voir p. 411 sq. et p. 412 : Nicole note que selon Comitolus, tous les raisonnements de Lessius reposent sur le principe que “tout péché... mérite salaire, non en tant qu’il est une offense contre Dieu, mais à cause du plaisir qu’en reçoit celui qui le fait commettre, ou de la peine qu’a celui qui le commet”. C’est ce principe qui fonde la formule de Pascal, devoir la justice, ne pas devoir l’injustice. Voir p. 428, le résumé de Nicole : on ne peut vendre les crimes, ni l’impudicité, ni l’injustice, ni l’homicide : ces actions sont au dessous de tout prix et ne méritent que le châtiment.
L’erreur sur Molina prouve, selon Le Guern, que Pascal s’est servi du manuscrit en question : p. 294-295. Pascal se serait documenté pour ajouter Escobar. Cependant la référence de Lessius est fausse aussi, et Le Guern ne semble pas avoir vu que celle de Reginaldus, dans l’édition de 1657, qui est pourtant la sienne, est fausse également (éd. Cognet, p. 147, n. 4) : d’ailleurs la Pléiade donne 1871, ce qui est évidemment erroné. Pourquoi considérer que seule l’erreur sur Molina est significative?
La référence de Lessius est aussi plus complète, quoique fausse, chez Pascal que dans le manuscrit.
PIROT Georges, Apologie pour les casuistes, p. 216-217. Dans l’opinion de tous les casuistes, le juge qui donne une sentence injuste est obligé de restituer à la partie qui a souffert l’injustice, si celui au profit duquel elle a été faite ne restitue pas; mais il n’est pas obligé de rendre ce qu’il a reçu de l’une des parties pour rendre une sentence injuste en sa faveur.
RAPIN René, Mémoires, II, éd. Aubineau, p. 380.
Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial et aux révérends pères jésuites, publiées sur la dernière édition revue par Pascal, avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en introductions et nombreuses notes historiques, littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l’abbé Maynard, chanoine honoraire de Poitiers, I, Paris, Didot 1851, p. 381 sq. Note sur cette décision.
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 188 sq. Lessius n’est pas en train de dire que la corruption en elle-même n’est pas injuste.
VIII, 15. Je fus tout interdit par cette fantasque décision : et pendant que j’en considérais les pernicieuses conséquences, le père me préparait une autre question, et me dit : Répondez donc une autre fois avec plus de circonspection. Je vous demande maintenant. Un homme qui se mêle de deviner, est-il obligé de rendre l’argent qu’il a gagné par cet exercice ? Ce qu’il vous plaira, mon révérend père : lui dis-je. Comment ce qu’il me plaira ! Vraiment vous êtes admirable ! Il semble, de la façon que vous parlez, que la vérité dépende de notre volonté. Je vois bien que vous ne trouveriez jamais celle-ci de vous-même. Voyez donc résoudre cette difficulté-là à Sanchez : mais aussi c’est Sanchez. Premièrement il distingue en sa Som., l. 2. c. 38. n. 94. 95. et 96. Si ce devin ne s’est servi que de l’astrologie, et des autres moyens naturels : ou s’il a employé l’art diabolique. Car il dit qu’il est obligé de restituer en un cas, et non pas en l’autre. Diriez-vous bien maintenant auquel ? Il n’y a pas là de difficulté, lui dis-je. Je vois bien, répliqua-t-il, ce que vous voulez dire. Vous croyez qu’il doit restituer au cas qu’il se soit servi de l’entremise des démons? Mais vous n’y entendez rien. C’est tout au contraire. Voici la résolution de Sanchez au même lieu; Si ce devin n’a pris la peine et le soin de savoir par le moyen du diable ce qui ne se pouvait savoir autrement : Si nullam operam apposuit, ut arte diaboli id sciret, il faut qu’il restitue : mais s’il en a pris la peine, il n’y est point obligé. Et d’où vient cela, mon Père ? Ne l’entendez-vous pas, me dit-il ? C’est parce qu’on peut bien deviner par l’art du diable, au lieu que l’astrologie est un moyen faux. Mais, mon Père, si le diable ne répond pas la vérité, car il n’est guère plus véritable que l’astrologie : il faudra donc que le devin restitue par la même raison ? Non pas toujours, me dit-il. Distinguo, dit Sanchez sur cela. Car si le devin est ignorant en l’art diabolique, si sit artis diabolicæ ignarus, il est obligé à restituer : mais s’il est habile sorcier, et qu’il ait fait ce qui est en lui, pour savoir la vérité, il n’y est point obligé. Car alors la diligence d’un tel sorcier peut être estimée pour de l’argent : diligentia a mago apposita est pretio aestimabilis.
Texte de 1659; « si le diable ne répond pas à la vérité ».
Deviner; l’original porte déviner.
Voir le texte de Sanchez, Opus morale in praecepta Decalogi, Lib. II c. 38, n. 96, in GEF V, p. 132. « Qualiter divinantes et malefici pretium divinationis et malefici restituere ? n. 96. Quod si loquamur de pretio accepto..., distinguendum est sic. Si nullam operam apposuit, ut arte diaboli id sciret astrologus ille, quod nullo alio pacto sciri potuit; sive effectus evenerit, sive non, tenetur pretium restituere danti. Quia nullam diligentiam adhibuit, sed casu effectus evenit aut non evenit... Et quamvis consulens astrologum in ea re deliquerit,, offerens pretium pro re turpi, verior sententia habet restituendum ipsi, donec per sententiam condemnetur, ut id pretium amittat. Si vero astrologus ille, vel divinator operam suam apposuit, et arte diaboli res ita evenit, non tenetur pretium restituere. Quia ipse suam operam etsi turpem apposuit : et acceptum pro opere turpi, non est obnoxium restitutioni; juxta veriorem sententiam. Atque haec omnia docent Navarra..., Manuel..., Salas... Adduntque indistincte teneri pretium restituere quando res non ita eveit. Sed id non credo, quando ipse diligentiam adhibuit arte diaboli ad eum effectum necessariam. Sicut medicus quando juxta artis praecepta medicatus est, non, tenetur pretium restituere, aegro pereunti. Quia ea diligentia a mago illo apposita, est pretio aestimabilis. Nec in hoc casu tenetur damna et expensas consulenti restituere : sed tantum quando nullam operam impendit , aut ejus diabolicae artis ignarus erat. Et ita limitandum est quod numero praecedenti diximus. Quia quando operam suam impnedit, non decepit. »
Ce qu’il vous plaira, mon révérend père, lui dis-je. Comment, ce qu’il me plaira ! Vraiment vous êtes admirable ! Il semble, de la façon que vous parlez, que la vérité dépende de notre volonté : ironie à double détente; c’est exactement ce que Pascal pense : plus précisément il pense que les casuistes agissent comme s’ils pensaient que la vérité dépend de leur pure volonté.
GAY Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Cerf, 2011, p. 187. Sur ce passage et le fonctionnement de l’argument. Pascal reprend une question traditionnelle en morale, celle du bien illégitimement acquis, comme l’est celui gagné par la prostituée ou le mage, mais il utilise une explication détaillée du cas qui envisage les conditions particulières. A aucun moment Sanchez ne justifie le sorcier diabolique d’un péché gravissime, il se contente de dire qu’il n’a pas commis d’injustice à l’égard de son client et que, tant qu’il ne commet pas d’injustice, il n’a pas à restituer. Le sorcier incompétent, lui, doit restituer : p. 188. Pascal, pour sa part, entend lui opposer le refus spontané de la sorcellerie. Ce qu’il conteste, ce sont bien les termes du débat.
Sorciers et sorcellerie
CABOURDIN Guy et VIARD Georges, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1978, p. 297. Sorcellerie.
BLUCHE François (dir.), Dictionnaire du grand siècle, p. 1459-1460.
MANDROU Robert, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle. Une analyse de psychologie historique, Paris, Seuil, 1980.
GUSDORF Georges, La révolution galiléenne, I, Paris, Payot, 1969, p. 174 sq. Définition du sorcier : p. 175. Autorités en faveur de l’existence des démons : p. 175 sq. L’épidémie de sorcellerie en Europe : p. 176. Plan de l’angéologie et de la démonologie dans la mentalité du temps : p. 177. Démonologie et théologie : p. 178. Recul avec l’avènement du mécanisme : p. 178 sq. Procédures judiciaires : p. 179. Opposition consistant à disjoindre le naturel du surnaturel : p. 180. Montaigne : p. 180. Joannes Wier, De praestigiis daemonum (1516-1588) : p. 182. Limitation du démoniaque : p. 183. Naudé et le Jugement de tout ce qui a été imprimé contre le cardinal Mazarin, 1649 : p. 183 sq. Imposture de la sorcellerie : p. 184. La Mesnardière, Traité de la mélancolie, 1635 : p. 185. Succès croissant de l’interprétation médicale : p. 186. Transformation de la jurisprudence : p. 186. Recul général de la répression juridique à l’endroit des faits de sorcellerie : p. 187. Fin de Satan au XVIIe siècle : p. 189. Cas de l’Angleterre : p. 189 sq. Thomas Browne : p. 190. Joseph Glanvill : p. 190 sq. Malebranche : p. 192 sq. L’explication physiologique : p. 192. Réserve faite d’une sorcellerie qui ne serait pas imaginaire : p. 193. Limite de l’interférence avec la Révélation : p. 193. Limite de l’interprétation médicale en pays catholique : p. 194. Balthasar Bekker, Le monde des enchantements, 1691-1693 : p. 195. Double fondement de l’interprétation, par la raison et par l’Écriture, sans humiliation de l’une ou de l’autre : p. 195-196.
TREVOR-ROPER Hugh, « L’épidémie de sorcellerie en Europe aux XVIe et XVIIe siècles », in De la réforme aux Lumières, Gallimard, Paris, 1972, p. 133-236.
LENOBLE Robert, Mersenne, p. 88 sq. Raisons d’être de la sorcellerie : l’explication de phénomènes incompréhensibles : p. 89. Paravent aux tendances perverses, désir de nuire et de lubricité : p. 90. Sacrilèges, pactes avec le démon : p. 90. Lycanthropes : p. 90. Refuge des inadaptés du temps : p. 90-91.
CARMONA Michel, Les diables de Loudun. Sorcellerie et politique sous Richelieu, Fayard, Paris, 1988.
NOUËT, Impostures VI, in Réponses, p. 113 sq.
PIROT Georges, Apologie pour les casuistes, éd. de 1658, p. 213 sq.
SILHON Jean de, De l’immortalité de l’âme, Paris, Pierre Billaine, 1634, Livre II, Discours VIII, Où il est montré qu’il y a des anges. Qu’ils ne sont pas d’eux-mêmes. Que le principe qui les a produits est une intelligence, et qu’il n’est qu’un, p. 708 sq. Y a-t-il des sorciers ?
CYRANO DE BERGERAC, Œuvres complètes, éd. Prévost, p. 57, Lettre XII, Pour les sorciers; Lettre XIII, Contre les sorciers.
JOUSLIN Olivier, « Rien ne nous plaît que le combat ». La campagne des Provinciales de Pascal. Étude d’un dialogue polémique, I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, 2 vol.
Il y a dans la jeunesse de Pascal une histoire de sorcière, rapportée par sa nièce Marguerite Périer, dans son Mémoire sur Pascal et sa famille, OC I, éd. J. Mesnard, p. 1090 sq. A deux ans, l’enfant ne peut voir « d’eau ni d’autres liqueurs » ni ne peut « souffrir son père et sa mère ensemble, quoiqu’il les vît fort bien l’un et l’autre séparément ». Il est « sec comme les enfants qui sont en chartre », de sorte que l’on n’en attend plus que la mort. On le croit ensorcelé : les soupçons tombent sur une vieille femme « à qui l’on faisait la charité dans la maison ». D’abord sceptique, Etienne Pascal convoque la vieille, la houspille un peu et l’engage à guérir son fils. « On peut mettre le sort sur une bête », dit-elle, et d’assassiner un pauvre matou en le jetant par la fenêtre; « Il tomba roide mort. » Elle fabrique ensuite avec quelques herbes une espèce de gâteau qu’elle place sur le nombril de l’enfant, qui finit par guérir. Que penser de cet étrange récit ? Il remonte à Gilberte Pascal, source qui semble une garantie de vérité. Mais le miracle de la Sainte-Épine a guéri les plaies de Marguerite, mais pas nécessairement
Voir le jeu de mots dans le texte sur L’alphabet artificiel, OC IV, éd. J. Mesnard, p. 1617. « Que l’on n’attende rien ici du hasard. L’art de déchiffrer les écritures en chiffres n’est point le résultat des coups du hasard : ce n’est point une divination. Il faudrait être maître sorcier pour déchiffrer l’écriture artificielle : et, comme on sait, ce n’est pas être sorcier que de croire aux sorciers », p. 1617. Mais l’attribution de ce passage à Pascal est impossible.
L’astrologie est un moyen faux
CABOURDIN Guy et VIARD Georges, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1978, p. 27.
PONTAS, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 171-172. Astrologie judiciaire.
SHIOKAWA Tetsuya, Pascal et les miracles, p. 19 sq. Théorie des influences astrales.
Saint AUGUSTIN, Les Confessions, VII, VI, 8, Bibliothèque augustinienne, t. 13, p. 595 sq.
DE LIBERA Alain, Penser au Moyen Age, Paris, Seuil, 1991, p. 246 sq.
DEL RIO Martin, Disquisitiones magicae, Louvain, 1599.
AGRIPPA Cornélius, Paradoxe sur l’incertitude, vanité et abus des sciences, trad. en français du latin, de Henri Corneille Agrippa, 1617, Chap. XXXI, De l’astrologie judiciaire, p. 130 sq.
L’étude de l’astrologie judiciaire a été conduite par des savants célèbres, notamment Kepler; voir
LABROUSSE Élisabeth, L’entrée de Saturne au Lion. L’éclipse de soleil du 12 août 1654, Nijhoff, The Hague, 1974, 116 p. La position de l’Église sur la divination associée à l’astrologie judiciaire; p. 41 sq. Selon Charles de Condren, l’Église ne condamne que ceux qui attribueraient aux astres une influence si immédiate sur la volonté humaine qu’elle abolirait toute contingence : elle a “condamné la divination : mais elle n’a pas déclaré en quelles prédictions elle se rencontre : il suffit de la détester en son âme”, p. 47 sq. Yves de Paris : p. 49 sq. Les arguments théologiques sur l’astrologie : p. 52 sq. Sur la position des mécanistes, voir p. 40 et 52. Pierre Petit : p. 52. Les ecclésiastiques catholiques : p. 53. Contre le “fatalisme arabe”, p. 57. Les pasteurs réformés : p. 59 sq.
SIMON Gérard, Kepler, astronome astrologue, Paris, Gallimard, 1979. Les causes physiques de l’efficace des astres : p. 36 sq. Les causes harmoniques et psychiques : p. 44 sq. La nature a la possibilité d’adresser des signes à l’homme, en vertu de l’existence de l’âme du monde. L’instinct inné de l’observation des étoiles chez l’homme répond peut-être à un fondement dans la nature des choses : p. 68. Nécessité de l’intervention d’une puissance supérieure pour régler le cours des planètes : p. 69. A partir de quel point l’astrologie devient une impiété aux yeux de Kepler : p. 75 et voir p. 93. Les techniques de l’astrologie judiciaire : p. 86 sq.
BLAMONT, Le chiffre et le songe, p. 348. Tycho sur l’astrologie judiciaire. Voir p. 396 sq., les idées de Kepler sur l’astrologie.
DELUMEAU Jean, Le mystère Campanella, Paris, Fayard, 2008, p. 339 sq. Une époque saturée d’astrologie. Cardan et le débat sur l’astrologie : p. 344 sq. Condamnation de l’astrologie par l’Index en 1559 : p. 347. Campanella théoricien de l’astrologie : p. 349 sq. La carrière d’astrologue de Campanella : p. 355 sq.
L’astrologie judiciaire est encore admise par des savants comme Jacques Alleaume, l’élève de Viète : mais des réfutations ont été publiées dès 1614. Sa fausseté est admise dans le cercle de Mersenne, qui insère la sentence de la Sorbonne contre la pratique de l’astrologie judiciaire (22 mai 1629) dans les Préludes de l’harmonie universelle. Voir MERSENNE Marin, Les préludes de l’Harmonie universelle ou Questions curieuses utiles aux prédicateurs, aux théologiens, aux astrologues, aux médecins et aux philosophes. Composées par L.P.M.M., à Paris, chez Henri Guénon : voir éd. Pessel, Paris, Fayard, p. 525 : “Plusieurs estiment que l’on peut prédire ce qui doit arriver aux hommes par la connaissance des Astres : parce qu’ils disent que les différentes constitutions de nos corps, et de nos tempéraments dépendent des planètes, et des étoiles qui se rencontrent à nos naissances. Or je veux ici examiner ce que l’on peut dire de la naissance d’un parfait Musicien, qui soit capable de plaire par ses harmonies à toutes sortes de personnes selon les plus excellentes règles de l’Astrologie. C’est pourquoi je mets ici la Nativité que les plus savants Astrologues de ce siècle ont jugée capable de nous donner un parfait musicien. Et puis j’examinerai les fondements, et les règles de l’astrologie”, p. 525. Mais après avoir étudié en détail ce que doit être l’horoscope en question, Mersenne conclut que l’astrologie n’est pourtant qu’une fausse science, qui sert tout au plus à duper les puissants et à leur prendre de l’argent. “Plusieurs estiment que l’on peut prédire ce qui doit arriver aux hommes par la connaissance des Astres : parce qu’ils disent que les différentes constitutions de nos corps, et de nos tempéraments dépendent des planètes, et des étoiles qui se rencontrent à nos naissances. Or je veux ici examiner ce que l’on peut dire de la naissance d’un parfait Musicien, qui soit capable de plaire par ses harmonies à toutes sortes de personnes selon les plus excellentes règles de l’Astrologie. C’est pourquoi je mets ici la Nativité que les plus savants Astrologues de ce siècle ont jugée capable de nous donner un parfait musicien. Et puis j’examinerai les fondements, et les règles de l’astrologie” : p. 525. Proposition I, Qu’il n’y a point de certitude dans les horoscopes précédents, et que l’on ne peut rien prédire de la perfection d’un musicien par la constitution des cieux, p. 545. Proposition II, Les trois maisons de la première triplicité ne sont établies par aucune démonstration ou raison qui puisse persuader la vérité de ce que les astrologues disent de ces trois domiciles, p. 547. Mersenne discute à l’aide de notions philosophiques et mécaniques : on ne peut pas dire que la maison située à l’orient, la première maison ou Horoscope, est la plus puissante, car cette partie bat l’horizon trop obliquement; “et il serait plus à propos de dire que la partie culminante du Ciel est la plus puissante, puisqu’elle envoie ses influences, et ses rayons plus perpendiculairement, et qu’elle est plus proche de celui qui naît que n’est la partie orientale : autrement il faut nier que les causes naturelles agissent mieux, et plus fort par une ligne plus courte, et plus perpendiculaire, que par une plus longue, et plus oblique, et démentir toutes les expériences du ciel et de la terre” : p. 548. Proposition III, La seconde, la troisième et la quatrième triplicité ne sont pas mieux établies que la première, p. 551. Les astrologues n’ont ni raison, ni expérience qui nous contraigne de suivre leur opinion, encore qu’ils se vantent de mille expériences qu’ils puisent dans les livres, ou qu’ils disent avoir faites : mais ils ne sauraient en faire paraître aucune qui soit tellement réglée que l’on y puisse établir quelque chose de certain, p. 552-553. Proposition V, L’on ne saurait prédire assurément les maladies, ni les inclinations que quelqu’un aura aux vices, aux vertus, et aux sciences, ni quel sera son tempérament, par les règles ordinaires de l’astrologie judiciaire, p. 555. Raison principale contre l’astrologie : “n’étant fondée que sur les expériences dont se vantent les astrologues, elle sera entièrement renversée, si jamais l’on n’a pu faire deux semblables expériences”, p. 560. Question III. Que les hommes savants et judicieux rejettent l’astrologie judiciaire, parce qu’elle n’a nul fondement, ou principe solide : et que toutes les maximes des astrologues sont dignes de risée : et conséquemment que l’on ne peut rien prédire d’assuré, ni de probable de la naissance des hommes par le moyen des astres, p. 565 sq.
Voir sur Mersenne critique de l’astrologie judiciaire, MERSENNE, Correspondance, I, p. 42. Le minime aborde la question des aspects des astres sous un angle un peu différent dans Harmonie universelle, Traité des instruments, Proposition XI, éd. CNRS, t. 3, p : 27 sq. Déterminer le nombre des aspects dont les astres regardent la terre, et les consonances auxquelles ils répondent.
On trouve pourtant la manière de dresser un thème céleste dans HÉRIGONE, Cursus mathematicus, IV, Geographia , De sphaera mundi, p. 137 sq.
Sur la manière dont l’astrologie est considérée dans les milieux libertins, voir CAVAILLÉ Jean-Pierre, Dis/simulations. Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto. Religion, morale et politique au XVIIe siècle, Paris, Champion, 2002, p. 97 sq. Vanini invoque Pomponazzi, puis Cardan, à propos des miracles : il fait un usage instrumental de l’astrologie, montrant qu’il la possède parfaitement, mais utilisant sa réfutation pour banaliser la religion chrétienne en la soumettant aux mêmes critères d’analyse que les autres : p. 101-102.
Signes astrologiques : voir SIMON Gérard, Kepler astrologue astronome, p. 467.
Saint Augustin et l’astrologie
LANCEL Serge, Saint Augustin, Paris, Fayard, 1999, p. 78 sq.
VIII, 16. Cela est de bon sens, mon père, lui dis-je ; Car voilà le moyen d’engager les sorciers à se rendre savants et experts en leur art, par l’espérance de gagner du bien légitimement selon vos maximes, en servant fidèlement le public.
VIII, 15. Je crois que vous raillez, dit le père : cela n’est pas bien. Car si vous parliez ainsi en des lieux où vous ne fussiez pas connu, il pourrait se trouver des gens qui prendraient mal vos discours, et qui vous reprocheraient de tourner les choses de la religion en raillerie.
Ironie : Pascal parle justement à un personnage qui ne le connaît pas.
VIII, 15. Je me défendrais facilement de ce reproche, mon père. Car je crois que si on prend la peine d’examiner le véritable sens de mes paroles, on n’en trouvera aucune qui ne marque parfaitement le contraire, et peut-être s’offrira-t-il un jour dans nos entretiens l’occasion de le faire amplement paraître. Ho ho, dit le père, vous ne riez plus. Je vous confesse, lui dis-je, que ce soupçon, que je me voulusse railler des choses saintes, me serait aussi sensible, qu’il serait injuste. Je ne le disais pas tout de bon, repartit le père ; mais parlons plus sérieusement. J’y suis tout disposé si vous le voulez, mon Père : cela dépend de vous.
Texte de 1659 : « ce soupçon que je me voulusse railler des choses saintes me serait bien sensible, comme il serait bien injuste ».
Cognet, in Provinciales, p. 149, renvoie à la Lettre d’un provincial au secrétaire de Port-Royal, factum anonyme qui parut après la Provinciale VI, qui accusait Pascal de “tourner en raillerie les controverses les plus importantes de la foi et les principaux points de la doctrine du christianisme”.
La réponse au jésuite annonce la Provinciale XI. Pascal a donc visiblement déjà prévu le tournant de la querelle dans lequel il va assurer sa propre défense, et celle de ses lettres. Noter en effet que ce que « Montalte » dit de ses propos, le lecteur le comprend des précédentes Provinciales.
VIII, 15. Mais je vous avoue que j’ai été surpris de voir, que vos Pères ont tellement étendu leurs soins à toutes sortes de conditions, qu’ils ont voulu même régler le gain légitime des Sorciers. On ne saurait, dit le Père, écrire pour trop de monde, ni particulariser trop les cas, ni répéter trop souvent les mêmes choses en différents livres.
Écrire pour trop de monde, ni particulariser trop les cas, ni répéter trop souvent les mêmes choses en différents livres : procédés caractéristiques de la casuistique corrompue des jésuites selon Pascal. Écrire pour trop de monde, parce que cela permet de ménager le clergé, la noblesse et le tiers état, comme il est dit dans VI, 13, de manière à se concilier toutes les conditions. Répéter trop souvent les mêmes choses en différents livres parce que c’est le moyen de confirmer les décisions des casuistes les uns par les autres.
VIII, 16. Vous le verrez bien par ce passage d’un des plus graves de nos pères. Vous le pouvez juger, puisqu’il est aujourd’hui notre Père Provincial. C’est le r. p. Cellot, en son l. 8. de la Hiérarc. c. 16. § 2. Nous savons, dit-il, qu’une personne qui portait une grande somme d’argent pour la restituer par ordre de son confesseur, s’étant arrêtée en chemin chez un libraire, et lui ayant demandé s’il n’y avait rien de nouveau, num quid novi ? Il lui montra un nouveau livre de théologie morale, et que le feuilletant avec négligence et sans penser à rien, il tomba sur son cas, et y apprit qu’il n’était point obligé à restituer : De sorte que, s’étant déchargé du fardeau de son scrupule, et demeurant toujours chargé du poids de son argent, il s’en retourna bien plus léger en sa maison : Abjecta scrupuli sarcina, retento auri pondere, levior domum repetiit.
Sur le p. Cellot, voir V, 21 et VI, 17. Le texte est donné dans GEF V, p. 122. Citation exacte : Wendrock prolonge un peu la citation.
VIII, 16. Eh bien, dites-moi après cela s’il est utile de savoir nos maximes ? En rirez-vous maintenant? Et ne ferez-vous pas plutôt avec le P. Cellot cette pieuse réflexion sur le bonheur de cette rencontre ? Les rencontres de cette sorte sont en Dieu l’effet de sa providence, en l’Ange gardien l’effet de sa conduite, et en ceux à qui elles arrivent, l’effet de leur prédestination. Dieu de toute éternité a voulu que la chaîne d’or de leur salut dépendît d’un tel auteur, et non pas de cent autres qui disent la même chose, parce qu’il n’arrive pas qu’ils les rencontrent. Si celui-là n’avait écrit, celui-ci ne serait pas sauvé. Conjurons donc par les entrailles de Jésus-Christ ceux qui blâment la multitude de nos auteurs, de ne leur pas envier les livres que l’élection éternelle de Dieu et le sang de Jésus-Christ leur a acquis. Voilà de belles paroles par lesquelles ce savant homme prouve si solidement cette proposition qu’il avait avancée. Combien il est utile qu’il y ait un grand nombre d’auteurs qui écrivent de la Théologie Morale. Quam utile sit de theologia morali multos scribere.
Voir la fiche Cellot, et Provinciale VI, 17.
L’impression originale ne fait pas de la dernière phrase un paragraphe à part : seule l’édition de 1659 sépare la citation de ce qui précède.
Et ne ferez-vous pas plutôt... : le mot pas est manquant dans l’édition de 1659.
Les rencontres... : citation plus lointaine que la précédente. Voir GEF V, p. 122. Cellot désigne nommément Petrus Aurelius, c’est-à-dire Saint-Cyran.
CELLLOT Louis, De hierarchia et hierarchicis, ch. XVI, p. 717. La formule est en toutes lettres dans la marge.
Présentation burlesque d’un thème qui sera repris sur un ton sérieux dans les Écrits des curés de Paris. Voir Ecrit I, 9. “Ces opinions accommodantes ne commencèrent pas par cet excès, mais par des choses moins grossières, et qu’on proposait seulement comme des doutes. Elles se fortifièrent peu à peu par le nombre des sectateurs, dont les maximes relâchées ne manquent jamais : de sorte qu’ayant déjà formé un corps considérable de casuistes qui les soutenaient, les ministres de l’Église, craignant de choquer ce grand nombre, et espérant que la douceur et la raison seraient capables de ramener ces personnes égarées, supportèrent ces désordres avec une patience qui a paru par l’événement, non seulement inutile, mais dommageable : car, se voyant ainsi en liberté d’écrire, ils ont tant écrit en peu de temps, que l’Église gémit aujourd’hui sous cette monstrueuse charge de volumes. La licence de leurs opinions, qui s’est accrue avec le nombre de leurs livres, les a fait avancer à grands pas dans la corruption des sentiments et dans la hardiesse de les proposer. Ainsi les maximes qu’ils n’avaient jetées d’abord que comme de simples pensées furent bientôt données pour probables : ils passèrent de là à les produire pour sûres en conscience, et enfin pour aussi sûres que les opinions contraires, par un progrès si hardi, qu’enfin les puissances de l’Église commençant à s’en émouvoir, on fit diverses censures de ces doctrines. L’Assemblée générale de France les censura en I642, dans le livre du P. Bauny Jésuite, où elles sont presque toutes ramassées ; car ces livres ne font que se copier les uns les autres. La Sorbonne les condamna de même ; la Faculté de Louvain ensuite, et feu M. l’Archevêque de Paris aussi, par plusieurs censures. De sorte qu’il y avait sujet d’espérer que tant d’autorités jointes ensemble arrêteraient un mal qui croissait toujours. Mais on fut bien éloigné d’en demeurer à ce point : le P. Héreau fit, au Collège de Clermont, des leçons si étranges pour permettre l’homicide, et les PP. Flahaut et Le Court en firent de même à Caen de si terribles pour autoriser les duels, que cela obligea l’Université de Paris à en demander justice au Parlement, et à entreprendre cette longue procédure qui a été connue de tout le monde. Le P. Héreau ayant été, sur cette accusation, condamné par le Conseil à tenir prison dans le Collège des Jésuites, avec défenses d’enseigner dorénavant, cela assoupit un peu l’ardeur des casuistes ; mais ils ne faisaient cependant que préparer de nouvelles matières, pour les produire toutes à la fois en un temps plus favorable.”
VIII, 17. Mon père, lui dis-je, je remettrai à une autre fois à vous déclarer mon sentiment sur ce passage, et je ne vous dirai présentement autre chose, sinon que, puisque vos maximes sont si utiles, et qu’il est si important de les publier, vous devez continuer à m’en instruire; car je vous assure que celui à qui je les envoie les fait voir à bien des gens. Ce n’est pas que nous ayons autrement l’intention de nous en servir, mais c’est qu’en effet nous pensons qu’il sera utile que le monde en soit bien informé. Aussi, me dit-il, vous voyez que je ne les cache pas; et pour continuer, je pourrai bien vous parler, la première fois, des douceurs et des commodités de la vie que nos pères permettent pour rendre le salut aisé et la dévotion facile, afin qu’après avoir [appris] jusqu’ici ce qui touche les conditions particulières, vous appreniez ce qui est général pour toutes, et qu’ainsi il ne vous manque rien pour une parfaite instruction. Après que ce père m’eut parlé de la sorte, il me quitta. Je suis, etc.
Afin qu’après avoir vu jusqu’ici ce qui touche les conditions particulières...; le verbe vu,, qui figure sur l’impression originale, manque dans l’édition de 1659. Les éditions postérieures le remplacent par appris, et parfois par entendu.
Avant la formule de conclusion, l’édition de 1659 donne la phrase suivante; « Après que ce Père m’eut parlé de la sorte, il me quitta ».
VIII, 18. J’ai toujours oublié à vous dire qu’il y a des Escobars de différentes impressions. Si vous en achetez, prenez de ceux de Lyon, où il y a à l’entrée une image d’un agneau, qui est sur un livre scellé de sept sceaux, ou de ceux de Bruxelles de 1651. Comme ceux-là sont les derniers, ils sont meilleurs et plus amples que ceux des éditions précédentes de Lyon, des années 1644 et 1646.
Le post-scriptum est omis dans Wendrock : les éditions de Lyon 1646 et de Paris 1656 sont à la BN ; celle de Bruxelles 1651 est signalée par BJB à Amsterdam et Maredsous.
Sur les impressions originales comme sur celles de 1657 manquent les lignes ci-dessous, qui ont été ajoutées en 1659 :
Depuis tout ceci, on en a imprimé une nouvelle édition à Paris, chez Piget, plus exacte que toutes les autres. Mais on peut encore bien mieux apprendre les sentiments d’Escobar dans la Grande Théologie morale, dont il y a déjà deux volumes in-folio imprimés à Lyon. Ils sont très dignes d’être vus, pour connaître l’horrible renversement que les Jésuites font de la morale de l’Église.
Cette addition ne se trouve évidemment pas dans l’édition Le Guern, qui reproduit le texte de 1657. Elle figure en revanche dans l’édition Cognet.
ESCOBAR Y MENDOZA Antonio, Liber Theologiae moralis viginti et quatuor Societatis Jesu doctoribus reseratus. Lyon, 1644, 898 p.
ESCOBAR Y MENDOZA Antonio, Liber Theologiae moralis viginti et quatuor Societatis Jesu doctoribus reseratus. Ed. novissima, J. Gautherin, Lyon, 1646, 854 p.
SAINTE-BEUVE, Port-Royal, éd. Leroy, Pléiade, t. 2, p. 129.
